Accueil
Séances
plénières
Tables
des matières
Biographies
Livres
numérisés
Bibliographie
et liens
Note
d’intention
« Mémoire sur le paupérisme dans les
Flandres », par Ed. DUCPETIAUX, inspecteur général des prisons et établissements
de bienfaisance
Bruxelles,
Hayez, 1850
Chapitre II. Causes de la misère et du paupérisme dans les Flandres
1. Accroissement, agglomération
et exubérance de la population
5. Décadence de l'industrie linière.
- Insuffisance du travail et des débouchés
a. Production du lin
b. Exportation et importation du lin et des
étoupes
c. Fabrication et exportation des toiles
d. Nombre d’ouvriers employés à l’industrie
linière
e. Condition des ouvriers liniers. - Décroissement
des salaires des fileuses et des tisserands
f. Condition comparée des tisserands flamands et
anglais
g. Misère croissante des ouvriers liniers dans
les Flandres
h. Causes de la décadence et du malaise de
l’industrie linière
6. Hausse du prix des denrées
alimentaires
8. Vices du système des secours publics
(page 48) Dans le chapitre qui précède,
nous avons exposé quelques-uns des principaux éléments propres à faire
apprécier l'état et les progrès de l'indigence et du paupérisme dans les
deux Flandres.
Cette étude serait stérile, si elle ne devait nous mettre sur la
voie des causes du malaise qui entraîne de si déplorables conséquences : à leur
tour, ces causes étant connues et précisées, il sera plus facile de découvrir
et de combiner les moyens de les écarter.
La situation des deux Flandres est
identique, à beaucoup d'égards : la langue, les usages, le caractère, le degré
de civilisation de leurs habitants, la nature du sol et des industries
principales, le mode d'administration, sont absolument semblables. Dans l'une
et l'autre de ces provinces, l'agriculture forme encore la base principale du
travail; l'industrie linière y est généralement combinée avec les occupations
rurales. Cependant la Flandre orientale, par le nombre et le développement de
ses manufactures de coton, occupe une position industrielle supérieure à celle
de la Flandre occidentale. De là quelques différences de détail, mais qui
n'influent pas sensiblement sur l'ensemble de la situation.
II nous est donc permis
d'envisager cette situation d'une manière générale sans nous arrêter à la
limite qui sépare les deux provinces.
Quelles sont donc les causes
auxquelles on peut assigner les symptômes de décadence et d'appauvrissement qui
préoccupent si vivement l'attention publique et la sollicitude du Gouvernement
?
Parmi ces causes, il y en a de
permanentes et d'accidentelles : les unes sont particulières aux Flandres, les
autres s'étendent à tout le pays, de même qu'aux nations voisines.
Dans les recherches auxquelles
nous allons nous livrer, sous ce rapport, nous croyons ne pas devoir aborder
spécialement ce
(page 49) dernier ordre de causes.
Ce serait nous engager dans un travail qui dépasserait les limites assignées à
ce mémoire, et qui
nous détournerait, à certains égards, du but que nous devons avoir en vue. Il
reste donc entendu que nous dégageons la question qui nous occupe de toute
considération qui pourrait lui paraître étrangère.
A.
Au nombre des causes permanentes ou essentielles de la
misère dans les Flandres,
on peut ranger :
1° La surabondance et
l'agglomération excessive de la population ;
2° L'insuffisance du travail
et des débouchés ;
3° La décadence de l'industrie
linière ;
4° La grande division des
propriétés; le morcellement des cultures; l'élévation des fermages, conséquence
du prix élevé des terres et de la concurrence des locataires;
5° Le caractère, les habitudes
et le langage exclusif de la population flamande; le défaut ou l'insuffisance
de l'instruction et de l'éducation physique, morale et professionnelle dans la
classe ouvrière en général.
B. On
peut citer parmi les causes accidentelles ou secondaires :
1° La maladie des pommes de
terre, qui a exercé ses premiers ravages en 1845, et qui s'est de nouveau
manifestée, quoiqu'à un moindre degré, les années suivantes;
2° L'insuffisance de la
récolte de 1846 et l'élévation excessive du prix des denrées qui en a été la
conséquence;
3° Le manque de prévoyance et
l'absence d'institutions propres à prévenir les effets désastreux de certaines
calamités, dont le retour périodique peut être prévu;
4° L'insuffisance ou la
mauvaise organisation des secours et des remèdes locaux ;
5° L'état de vagabondage et le
déplacement d'une partie de la population indigente;
6° Les vices et les lacunes de
la législation sur la mendicité, le vagabondage, les délits ruraux, etc. ;
7° L'organisation défectueuse
des dépôts de mendicité et des prisons;
(page 50) 8°
La négligence, l'apathie, l'ignorance ou le mauvais vouloir de certaines
administrations locales, etc.
Nous allons passer successivement en revue les principales causes.
Dans un mémoire sur les anciens recensements de la population belge, publié
par M. Quetelet dans le 3e volume du Bulletin de la commission centrale de
statistique (1847), le savant auteur indique, dans un tableau résumé, les
accroissement relatifs de la population dans sept provinces, à l'égard
desquelles on a pu obtenir des renseignements complets, pendant chacune des
trois périodes : sous l'empire, sous le gouvernement des Pays-Bas et sous le
gouvernement actuel. L'accroissement pendant dant une série de
quarante-trois ans est comparé dans ce tableau au chiffre de la population au
commencement de la période :
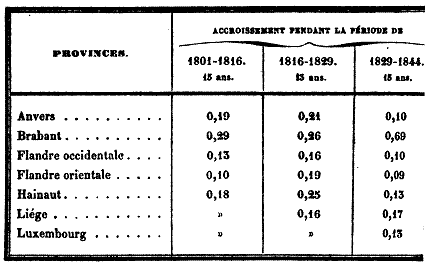
Il résulte de ces données que la population, depuis le commencement de ce siècle,
a été généralement croissante dans toutes les provinces. L'accroissement a
toutefois été bien moins rapide sous l'empire que du temps du royaume des
Pays-Bas.
La population de 1844, dans chaque province, surpasse de
plus d'un tiers la population de 1801.
(page 51) La province qui a reçu
les accroissements les plus rapides est celle du Brabant; sa population se
trouve presque triplée. En 1801, elle n'était guère que la moitié de la
population de la Flandre occidentale, et à la fin de 1844 elle lui était
supérieure.
En ce qui concerne spécialement les deux Flandres, voici quel a été le
nombre de leurs habitants constaté par les recensements successifs de 1801 à
1846 :
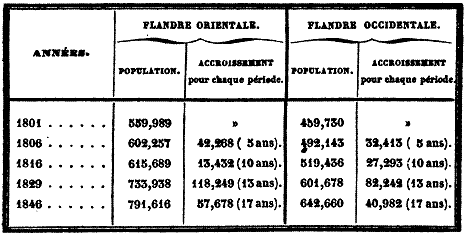
Ainsi, dans l'espace de 45 ans, la population de la Flandre orientale s'est
accrue de 231,627 et celle de la Flandre occidentale de 182,930 habitants.
L'augmentation a donc été de 41 p. c. dans la première de ces deux
provinces, et de 40 p. c. dans la seconde.
En 1800, la population du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande
était évaluée à 15,800,000 habitants; d'après le recensement général de 1841,
elle s'était élevée à 27,019,558. L'augmentation, dans l'espace de 40 ans, a
donc été de 11,219,558 habitants, soit 71 p. c..
La France, en 1801, comptait 27,349,000 habitants, et en 1846, d'après le
dernier recensement, 35,400,000 habitants. L'augmentation, dans l'espace de 45
ans, a donc été de 8,051,000 habitants, soit 23 p. co.
On voit que l'accroissement de la population dans les Flandres (page 52) est moins
rapide que dans le Royaume-Uni, mais qu'il s'est élevé à près du double de
l'accroissement de la population en France.
D'après le cadastre, l'étendue totale de la Belgique est de 2,945,593
hectares; son étendue productive, c'est-à-dire ce qui reste du territoire,
déduction faite des bruyères, terrains essartés, marais, fanges et terrains
vagues, est évaluée à 2,718,111 hectares. Partant de ces données, nous
indiquons dans le tableau suivant le rapport de la population à l'étendue de
chaque province, en distinguant les terrains productifs et improductifs :
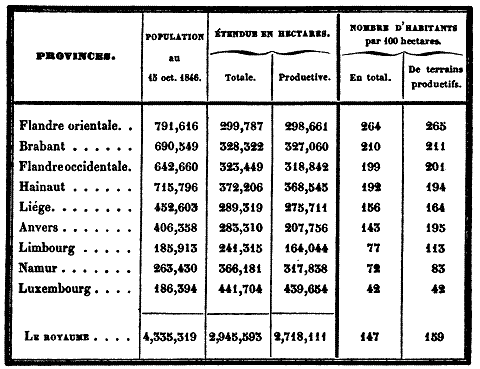
Relativement à leur étendue, les deux Flandres occupent le 1er et le 3me
rang dans l'ordre de la densité de la population ; le Brabant, qui dépasse un
peu la Flandre occidentale, compte, malgré l'agglomération considérable que
présentent la capitale et ses faubourgs, 54 habitants de moins par 100 hectares
que la Flandre orientale.
D'après un tableau inséré dans l'almanach statistique de Wei- mar, pour
1848, et qui indique la densité de la population de tous les États de l'Europe,
nous trouvons que, si l'on excepte la principauté de Lucques et les trois
villes hanséatiques de Francfort, (page
53) Hambourg et Bréme, qui peuvent être écartées de la comparaison parce
qu'elles n'ont pas à proprement parler de territoire rural, la Belgique est de
tous les États celui où la population est le plus pressée. La lieue carrée
géographique (de 15 au degré) y renferme une moyenne de 8,016 habitants, tandis
qu'en Hollande, dans la Grande-Bretagne, en France, en Prusse, la même
superficie de terrain ne compte respectivement que 5330, 4885, 3622 et 5172
âmes.
Dans les Flandres la moyenne de la population, par lieue
carrée géographique, peut être évaluée à près de treize mille habitants.
Il suffît de ce fait, combiné avec l'accroissement de la population pendant
le commencement de ce siècle, et avec la décadence de la principale industrie
de ces deux provinces, pour expliquer en partie les effrayants progrès qu'y ont
faits la misère et le paupérisme. Le nombre des indigents augmente en raison de
la densité de la population; le degré de malaise semble être en rapport
constant avec l'étendue de terrain attribuée en moyenne à chaque habitant :
cette coïncidence ressort à l'évidence du relevé comparatif qui suit :
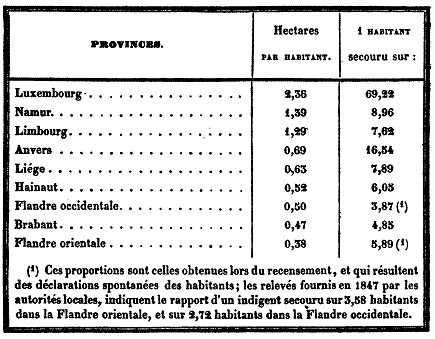
(page 54) En
1841, on comptait :
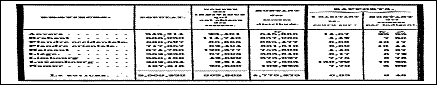
Ces moyennes l'emportent de beaucoup sur celle que présentent les deux
Flandres (1 habitant pour 43 ares). Il en résulte que, toute proportion gardée,
l'Angleterre et l'Irlande pourraient voir doubler, et la France voir tripler
leurs populations respectives avant d'atteindre le niveau de la population de
la Flandre occidentale; pour atteindre celui de la population de la Flandre
orientale, le Royaume-Uni devrait avoir le triple et la France le quadruple du
chiffre actuel de leurs habitants.
§. 2. - Insuffisance du travail
agricole, et excès du nombre des cultivateurs comparé à l’étendue cultivable du
sol
Nous venons de faire ressortir deux faits essentiels, l'accroissement de la
population dans les deux Flandres et l'exubérance de cette population, lorsqu'on
la compare à l'étendue territoriale sur laquelle elle est disséminée. Il nous
reste maintenant à interroger ses rapports avec le travail agricole, et avec la
quotité des denrées destinées à son alimentation. Ici encore nous nous
étalerons sur des données officielles fournies par les exposés de situation des
provinces ou publiées par le Gouvernement.
D'après les relevés du recensement de 1846, on trouve que la province de la
Flandre orientale comptait, à cette époque, sur une population de 793,264 habitants,
638,698 personnes de tout âge et de tout sexe appartenant à la classe ouvrière
proprement dite; dans ce nombre les cultivateurs et les personnes dépendant de
cet état comptaient pour 192,315. Le rapport des cultivateurs aux ouvriers en
général était donc de 30 pour cent; il était d'un peu plus de 24 pour cent en
raison de la population totale de la province.
Nous avons vu plus haut que l'étendue productive de la Flandre orientale
était de 298,661 hectares; si l'on divise ce nombre (page 55) par celui des individus appartenant à la
population agricole, on trouve qu'il y a environ 1 individu pour 1 hectare
55 ares.
En France, la population agricole est évaluée à la moitié, soit 50 pour
cent de la population totale. La superficie productive du pays étant de 50
millions d'hectares environ, on peut estimer qu'il y a environ 2 hectares 75
ares de terre cultivable par individu appartenant à la population agricole.
Dans le Royaume-Uni, la population agricole a diminué dans une assez forte
proportion durant la période décennale de 1831 à 1841 : son rapport à la
population totale était :
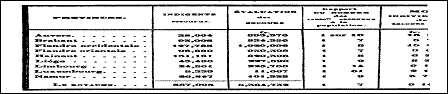
En 1811, le rapport était de 35.2 pour la Grande-Bretagne. Il s'ensuit que
la quantité de produits agricoles qui nécessitait à cette époque le travail de
7 familles, n'en exigeait plus que 5 en 1841.
En Irlande, au contraire, la population agricole a subi une légère
augmentation.
Il résulte de la comparaison des chiffres qui précèdent que le rapport de la
population agricole à la population totale est à peu près le même dans la
Flandre orientale que dans la Grande-Bretagne, qu'il est environ le double en
France, et qu'il est plus du double en Irlande. En d'autres termes, 1,000
personnes appartenant à la population agricole pourvoient aux besoins de
l'alimentation de :
4,167 habitants dans la Flandre orientale;
3,861 dans la Grande-Bretagne;
2,000 en France;
1,511 en Irlande.
En y comprenant les femmes et les enfants, la population agricole de la
Grande-Bretagne peut être évaluée à 4,000,000 d'âmes, et celle de l'Irlande est
portée à 5,358,000 âmes d'après le recensement de 1841. Or, l'étendue
productive de la Grande-Bretagne (page
56) étant de 16,000,000 d'hectares environ, et celle de l'Irlande de 7,000,000
d'hectares, on trouve qu'il y a approximativement un individu appartenant à la
population rurale pour 4 hectares dans le premier de ces pays, et un pour 1
hectare 1/3 dans le second.
Des données qui précèdent on peut conclure que, de tous
les pays entre lesquels nous avons établi notre comparaison, c'est la Flandre
orientale qui, proportionnellement, nourrit, avec un nombre donné de
cultivateurs, le plus grand nombre d'habitants; ce fait témoigne en faveur du
perfectionnement de son agriculture. Mais si elle l'emporte à cet égard sur la
Grande-Bretagne elle-même, il faut reconnaître, d'autre part, que
l'alimentation moyenne dans ce dernier pays l'emporte sur celle de la Flandre,
et que les quantités de produits, bien qu'affectées à un moindre nombre de
consommateurs, sont cependant, en réalité, plus grandes chez nos voisins que
chez nous.
La seconde conclusion à tirer, est que la population agricole est presque
aussi pressée dans la Flandre orientale qu'en Irlande; elle l'est beaucoup
moins en France ; elle l'est moins encore dans la Grande-Bretagne. Ainsi, pour
100 hectares de terre cultivables, on compte, y compris les femmes et les
enfants :
77 cultivateurs en Irlande;
65 dans la Flandre orientale;
36 en France;
et 25 seulement dans la Grande-Bretagne.
Dans ce dernier pays, le petit nombre des cultivateurs est compensé par la
perfection des procédés de culture; en France, le rapport indique la
possibilité d'augmenter le nombre des bras employés au travail agricole, en
même temps qu'il fait ressortir la nécessité des améliorations; en Irlande, le
chiffre élevé de la population agricole n'est que l'expression de la misère,
tandis que dans la Flandre il fait ressortir à l'évidence l'impossibilité de
dépasser désormais la proportion actuelle sans faire déchoir le cultivateur du
bien-être relatif dont il jouit encore aujourd'hui.
Or, ce bien-être est déjà menacé à certains égards : le nombre (page 57)
des journaliers agricoles et même des cultivateurs portés sur les listes des
bureaux de bienfaisance a augmenté dans une assez forte proportion depuis
quelques années; il était, en 1818, de 21,607; en 1847, il s'élevait à 35,990.
Loin donc de pouvoir songer, comme en France, à déverser le trop plein des
villes dans les campagnes, il importe de préparer dans la Flandre orientale les
moyens de réduire le nombre des travailleurs agricoles, afin de prévenir les
suites désastreuses de la concurrence qu'ils se feraient entre eux.
La Flandre occidentale est bien près aussi d'atteindre l'extrême
limite où la terre fait défaut aux habitants. Le nombre des agriculteurs est,
dans cette province, proportionnellement supérieur à celui des agriculteurs
dans la Flandre orientale. Ce fait s'explique par l'absence de la grande
industrie dans la Flandre occidentale. Bien que le rapport de la population
agricole à la population totale soit à peu près le même dans les deux provinces
(Il est de 73 p. c. dans la Flandre orientale, et de 71 p. c.o dans la Flandre
occidentale), il est à remarquer qu'une partie des ouvriers des campagnes dans
la Flandre orientale travaillent pour les manufactures, tandis que dans la
Flandre occidentale ils n'ont guère d'autre ressource que les occupations des
champs et la manipulation du lin.
Il reste donc démontré que, parmi les causes de la misère dans les deux
Flandres, il faut ranger en première ligne, non seulement l'exubérance de la
population en général, mais encore l'insuffisance du travail agricole et
l'excès du nombre des cultivateurs, lorsqu'on le compare à la superficie
cultivable de ces provinces.
§. 3. -Défaut de proportion
entre la production des denrées et les besoins de l’alimentation. - Crise
alimentaire de 1845-1847
D'après les données publiées naguère par la commission centrale de
statistique, la Belgique dispose, dans une année ordinaire, (page 58) à ne compter que les céréales
(froment, épeautre, méteil, seigle, sarrasin) dont l'homme se nourrit sous
différentes formes, d'une masse d'aliments qui ne s'élève pas à moins de
11,957,803 hectolitres; à ces denrées alimentaires viennent s'ajouter, d'une
part, 22,514,917 hectolitres de pommes de terre, et de l'autre, les grains et
les autres comestibles qui, de l'étranger, sont importés dans le pays, et qui
représentent, année commune, la quantité de 458,649 hectolitres. On ne peut
nier que ces divers produits, qui équivalent à peu près à 16,346,455
hectolitres de blé (107 hectolitres de blé valant, comme nourriture, 613
hectolitres de pommes de terre, 22,514,917 hectolitres de ces tubercules
équivalent à peu près à 3,930,003 hectolitres de blé), ne soient nécessaires
aux besoins de la population belge, puisqu'ils sont consommés, et que, parmi
les habitants du pays, il en est beaucoup qui, même en temps ordinaire, n'ont
qu'une nourriture ou insuffisante ou malsaine.
En adoptant ce dernier chiffre comme l'expression des besoins constatés, et
en le comparant aux produits récoltés en 1846, on trouve que le déficit,
pendant cette dernière année, a été de 4,219,396 hectolitres pour les céréales
qui servent habituellement à la nourriture de l'homme, et de 7,363,653
hectolitres de pommes de terre, soit, en tout, à peu près l'équivalent de
5,504,733 hectolitres de blé. Ce déficit n'a pas été, à beaucoup près, compensé
par les importations du dehors. Pendant une période de douze mois, de septembre
1846 jusqu'à la fin du mois d'août 1847, il est à peine entré dans le pays
2,000,000 d'hectolitres de blé, c'est-à-dire à peu près la sixième partie de la
consommation ordinaire, et pas à beaucoup près la moitié du déficit constaté
dans la production de 1846 (Rapport de la commission centrale de statistique
au Ministre de l'intérieur sur la situation des subsistances. Bruxelles, 26
novembre 1847. (Moniteur du 11 décembre 1847)).
Si nous admettons que la consommation normale de la Belgique soit
représentée par 16,346,694 hectolitres de blé, nous (page 59) trouvons qu'eu égard à leur population,
la Flandre orientale devrait compter dans ce chiffre pour 2,970,000
hectolitres, et la Flandre occidentale pour 2,410,000 hectolitres; total 5,380,000
hectolitres.
Or, d'après les relevés publiés récemment par la commission centrale de
statistique, voici quelles étaient les quantités effectivement récoltées dans
les deux provinces :
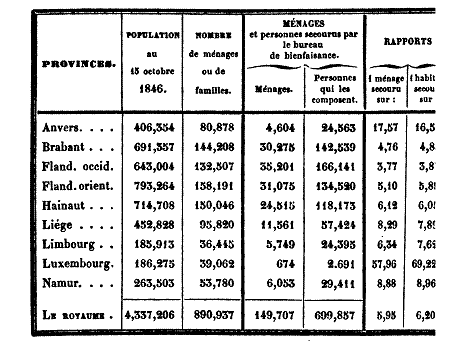
II résulte de ces données :
1° Qu'année moyenne le déficit dans la production alimentaire des deux
Flandres est d'environ 410,000 hectolitres;
2° Que ce déficit a été, en 1846, de 2,253,000 hectolitres;
3° Qu'il y a eu, enfin, un excédant de 344,000 hectolitres en 1847, en
admettant que la récolte des pommes de terre ait atteint cette année la moyenne
des années ordinaires.
Les céréales proprement dites représentent, année commune, pour les deux
provinces, une quantité de 3,713,116 hectolitres; leur population réunie étant,
d'après le recensement de 1846, de 1,454,276 habitants, on trouve que la
consommation annuelle (page
60) de chaque habitant serait d'environ 2 hectolitres 59 l., et en
déduisant un septième pour les semences, environ 2 hectolitres 22 litres.
Dans le royaume entier, cette consommation est de 2 hectolitres 76 litres,
et, en déduisant les semences de 2 hectolitres 37 litres.
En Angleterre et dans le pays de Galles, la moyenne annuelle de la consommation
des céréales (Froment, orge, pois et fèves, non compris le seigle et l'avoine)
par habitant, semences déduites, peut être évaluée à 3 hectolitres 67 litres,
non compris les quantités importées.
En France, cette moyenne est évaluée à 3 hectolitres 12 litres.
Le dernier recensement agricole, fait en 1846, nous fournit des données
intéressantes sur le bétail qui existe en Belgique : d'après ces données,
il y aurait dans le royaume, et dans les deux Flandres en particulier :
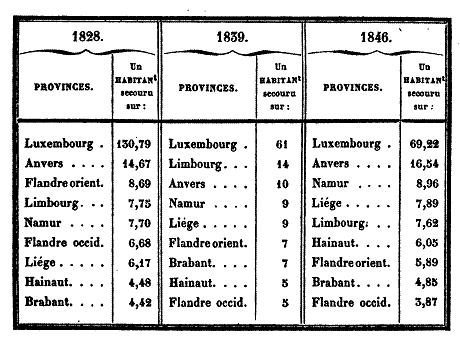
Si l'on compare ces chiffres à la superficie territoriale et au nombre
d'habitants, on a les rapports suivants :
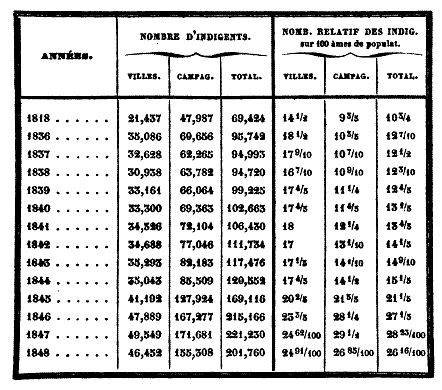
Il peut être intéressant de mettre ces rapports en parallèle avec ceux que
nous fournissent les relevés pour la France et le royaume-uni dela
Grande-Bretagne et d'Irlande (Documents statistiques publiés par le
gouvernement français. - La France statistique, par A. Le Goyt. Paris,
1843. - Patria. Paris, 1847. - Revue britannique, juin 1848.
-M'Culloch, A descriptive and statistical accountofthe British empire. Lonrlon,
1847).
(page 62) De
tous les renseignements qui précèdent, on peut conclure :
1° Que la consommation des Flandres en céréales est un peu moindre que la
moyenne de cette même consommation dans le royaume entier, et qu'elle est de
beaucoup inférieure à celle de la France et de l'Angleterre;
2° Que, proportionnellement à la superficie territoriale, le gros bétail
est plus nombreux dans les Flandres que dans le reste du royaume, qu'en France
et dans le Royaume-Uni, tandis qu'il est moins considérable, au contraire,
lorsqu'on le compare au chiffre de la population ; le rapport du gros bétail au
nombre d'habitants est à peu près le même dans les Flandres qu'en Irlande;
3° Que le nombre des moutons, relativement à l'étendue territoriale et à la
population, est moins considérable dans les Flandres que dans le reste du
royaume, et qu'il reste de beaucoup en dessous des relevés constatés pour
l'Angleterre, l'Écosse, la France et même l'Irlande;
4° Qu'en somme, les Flandres, au point de vue de la production alimentaire,
sont dans une situation inférieure à celle du reste du royaume, et qu'elles
sont beaucoup moins bien partagées que les pays voisins avec lesquels nous les
avons mises en parallèle. Malgré la juste renommée dont jouit l'agriculture de
ces deux provinces, le sol y suffit à peine pour fournir aux premiers besoins
de la nourriture de leurs habitants; loin de pouvoir contribuer à
approvisionner les autres provinces, les Flandres en sont déjà réduites à leur
demander ou à prendre à l'étranger le complément nécessaire à leur propre
approvisionnement.
D'après des évaluations basées sur les données fournies par le recensement
agricole de 1846, il serait abattu annuellement en Belgique 77,000 têtes de
gros bétail, 69,000 veaux, 59,000 moutons et 291,000 porcs, qui donneraient
approximativement (page 63) 51,145,760 kil. de viande brute; à raison de 60 p. c., le poids
net de la viande livrée à la consommation serait de 30,687,456 kil., soit 7
kil. environ par habitant. Dans les deux Flandres, cette moyenne serait réduite
à 6 et même à 5 kil. Aussi la viande est-elle complétement exclue du régime
habituel du cultivateur et de l'ouvrier flamand, particulièrement dans les
campagnes : par contre, on remarquera que les pommes de terre entrent pour plus
du quart dans la consommation générale des deux provinces. C'est là, à certains
égards, un fait fâcheux, qui tend à rapprocher les Flandres de l'Irlande, et
qui les expose aux crises alimentaires qui sévissent périodiquement dans ce
dermer pays. Ainsi s'explique le coup terrible porté aux populations flamandes,
surtout dans les campagnes, par la maladie des pommes de terre. De petits
cultivateurs, d'honnêtes et laborieux ouvriers qui, au commencement de 1845,
luttaient encore avec courage contre la décadence de l'industrie linière, ont
été quelques mois après réduits au dénûment le plus absolu par suite du fléau
qui est venu ravager le champ d'où dépendait leur subsistance. Depuis, malgré
les récoltes relativement abondantes de 1847 et de 1848, la maladie des pommes
de terre continuant à sévir quoiqu'à un moindre degré, le malaise s'est
prolongé à certains égards avec la cause qui l'alimentait.
§. 4. -Grande division des
propriétés; morcellement des cultures; élévation des fermages, conséquence du
prix élevé des terres et de la concurrence des locataires
Le cadastre commencé en 1808, a été terminé dans les Flandres en 1834. Il
existait à cette dernière époque, dans la Flandre orientale, pour une
superficie de 299,787 hectares, 792,849 parcelles et 122,584 habitations. En 1847,
le nombre des parcelles cadastrales s'élevait à 822,885; il y a donc eu, dans
l'intervalle des quatorze dernières années, une augmentation de 30,036
parcelles. L'étendue moyenne de chaque parcelle était, en 1834, de 37 ares 81
centiares, et en 1847, de 36 ares 43 centiares.
Dans la Flandre occidentale, en 1834, pour une superficie
de 323,449 hectares, le nombre des parcelles était de 657,282, et celui des
propriétaires de 76,393. En 1847, ces nombres s'élevaient respectivement à
676,381 parcelles et 86,157 propriétaires. Il y avait donc augmentation de
19,099 pour les premières et de 9,764 pour les seconds. L'étendue moyenne de
chaque parcelle était de 49 ares 21 centiares, en 1834, et de 47 ares 82
centiares, en 1847.
La division cadastrale pour tout le pays donnait, en 1834, 5,561,159
parcelles (Essai sur la statistique générale de la Belgique, par X.
Heuschling, 1841, p. 74 et 75); soit une étendue moyenne de 52 ares 73
centiares par parcelle.
Il résulte des Documents statistiques, publiés en 1835 par le
gouvernement français, qu'au 1er septembre 1834, il n'existait pas moins de
123,360,338 parcelles cadastrales en France, réparties entre 10,896,982
propriétaires : ainsi, 118 parcelles pour un propriétaire, et une étendue
moyenne de 40 ares 35 centiares par parcelle.
A en juger par le simple énoncé des faits qui précèdent, la subdivision du
sol, quoique très considérable en Belgique, le serait cependant moins qu'en
France. Mais on se tromperait si, dans l'un comme dans l'autre pays, on
considérait cette subdivision comme donnant la mesure exacte de l'état actuel
de la propriété. Il faudrait commencer par déduire du chiffre total des
parcelles, 7,000,000 de maisons avec leurs dépendances en France, et 700,000 en
Belgique. En outre, les parcelles sont le plus souvent réunies, en nombre plus
ou moins considérable, dans les mêmes mains et exploitées par le même
cultivateur.
Mais, même en tenant compte de ces observations, on remarquera que la
division de la propriété dans les Flandres, et surtout dans la Flandre
orientale, est beaucoup plus grande que dans le reste du pays. On sait en outre
que les exploitations rurales dans les provinces flamandes sont généralement
moins étendues (page 65) que dans les autres; le morcellement à cet égard paraît avoir
atteint sa limite extrême. Un grand nombre de propriétaires, dans le but
d'augmenter leurs revenus, ont subdivisé leurs terres ; plusieurs fermiers
sous-louent des parcelles. Par suite de la concurrence que se font les
locataires, le prix des fermages a augmenté successivement depuis quelques
années, en même temps que la condition des petits fermiers s'est empirée.
Il est à craindre que l'agriculture ne se ressente de cet état de choses,
et que la production du bétail ne vienne à diminuer, tandis que la culture des
pommes de terre recevrait au contraire une nouvelle extension. Si cela devait
arriver, la condition du paysan et du journalier des Flandres se rapprocherait
de plus en plus de celle du paysan irlandais, au lieu de se relever au niveau
du régime du laboureur anglais, qui se nourrit principalement de froment et
souvent aussi de viande de boucherie.
Sans contester les avantages que présente à certains égards le système de
culture des Flandres, on ne peut cependant méconnaître qu'il est difficile de
le concilier avec l'économie des ressorts, et qu'il exclut, à certains égards,
l'emploi des machines qui tendent à simplifier le travail en le rendant plus
facile ; de là la nécessité de compenser le surcroît de dépense qu'occasionne
l'emploi des bras, en abaissant le salaire des travailleurs. En Angleterre, on
estime que l'étendue moyenne des fermes est de 160 à 170 acres (40 à 43
hectares), tandis que dans les Flandres elle ne dépasse pas probablement 9 à 10
hectares. Il s'ensuit que le fermier, en raison même de l'exiguïté de son
exploitation, est exposé à des chances beaucoup plus défavorables dans le
dernier pays que dans le premier. Aussi les retards dans le payement des
fermages, et même l'insolvabilité complète des locataires, deviennent-ils plus
fréquents d'année en année. Ce sont là de fâcheux symptômes, qui commandent une
sérieuse attention et qui ne pourraient être méconnus sans danger.
L'industrie linière forme depuis de longues années la
base principale du travail dans les Flandres (Note de bas de page : « Les
manufactures de lin de ce pays, supérieures dans tous les genres à celles des
autres nations, occupent, dit un écrivain du temps (Shaw, Essai sur les
Pays-Bas autrichiens), un grand nombre de mains. Gand et Courtrai sont
fameuses pour leurs toiles. Les blanchisseries de Gand, qui sont dans la ville
le long des rivières et des canaux qui l'arrosent et la coupent en une infinité
d'îles, méritent et attirent l'attention des voyageurs. Le magistrat veille à
la bonté de cette fabrique, dont le produit passe dans les pays étrangers, et
fournit un article essentiel de commerce. L'Espagne, qui a eu si longtemps des
relations avec cette partie des Pays-Bas, a toujours besoin de l'industrie de
la Flandre; elle en tire des toiles de lin pour les envoyer dans ses colonies
d'Amérique. Le lin fin que produisent les Pays-Bas fournit le fil délicat avec
lequel on travaille les dentelles si connues sous le nom de dentelles de
Mltines et de Bruxelles. L'invention de cet art, qui donne une
occupation si agréable à l'industrie des femmes, est due à ce pays. On prétend
que plus de cent mille personnes sont employées à la dentelle dans Bruxelles,
Malines et leur territoire. ») ; dans sa combinaison avec l'agriculture, la
population des campagnes trouvait non seulement des moyens d'existence, mais
encore la source d'un certain bien-être. Le sol produisait la matière première
; la famille entière, hommes, femmes, enfants, concourait aux diverses
manipulations du lin; les occupations étaient alternées; le chef de famille
passait de la culture de son champ à son métier; la ménagère quittait son rouet
pour veiller au soin du ménage : chacun avait sa tâche et nul instant n'était
perdu. La vente du fil et de la toile subvenait au payement du loyer et des
contributions. La petite culture, associée à la filature et au tissage,
apparaissait aux yeux de tous comme l'expression d'un système qui était proposé
comme modèle aux autres nations.
Malgré les obstacles qui se sont opposés à son développement, et parmi
lesquels nous citerons les progrès de l'industrie cotonnière, la chute de
l'Empire français en 1814, la perte du (page
67) débouché des colonies espagnoles et l'élévation du
tarif français de 1825 à 1826, la révolution de 1830, la mauvaise récolte de
1833, qui a amené la crise de 1834, l'industrie linière a poursuivi sa marche
ascendante. Au commencement du siècle, la production annuelle de cette
industrie ne dépassait pas 25 millions de francs; en 1840, la commission
d'enquête, instituée par le Gouvernement, estime qu'elle s'élevait à 60
millions. Elle avait donc plus que doublé dans l'intervalle de 40 ans ;
l'augmentation était de 140 p. c.
C'est surtout à dater de 1838 que les symptômes de décadence commencèrent à
se manifester de manière à préoccuper sérieusement l’attention publique et
celle du Gouvernement. On a longuement discuté sur les causes qui l'ont amenée.
Dès 1833, le comité de conservation remplaçant les états-députés de la Flandre
orientale, dans son rapport du 14 décembre 1833, s'exprimait à ce sujet en ces
termes :
« Nous ne pouvons nous dissimuler que notre industrie linière, qui
autrefois faisait la richesse des deux Flandres, perd insensiblement de son
importance, par suite de la concurrence que nous avons à soutenir avec nos
voisins, qui sont parvenus à établir leurs prix au-dessous des nôtres. Nous
devons attribuer cette supériorité au bas prix de la main-d'œuvre en Allemagne,
résultant de la modicité des impositions et des fermages, à quoi il faut
ajouter une amélioration sensible dans leurs tissus; tandis que, sous ce
rapport, nous sommes restés stationnaires. La concurrence des Anglais est bien
plus redoutable encore par la perfection de leurs mécaniques à filer et à
tisser le lin ; déjà leur fil inonde nos marchés et se vend de préférence au
nôtre, étant plus égal et moins cher. »
Le comité signale également comme un obstacle à la prospérité de
l'industrie linière les droits élevés mis en France à l'importation des toiles
belges; il demande que le Gouvernement prévienne l'anéantissement total de
cette industrie par des droits sur la sortie de nos lins.
En 1840, le Gouvernement institua une commission d'enquête (page 68) à l'effet
de constater la situation de l'industrie linière en Belgique, et de rechercher
les moyens d'encouragement et de protection qu'il pourrait être utile
d'employer dans l'intérêt de cette industrie (Note de bas de page : La
commission était composée de MM. le comte d’Hane
de Potter, sénateur, Cools, membre de la Chambre des représentants, Desmet
et Rey aîné, membre de l'administration de l'association nationale
pour le progrès de l’industrie linière, Costantini, secrétaire de la
caisse des propriétaires, et de M. N. Briavoinne, secrétaire. L'arrêté
royal qui l'institue, porte la date du 25 février 1840). Cette commission se
livra à un examen long et consciencieux des questions qui lui étaient soumises;
elle étendit ses investigations non seulement dans le pays, mais encore à
l'étranger, et le volumineux rapport dans lequel elle rendit compte des
résultats de sa mission, restera comme un témoignage de son zèle, et sera
consulté avec fruit par tous ceux qui s'occupent du problème dont la solution
est vivement sollicitée de toutes parts. Nous avons puisé nous-même dans cet
important travail un certain nombre de faits qui doivent servir, selon nous, à
faire apprécier la véritable situation de l'industrie linière, son degré
d'importance et la nature des causes qui ont amené sa décadence et entretiennent
son malaise.
En 1840, la totalité des terres arables du royaume était évaluée à
1,505,595 hectares, sur lesquels 41,000 hectares environ étaient cultivés en
lin ; c'est un peu plus d'un hectare sur 37.
La culture du lin comparée à l'étendue des terres arables était évaluée
comme suit dans les deux Flandres:
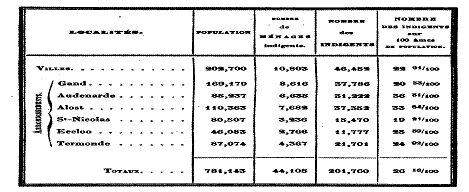
(page 69) A la même époque, la
production annuelle du lin teillé était, dans le royaume, de 20,902,900 kilog.,
dans la Flandre orientale, de 8,191,456 kil., et dans la Flandre occidentale de
6,797,176 kil. En admettant que le kilogramme de lin teillé vaille en moyenne
fr. 1 65 c., on trouve quela récolte annuelle représenterait, dans le
royaume entier, une valeur de 34,489,785 francs, et dans les deux Flandres
seulement une valeur de 24,731,243 francs.
B. Exportation et importation du lin et des
étoupes.
Les quantités de lin et d'étoupes exportées à l'étranger sont évaluées comme
suit, dans les relevés officiels pour la période de 1838 à 1848:
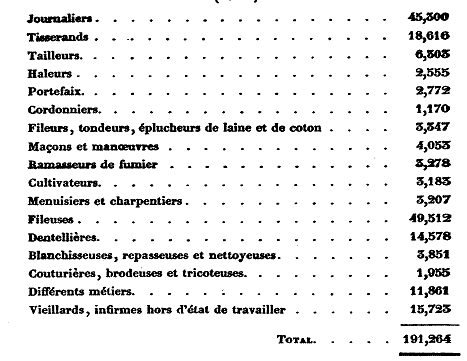
On voit qu'à partir de 1840 l'exportation du lin et des étoupes a été en
diminuant; elle s'est assez sensiblement relevée en 1845, mais elle a encore
continué à décroître pendant les trois (page
70) années suivantes. Cette réduction frappe exclusivement
l'agriculture; elle peut dépendre en partie du produit des récoltes, mais elle
résulte aussi certainement en partie de la substitution des lins russes,
allemands et hollandais aux lins belges, dans les filatures des pays étrangers,
qui jadis recouraient à nos marchés pour leurs approvisionnements. Les
importations de lin et d'étoupes dans le Royaume-Uni se sont élevées, en 1843,
à 1,422,992 quintaux (Le quintal anglais, pesant 112 livres, équivaut à 50,78
kil.), et en 1844 à 1,583,328 quintaux. La Russie figure dans ce dernier
chiffre pour 1,112,024 quintaux, la Prusse pour 249,404 quintaux, la Hollande
pour 106,638 quintaux, et la Belgique, qui ne vient qu'au quatrième rang, pour
44,967 quintaux.
D'un autre côté, l'importation du lin étranger en Belgique a augmenté
depuis quelques années dans une assez forte proportion; on pourra en juger par
le relevé suivant :
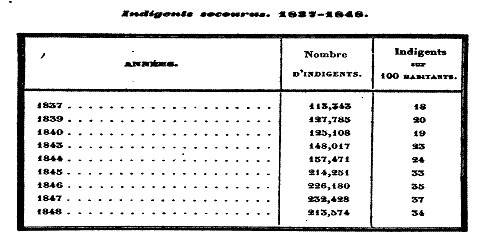
Ces lins sont pour la plupart mis en œuvre dans les filatures à la
mécanique, érigées depuis quelques années dans le pays. C'est aussi à l'existence
de ces filatures que l'on doit la reprise de l'exportation des fils belges à
l'étranger. Cette exportation, en ce qui concerne le marché français, avait
successivement décliné pendant la période de 1829 à 1838, tandis que
l'exportation des fils anglais en France avait, au contraire, suivi une
progression très (page 71) considérable; à partir de 1838 les fils belges ont reconquis une
partie de leurs débouchés, grâce aux perfectionnements introduits dans les
procédés de la filature. L'expression et la preuve de ces deux faits se
trouvent dans les deux relevés qui suivent :
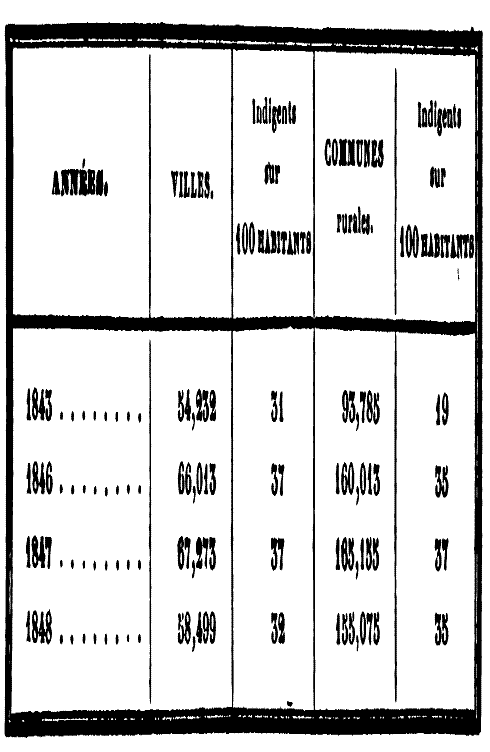
(page 72) Il y
a eu accroissement dans l'exportation des fils jusqu'en 1845; à partir de cette
année et pendant les trois années suivantes, on a constaté une décroissance
sensible, qui a porté une sérieuse atteinte à la prospérité de nos filatures.
Les événements de 1848 leur ont surtout été défavorables, et leurs effets
désastreux se font encore sentir aujourd'hui.
C. Fabrication et exportation des toiles
D'après les renseignements recueillis en 1840, lors de l'enquête sur la
situation de l'industrie linière, la fabrication des toiles unies en Belgique
s'élevait annuellement en poids à 10,044,275 kil., représentant une valeur de
plus de 40 millions de francs, en calculant seulement le kilogramme à 4 francs.
Si nous interrogeons les relevés des toiles vendues sur les marchés des
deux Flandres, nous pourrons nous faire une idée des fluctuations qui ont eu
lieu dans les dix dernières années, et apprécier jusqu'à un certain point la
réduction continue de ce mode de placement.
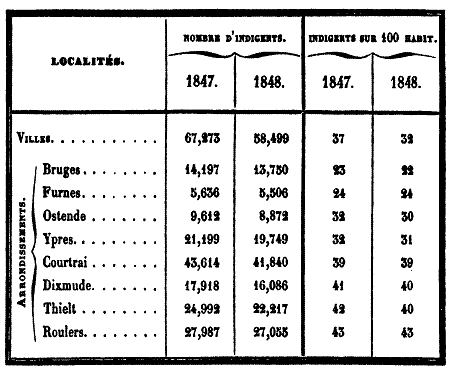
(page 73) Si,
dans le relevé qui précède, nous comparons les deux années au commencement et à
la fin de la période, nous trouverons que la vente des toiles sur les marchés
des Flandres a été réduite de moitié. Mais cette indication peut être fautive
ou du moins incomplète à certains égards, car indépendamment des tisserands qui
apportent leurs toiles sur les marchés, il en est d'autres qui travaillent à
façon pour des négociants ou des marchands, ou qui placent leurs produits de
toute autre manière. Dans l'impossibilité où nous sommes de constater la
quotité de la vente à l'intérieur du pays et pour la consommation de ses
habitants, nous pouvons du moins avoir recours aux relevés officiels, qui
indiquent les qualités et la valeur des toiles exportées à l'étranger. Voici
ces relevés pour la période de 1831 à 1848 (18 ans):
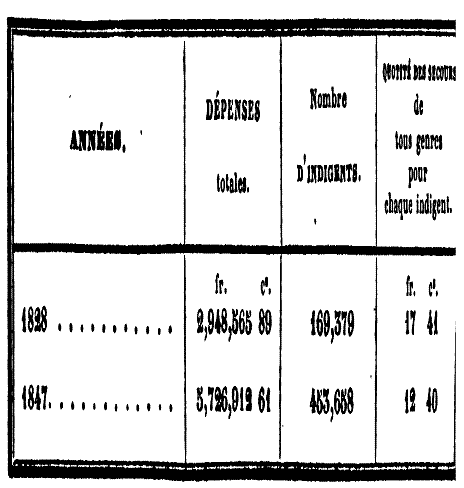
(page 74) On remarque
que les chiffres des exportations de toiles en 1831, 1832 et 1833, sont
beaucoup inférieurs à ceux des années suivantes. Mais l'inexactitude de ces
chiffres est prouvée par les documents officiels français, qui constatent que
l'importation des toiles belges en France peut être évaluée, pendant ces trois
mêmes années, aux quantités et aux valeurs suivantes :
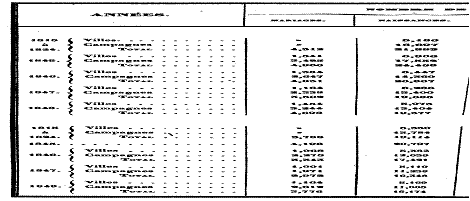
Mais il s'agit ici seulement des toiles de Belgique entrées dans la consommation
française; pour connaître nos exportations totales, nous aurions à ajouter à
ces chiffres les toiles vendues à la même époque à la Hollande, à l'Espagne, à
l'Allemagne, etc. On peut conclure de là que, pendant les premières années de
la révolution, la progression réelle n'a pas été tout à fait aussi forte
qu'elle pourrait le paraître au premier abord. La différence que nous signalons
provient de ce que dans nos documents, pendant les années qui ont suivi la
révolution de 1830, on acceptait la déclaration en douane des négociants
exportateurs, sans constater le nombre de kilogrammes à la sortie.
Quoi qu'il en soit, à partir de 1839, la décroissance des exportations est
manifeste, et elle se poursuit avec une désolante régularité pendant les années
suivantes. La valeur des exportations annuelles pendant la période de 1842 à
1848, est inférieure de près de 11 millions de kilogrammes à celle des
exportations qui ont eu lieu dans le cours des années 1835 à 1841. En admettant
que dans ces 11 millions les salaires soient comptés seulement (page 75) à raison de 2 francs en
moyenne par kilogramme, on voit que les ouvriers employés aux diverses
manipulations du lin ont vu diminuer de ce chef leurs ressources de plus de 3
millions annuellement. Or, cette somme est à peu près l'équivalent des revenus
de toute nature des bureaux de bienfaisance des deux Flandres. On comprend dès
lors combien ce seul déficit a dû influer d'une manière désastreuse sur la
condition des ouvriers liniers, surtout lorsqu'on le combine avec la crise
alimentaire qui a atteint si cruellement la population laborieuse tout entière.
D. Nombre d'ouvriers employés à l'industrie
linière
D'après les relevés publiés dans l’Enquête sur l'industrie linière, voici
quel était le nombre des fileuses et des tisserands dans les deux Flandres en
1840 :
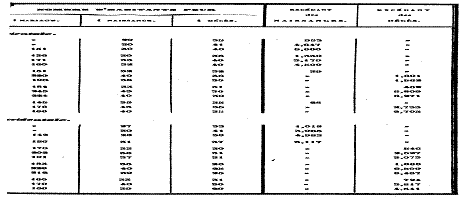
Dans ces chiffres ne sont pas compris les seranceurs et seranceuses, les
enfants et vieillards occupés à la préparation du fil, (page 76) au bobinage et à l'ourdissage,
les ouvriers blanchisseurs et ap- prêteurs, enfin les ouvriers employés dans
les magasins des négociants en toile.
Dans le nombre des fileuses, il en est pour lesquelles le filage n'est pas
une occupation principale, ou qui ne travaillent qu'en hiver; mais, par
compensation, un nombre considérable de femmes et de jeunes filles, qui filent
pour les besoins du ménage ou seulement quelques mois de l'année, ne figurent
pas dans les déclarations des communes.
Des renseignements plus récents, publiés par le Département de l'Intérieur
dans le Moniteur du 13 mai 1846, portent à 328,249 le nombre d'individus
de tout âge et des deux sexes occupés, en 1843, dans les diverses branches de
l'industrie linière. Ce relevé comprend quatre provinces : les deux Flandres,
le Hainaut et le Brabant; les ouvriers se subdivisaient comme suit :
57,821 tisserands;
194,091 fileurs et fileuses;
76,337 teilleurs et seranceurs.
Dans les Flandres seules, 79,054 ménages et 287,527 individus sont employés
dans la même industrie, et dans ce dernier chiffre ne sont pas compris les
enfants qui vivent du travail de leurs parents.
E. Condition des ouvriers liniers. - Décroissement des salaires des fileuses et
des tisserands
Pour apprécier la condition de cette nombreuse population, il importe
d'abord de bien définir les éléments dont elle se compose (Voy. rapport de la
commission chargée de l'enquête sur l'industrie linière, pag. 363 et
suiv.)
Les ouvriers liniers peuvent se diviser en trois classes
principales ::
Ceux qui préparent le lin, les teilleurs, seranceurs, etc.;
Les tisserands.
Parmi les fileuses, il faut distinguer celles qui travaillent pour le
marché de celles qui travaillent pour le ménage, c'est-à-dire pour un frère, un
fils ou un mari qui est tisserand.
Parmi les tisserands, les distinctions sont plus nécessaires encore et plus
nombreuses. Il y a le tisserand cultivateur et le tisserand fabricant; il y a
le tisserand qui ne travaille que sur commande, et enfin le tisserand qui
travaille pour le marché.
1ère classe. - Le tisserand cultivateur met en œuvre le lin qu'il a
cultivé, il n'achète qu'en cas d'insuffisance de sa récolte; ce tisserand
cultive parfois jusqu'à 3 et 4 hectares; il a des domestiques qui filent et qui
tissent.
2e classe. - Parmi les fabricants tisserands, les plus aisés
achètent leur lin sur pied, le font préparer, et surveillent ainsi ce produit
dans toutes ses transformations, jusqu'au tissage inclusivement. D'autres achètent
le lin teillé chez le marchand préparateur de lin; le plus souvent ils ont un
certain nombre de métiers, depuis 2 jusqu'à 40 et même 60, qu'ils occupent eux,
leur famille et leurs domestiques ou leurs ouvriers. Les fabricants de lames
font souvent fabriquer de la toile pour leur compte.
3e classe. - La troisième classe de tisserands, et en même temps la
plus nombreuse, se compose d'individus qui ne possèdent qu'un métier, tiennent
une petite demeure avec un journal de terre et quelquefois moins, en location,
achètent leur lin teillé à crédit chez le marchand ou le gros fermier, et
vendent la toile sur le métier ou au marché. En été, ils s'occupent de culture,
ou pour eux ou pour les fermiers de leurs environs. Un certain nombre seulement
travaillent toute l'année.
4e classe. - Les tisserands travaillant pour compte de marchands,
fabricants ou autres, qui leur remettent la chaîne et la trame. Ces tisserands
habitent d'ordinaire les villes ou les bourgs de leur voisinage. Dans ces
derniers temps leur nombre s'est accru, et l'on commence à les réunir en
atelier, surtout dans les localités où l'on fait emploi du fil mécanique.
(page 78) De
ces quatre classes, c'est la troisième qui a le plus souffert dans les derniers
temps; elle a été atteinte à la fois par la maladie des pommes de terre et la
stagnation du commerce.
L'époque de l'Empire a été l'âge d'or des tisserands; alors ils pouvaient
acheter en gros, et la commission d'enquête estime que leur salaire s'élevait
en moyenne à 2 francs par jour.
Sous le régime hollandais, la situation était encore tolérable, quoiqu'il y
eût de temps à autre de mauvais moments. 1816 et 1817 furent, entre autres, des
années de détresse. Il y eut beaucoup de misère par suite de la cherté du pain,
mais ceux-là même qui avaient des enfants à nourrir pouvaient vivre plus
facilement qu'aujourd'hui.
Il y a douze à quinze ans, le salaire des tisserands s'élevait encore, en
moyenne, à un peu plus d'un franc (12 sous) par jour; on vendait plus
facilement.
Mais depuis cette époque, et surtout depuis 1838, les bénéfices sont
toujours allés en décroissant.
La commission d'enquête, dans son rapport (p. 366 et suiv.), cite de
nombreux témoignages qui attestent, dès 1840, cette décroissance. En voici
quelques-uns qui concernent la position des fileuses, et que nous recueillons
pour ainsi dire au hasard :
Flandre orientale. - A Oosterzeele, aux environs de
Gand, la plupart des fileuses sont devenues mendiantes, et quand elles ont commencé
à mendier, elles ne veulent plus travailler. Les bonnes peuvent encore gagner
45 à 55 centimes en commençant à travailler avec le jour, d'autres disent
seulement 27 centimes (3 sous).
A Everghem, le salaire des fileuses est évalué par jour de 27 à 36
centimes; à Sleydinge, de 18 à 25 centimes; à Waerschoot, de 7 à 25 centimes.
A Belem, les fileuses employées par la fabrique de toile à voiles gagnent,
l'une dans l'autre, 36 centimes.
A Sottegem, en travaillant les étoupes, les fileuses ne peuvent plus guère
obtenir qu'un sou (9 centimes) par jour, et encore faut-il qu'elles soient
habiles; à Nederbrakel, la journée ne dépasse pas (page 79) 6 liards, aussi les fileuses renoncent-elles à leur
travail.
Les fileuses de Renaix gagnent en moyenne 10 centimes par
jour; ce bénéfice peut aller jusqu'à 18 centimes en travaillant depuis cinq
heures du matin jusqu'à neuf heures du soir.
A Cruyshautem, les meilleures fileuses peuvent gagner fr. 2 50 c. par
semaine, les autres fr. 1 50 c. Comme à Renaix, on trouve que les fileuses sont
plus à plaindre que les tisserands; il y a plutôt perte que gain à filer pour
le marché.
La situation des fileuses à Meire est déplorable; une fileuse, en
travaillant bien et en faisant une livre de fil par jour, ne peut pas gagner plus
de 27 centimes. Il en est de même des fileuses de Lede et des environs d'Alost
et de Ninove : la moitié sont sans travail; elles ne peuvent plus vivre que de
maraudage.
A Wetteren, les meilleures fileuses gagnent six liards par jour.
Flandre occidentale. - A Lichtervelde, le gain des
fileuses ne dépasse pas 25 à 40 centimes par jour, en travaillant toute la
journée.
Aux environs de Bruges, la plupart des fileuses étant ruinées et
découragées, ont cessé leur métier; il n'y a que quelques malheureuses qui achètent
une pierre de mauvais lin pour le convertir en fil. Celles qui travaillent
encore pour vendre leur fil au marché ne retrouvent pas toujours l'argent que
le lin a coûté.
A Ardoye, une fileuse peut gagner de 12 à 45 centimes, suivant sa dextérité;
on comptait en 1840, dans cette commune, 2,000 à 3,000 fileuses sur 7,000 à
7,600 habitants.
Les fileuses souffrent beaucoup dans le district de Courtrai : les fileuses
de Moorslede qui gagnaient 5 sous n'en gagnent plus qu'un. La plupart vivent en
mendiant et en maraudant dans les bois. - Les fileuses faisant le fil pour le
linge damassé ne gagnent pas 18 centimes par jour, sauf quelques exceptions; du
temps des Français leur salaire journalier pouvait s'élever jusqu'à 1 franc ;
il a constamment baissé depuis.
A Autryve, le nombre des fileuses est diminué, parce qu'elles ne gagnent
plus rien en travaillant.
A Avelghem, celles qui travaillent pour le marché ne gagnent (page 80) rien;
lorsqu'elles travaillent sur commande, leur gain ne peut guère dépasser I6 à 20
centimes. Aussi la plupart se livrent-elles à la mendicité.
A Iseghem, une fileuse ne gagne pas plus, en moyenne, de 18 centimes par
jour; etc., etc.
Passons aux tisserands : ici encore nous ne faisons que citer quelques-uns
des faits recueillis lors de l'enquête de 1840.
Flandre orientale. - Les tisserands employés dans la
fabrique de toile à voiles de Belem, peuvent gagner fr. 1 27 c. (14 sous) par
jour; l'un dans l'autre, ils gagnent 1 franc. Le salaire des tisserands n'a pas
varié depuis quelques années.
A Evergem, le plus qu'un tisserand puisse gagner, en tissant tout le jour,
est 54 à 63 centimes.
Un tisserand, à Sleydinge, peut gagner, en tissant des blondines, 63 à 72
centimes par jour; à Oosterzeele, quand il travaille bien, 72 centimes.
Dans les environs de Gand, son bénéfice est évalué à fr. 1 50 c. à 2 francs
par semaine, tous frais déduits.
Le tisserand, à Meire, peut gagner 53 centimes par jour; sur quoi il doit
déduire divers menus frais, reste net 48 centimes; à Lede, son gain journalier
est évalué, en moyenne, à 63 centimes.
A Cruyshautem, les tisserands sont démoralisés. Après avoir gagné fr. 1 50
c. par jour, ils ne gagnent plus que 80 centimes à 1 franc. Tout payé, les
tisserands qui achètent leur lin et le font filer, ne gagnent que 14 à 16
centimes par jour. Pour les toiles très fines, ils gagnent un peu plus.
Les tisserands de Renais ont déclaré qu'en travaillant pour la vente, tout
ce qu'ils peuvent gagner s'élève à 12 centimes par jour.
Flandre occidentale. - Un tisserand de Poperinghe, en
faisant de la toile à 1 franc l'aune, et 6 aunes par jour, peut gagner 36 à 40
centimes par jour, tous frais déduits.
A Avelghem, les tisserands gagnaient autrefois fr. 1 50 c. par jour; leur
gain est aujourd'hui réduit à 63 ou 72 centimes l'un (page 81) en moyenne, et ils sont souvent sans travail. Ils n'ont
pas assez de force pour travailler, ils tombent sur le métier.
A Ardoye, le tisserand estime sa journée de 63 à 72
centimes, après avoir gagné jusqu'à fr. 1 20 c., etc.
Les dépositions recueillies par la commission d'enquête concordent sur les
points suivants :
1° Le salaire des fileuses et des tisserands ne peut plus suffire à leurs
premiers besoins; en général, ils n'ont plus assez pour se vêtir; ils payent
difficilement leur loyer; leur nourriture consiste en pain de seigle et en
pommes de terre; ils logent dans des maisons délabrées et n'ont pas de linge
pour se vêtir et se coucher.
2° Une certaine quantité de métiers chôment, et les fileuses renoncent à
leur état.
3° Quelques tisserands émigrent.
4° Le nombre d'individus à charge des bureaux de bienfaisance augmente
incessamment dans les communes qui s'adonnent à l'industrie linière.
5° La commission a inspecté les habitations d'un assez grand nombre de
tisserands, et a pu se convaincre par elle-même de l'état de dénûment dans
lequel une partie d'entre eux sont tombés. Nous nous bornerons à citer le
résultat de deux de ces visites faites dans les environs de Thielt; il suffira
pour donner une idée de la situation générale des ouvriers liniers dans les
Flandres en 1840, situation qui heureusement s'est un peu améliorée depuis
cette époque.
N..., depuis six ans qu'il travaille, sa situation a toujours été aussi
mauvaise; il travaille à la tâche en recevant deux sous par aune et il peut
faire quatre à cinq aunes par jour, mais il n'a pas de travail d'une manière
courante ; ainsi, l'année passée, il n'a pu faire que trois pièces; quand il ne
tissait pas, il filait ou travaillait aux champs; il exploite un arpent de
terre; pendant un quart de l'année, il travaille dans les champs pour les
autres, et reçoit avec sa nourriture quatre sous par jour; il y a trois ans, il
pouvait gagner cinq à six sous; la filature est plus en souffrance
(page 82) que le tissage ; on ne
paye plus autant, parce que les toiles se vendent mal. Son frère, sa sœur et
lui ne peuvent entreprendre aucun autre métier, puisqu'ils n'en connaissent
pas. N… ne mange jamais de viande; il ne prend pas de café le matin, mais du
thé avec un peu de lait de chèvre; à midi son repas se compose de pain de
seigle, de pommes de terre avec du lait battu; il ne fait usage que de très peu
de beurre, il n'achète jamais de porc que pour en avoir la graisse, il s'impose
beaucoup de privations; mais il y a des gens encore plus malheureux que lui, et
tout récemment il a trouvé le moyen de donner une chemise. Dans toute la
maison, la commission n'a aperçu qu'un seul lit, composé d'une paillasse sans
draps et d'une couverture en étoupe de lin. Cette habitation consiste en deux
pièces; l'une où se trouvent le métier et le lit, l'autre où l'on fait la
cuisine et où l'on file. Pendant tout l'hiver, ces gens ne se chauffent qu'avec
le petit bois qu'ils ramassent; ils travaillent depuis 5 1/2 heures du matin
jusqu'à 10 heures du soir.
N.. ., autre tisserand, travaillant pour son compte. Il travaille depuis 5
1/2 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir. Faisant cinq aunes par
jour, il peut gagner dix sous ; son ménage peut filer une livre de fil par
jour. Sur ses six enfants, deux seulement travaillent avec sa femme : les
petits ne bobinent pas encore; il n'a rien à gagner avec son métier à cause de
la cherté du lin. Ce tisserand, interrogé sur sa manière de vivre, a répondu
que tout était cher, qu'il ne vivait que de pommes de terre, de pain de seigle
et d'un peu de lait battu, qu'il n'avait ni viande, ni bière; qu'il n'avait pas
de travail toute l'année, et que le cultivateur était lui-même obligé de tout
économiser, parce que tout était à un prix si élevé ; qu'il louait sa maison
avec un arpent de terre trente florins par an ; qu'il n'était pas content de sa
situation actuelle. Dans toute la maison, il ne se trouvait qu'un lit fort
étroit, plus dégradé, plus mal garni que le lit de l'habitation précédente. Les
membres de la commission n'ont pas osé demander où se retiraient les six
enfants pendant la nuit; ils ont aperçu à la suite de la cuisine et de (page 83) l'atelier une troisième pièce
sans meubles et fort mal close dans laquelle ne se trouvait aucune trace de
paille, encore moins de matelas; ils ont craint d'apprendre quel était l'usage
de cette dernière chambre.
Les renseignements qui précèdent se rapportent
généralement aux fileuses et aux tisserands qui travaillent sur commande ou
pour le marché; ils ne s'appliquent pas, du moins avec la même étendue, aux
fileuses et aux tisserands pour lesquels le travail linier n'est en quelque
sorte qu'un accessoire subordonné en tous cas au travail agricole.
F. Condition comparée des tisserands flamands
et anglais
La commission d'enquête a cherché à établir une comparaison entre la
situation du tisserand belge et celle du tisserand anglais. Il résulte de ses
calculs qu'en Angleterre, le salaire moyen du tisserand par semaine était, en
1838, d'environ fr. 11 65 c. Il n'est chez nous, au maximum, que de fr.
6 60 c.
Une famille de tisserands en Angleterre, composée de cinq personnes, dont
trois s'utilisent, peut avoir un revenu hebdomadaire de 21 francs. Ce revenu en
Belgique, pour la même famille, ne dépasserait pas fr. 11 70 c.
Depuis 1838, le salaire du tisserand anglais a subi une assez forte baisse;
mais une baisse correspondante a aussi eu lieu en Belgique.
D'autre part, la vie en Angleterre est environ de 25 à 30 p. c. plus chère
qu'en Belgique; mais cette différence n'équivaut pas à la supériorité du
salaire de l'ouvrier anglais, qui est de près de 100 p. c.
En somme, le tisserand anglais est dans une position relativement meilleure
que celle du tisserand belge. Parmi les causes de cette différence, la
commission en indique trois principales :
1° Les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles tissent en Angleterre;
le salaire qu'ils reçoivent pour tisser est supérieur à celui que l'on accorde
à la filature en Belgique. Pour cette raison, (page 84) si le gain du chef de la famille, proportion gardée
avec la dépense, n'est pas plus considérable qu'en Belgique, le gain de la
famille entière est supérieur. La plus grande somme de malheur pour nos
familles de tisserands provient donc de ce que, chez nous, tous les membres de
la famille ne sont pas aussi utilement occupés qu'en Angleterre.
2° L'emploi plus général de la navette volante en
Angleterre permet de faire plus d'ouvrage dans un temps donné. Cette cause se
rattache à la première, car c'est grâce à la navette volante, qui demande moins
de force physique, qu'on a pu mettre les métiers de l'autre côté du détroit
entre les mains des femmes et des enfants.
3° Les ouvriers, soit parce qu'ils sont mieux nourris en Angleterre, soit
pour d'autres causes à rechercher, produisent plus d'ouvrage que la plupart de
nos ouvriers dans un temps donné, et cela indépendamment de l'emploi de la
navette volante. Nous citerons le travail des toiles à voiles, où l'on n'a pas
recours à cette navette.
Voici, au surplus, à cet égard, quelques points de comparaison résumés des
renseignements recueillis par la commission :
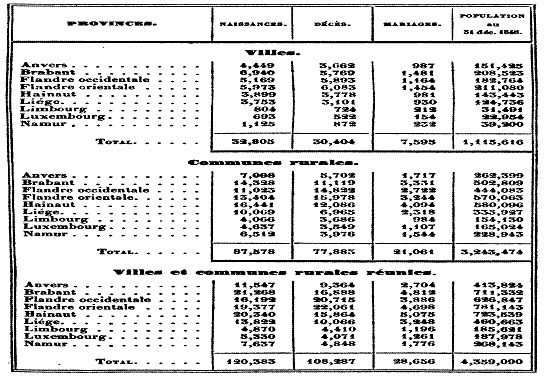
(page 85) Ces
différences considérables ne peuvent s'expliquer que par la supériorité du
métier anglais et par l'emploi de la navette volante, qui permettent à
l'ouvrier anglais de faire, dans un temps donné, plus d'ouvrage que l'ouvrier
belge.
G. Misère croissante des ouvriers liniers dans
les Flandres
Si nous recourons maintenant aux tables des pauvres, nous y trouverons à la
fois la preuve et la conséquence du malaise toujours croissant de l'industrie
linière.
Le relevé suivant concerne spécialement la Flandre orientale, et indique le
nombre des tisserands et des fileuses admis à participer aux secours publics à
diverses époques, depuis 1818 jusqu'à 1848:
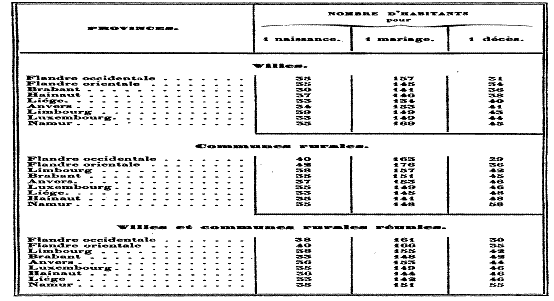
Le nombre des tisserands indigents a donc plus que doublé et celui des fileuses
indigentes plus que triplé dans le cours des trente dernières années. On
remarquera toutefois que le chiffre des premiers s'était abaissé pendant la
période, et que ce n'est que pendant les quatre ou cinq dernières années qu'il
a subi une forte augmentation pour s'abaisser encore en 1848; tandis que
l'appauvrissement des fileuses a été continu et sans intermittences.
(page 86) Dans
la Flandre occidentale, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Le
commissaire de l'arrondissement de Roulers-Thielt, dans son rapport de 1846 à
la députation permanente, a publié des tableaux d'où il résulte que le salaire
moyen des fileuses n'est plus que de 16 centimes et celui des tisserands de 60
centimes : ce seul fait suffit pour expliquer comment le paupérisme s'est
étendu dans cet arrondissement avec une rapidité effrayante et a atteint dans
ces derniers temps une proportion vraiment inouïe.
H. Causes de la décadence et du malaise de
l'industrie linière
Nous venons de décrire la situation de l'industrie linière dans les
Flandres et de passer en revue tous les faits qui attestent sa décadence; il
nous reste maintenant à rechercher et à préciser les causes qui ont pu amener
un si déplorable résultat.
Parmi ces causes, il en est de principales et de secondaires ; les
unes dépendent d'un vice local, les autres de circonstances extérieures. En les
énumérant, nous nous bornerons à quelques indications sommaires, sauf à
reprendre ce sujet lorsque nous discuterons les moyens qui nous paraissent de
nature à remédier au mal (Note de bas de page : La commission d'enquête de
1840, se basant sur les témoignages qu'elle avait recueillis, assignait au
malaise de l'industrie linière les causes suivantes : l'absence de bonne
matière première; la disette de bonnes toiles ou la mauvaise fabrication; une
diminution de consommation des produits manufacturés, surtout le lin, par suite
de l'appauvrissement et du renchérissement des denrées; le progrès de nos
voisins dans la fabrication; pour certains tissus, les tarifs élevés ou même
prohibitifs des pays étrangers; enfin, la concurrence du travail des prisons.
Nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec la commission sur la réalité de
quelques-unes de ces causes, et nous nous expliquerons ultérieurement sur ce
qui concerne la prétendue concurrence du travail des prisons).
(page 87)
L'avénement et les progrès de l'industrie cotonnière ont porté une première
atteinte à l'industrie du lin ; le bon marché du coton a entraîné sa substitution
partielle à la toile pour les usages domestiques. De la la nécessité, pour
soutenir la concurrence et pour rappeler les consommateurs, d'abaisser le prix
des tissus liniers; de là aussi la réduction des salaires des fileuses et des
tisserands.
2. La chute de l'Empire nous a enlevé un marché de 40 millions d'habitants
pour le remplacer par un marché de 5 millions; de 1825 à 1829, la perte des
colonies espagnoles et l'élévation considérable du tarif français amenèrent une
dépréciation nouvelle; la révolution de 1830, la mauvaise récolte de 1833
vinrent augmenter les embarras que l'on essaya de pallier par l'établissement,
en 1834, d'un tarif ayant pour but d'assurer autant que possible le marché
intérieur à notre industrie.
3. Mais ce tarif même contribua, à certains égards, à aggraver la
situation; sans parler des représailles qu'il provoqua de la part de
l'étranger, il fut, si nous pouvons nous exprimer ainsi, l'oreiller sur lequel
s'endormit l'industrie nationale. Alors que le travail du lin s'étendait en se
perfectionnant dans la Grande-Bretagne et l'Irlande, il déclinait en Belgique.
La filature du lin à la mécanique avait déjà complétement remplacé la filature
à la main au delà du détroit, lorsque nous avons songé à ériger chez nous la
première filature digne de ce nom. Nous nous sommes laissé devancer sous tous
les rapports : pour la variété des tissus, pour l'emploi du fil à la mécanique,
du métier perfectionné, de la navette volante, du classement rationnel et du
numérotage des fils, pour le blanchiment et l'apprêt : faut-il s'étonner si
cette longue apathie, si cette routine obstinée a porté ses fruits?
4. Pour soutenir la concurrence à quels moyens a-t-on eu parfois recours ?
On a cherché à économiser sur la matière première, à frauder dans la confection
des tissus : des plaintes se sont élevées, à cet égard, sur nos propres marchés
et elles n'ont pu manquer de trouver de l'écho sur les marchés étrangers. Ces (page 88) tentatives coupables ou
maladroites ont compromis la renommée des toiles belges dans quelques pays, en
favorisant le placement des toiles étrangères qui, bien que frappées du même
vice, avaient au moins pour elles l'apparence et le bon marché.
5. Le défaut d'esprit d'entreprise a contribué à aggraver
cette situation ; jadis le fabricant attendait l'acheteur; il importe
aujourd'hui d'aller au-devant de lui et de le chercher même à de grandes
distances. Les Anglais et les Allemands sont encore nos maîtres sous ce rapport
: ils nous ont devancés; ils ont des expéditeurs, des correspondants, des
maisons de commission sur toute la surface du globe; grâce à l'organisation
dont ils disposent, ils font des affaires considérables là où nous parvenons à
peine à glaner quelques commandes. Aux États-Unis seuls, l'Angleterre a
importé, en 1844, pour près de 25,000,000 de francs (938,392 liv. st.) de fils
et de toiles de lin, tandis que nos exportations pour le même pays ne se sont
élevées, en 1846, qu'à 211 kil. de toile, représentant une valeur de 2,198
francs!
6. Enfin, l'une des principales causes du malaise de notre industrie
linière est l'état d'isolement de la fileuse et du tisserand; de là la
nécessité où ils se trouvent d'acheter la matière première de deuxième ou
troisième main à des prix exagérés, la distribution vicieuse et la division incomplète
du travail, le défaut de concours des divers agents de la production à l'œuvre
collective qu'ils devraient se proposer. A cette cause viennent se rattacher
les vices et les lacunes de l'apprentissage, l'absence de lumières suffisantes
et de direction rationnelle, etc.
(page 89) Nous
ne parlons pas du défaut de débouchés, parce que nous sommes convaincu qu'il
dépend de l'industrie de s'ouvrir de nouvelles voies d'exportation et de lutter
au moins à armes égales avec les produits anglais et allemands sur les marchés
étrangers; ce ne sont pas tant les débouchés qui nous manquent, que les moyens
des les exploiter avec intelligence et profit.
Nous venons de constater la réduction des salaires dans l'industrie
linière, base principale du travail dans les Flandres. Le commissaire de
l'arrondissement de Roulers-Thielt, dans son rapport de 1847, signale aussi, de
son côté, l'abaissement et l'insuffisance du salaire des ouvriers agricoles et
des travailleurs en général. « II y a moins de travail, dit-il, cette année que
l'année dernière. Pour l'industrie, la vente est moins encore en proportion
avec la faculté de production; pour l'agriculture, une économie mal entendue
dans le travail est la tendance générale des chefs d'exploitations.
» Depuis un temps immémorial, le salaire de l'ouvrier-cultivateur était
fixé ici à un taux très bas ; cependant, les malheurs de ces derniers temps ont
amené une baisse nouvelle.
» Avant 1845, la moyenne du salaire, non compris la nourriture, était comme
suit :
« Pour les hommes 60 cent, par jour.
« Pour les femmes 45 cent.
« Aujourd'hui cette moyenne est réduite :
« Pour les hommes, à 52 cent.
« Pour les femmes, à 38 cent.
« La nourriture est évaluée, pour les hommes à 50 c., pour les femmes
à 45 c.
« Le salaire des travailleurs de l'industrie est, depuis quelques années, (page 90)
descendu, dans mon arrondissement, à un taux si minime qu'il ne semblait guère
possible de voir la condition de l'ouvrier subir, sur ce point, une aggravation
quelconque; mais les crises industrielles amènent des conséquences qu'il n'est
donné à personne de prévoir.
« Cette aggravation, qui paraissait impossible, s'est produite.
« Aucune retenue directe n'a été opérée, il est vrai, sur le salaire
déjà trop réduit de nos malheureux ouvriers; mais il y a des maîtres, et ils
sont nombreux, qui, au lieu de payer les salaires en argent, les payent, en
grande partie, en denrées ou en marchandises.
« Ainsi, un abus que nos lois réprimaient il y a plus d'un siècle
(Voir entre autres les mandements du prince-évéque de Liége, des 23 mai 1739,
21 juin et 2 juillet 1746), nous le voyons aujourd'hui reparaître sans qu'il
soit permis de nous y opposer, peut-être même de nous en plaindre!
« .... On peut dire, je le sais, que l'esprit commercial n'est pas
généreux de sa nature. On peut dire qu'abaisser les salaires reconnus
insuffisants, c'est prendre sur le repos déjà trop court laissé au travailleur,
sur la quantité et la qualité d'une alimentation qui le soutient à peine : tout
cela n'est que trop vrai!
« Mais le remède à ces souffrances, l'industriel seul le tient--il
dans les mains? Une cause plus puissante que sa volonté ne détermine-t-elle pas
très souvent sa conduite? Cette cause, la plus énergique aux yeux de tout
négociant, c'est la concurrence.
« II faut soutenir sinon vaincre la concurrence, ou cesser de
travailler : voilà toute la question, telle que la force des choses la pose
aujourd'hui entre le maître et l'ouvrier »
Mais tandis que le salaire demeurait stationnaire ou diminuait, le prix des
denrées allait en augmentant; pendant la période (page 91) signalée par la maladie des pommes de
terre, la hausse qui s'est opérée à cet égard a dépassé toutes les prévisions.
M. Van Damme, dans le rapport cité plus haut, nous en donne la preuve dans le
tableau suivant, qui indique les prix moyens, dans l'arrondissement de
Roulers-Thielt, des principales denrées alimentaires, pour les années 1844,
1845,1846 et le premier trimestre de l'année 1847 :
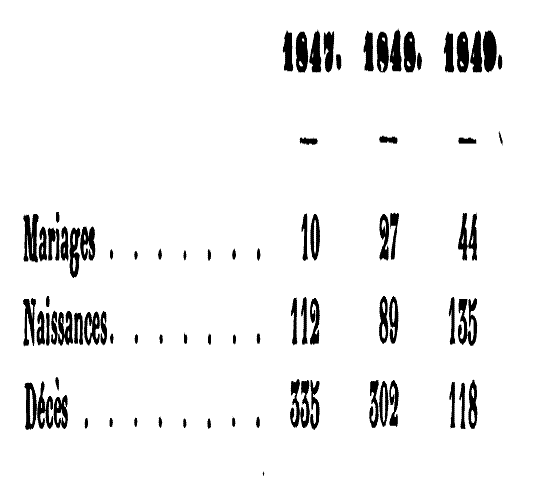
Si nous consultons maintenant les mercuriales des grains dans les deux
Flandres, nous pourrons remarquer un fait déjà signalé par M. Van Damme pour le
royaume entier : c'est que les périodes de hausse et de baisse dans les prix du
froment et du seigle qui se sont succédé avec une régularité vraiment
remarquable, ont constamment laissé ces prix au-dessus de leur point de départ.
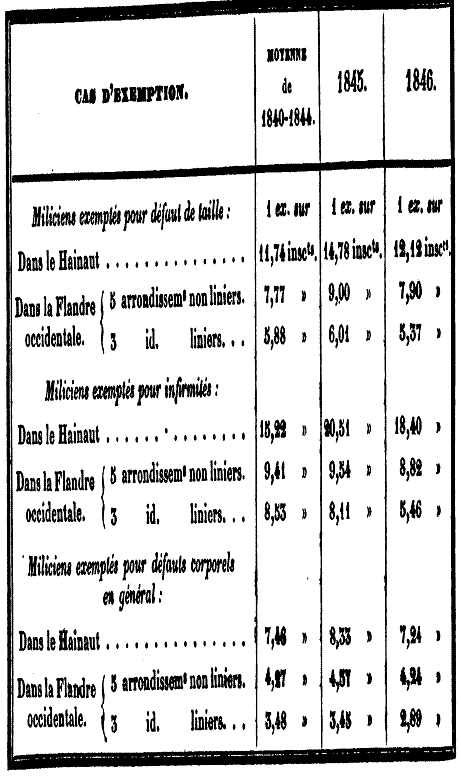
(page 93) En laissant en dehors
de nos calculs les cinq premières années, pour lesquelles nous ne donnons que
les prix pour la Flandre orientale, et en subdivisant les dix-huit années
suivantes en trois périodes de six années chacune, nous trouvons que les prix
moyens des grains dans les deux Flandres se sont élevés, durant chaque période,
aux taux suivants :
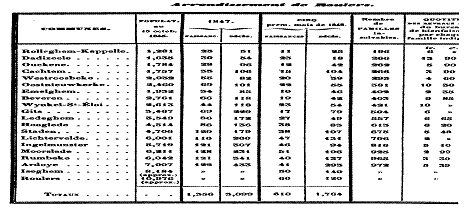
Le prix des pommes de terre a subi une hausse plus considérable encore
pendant la dernière période; le relevé qui suit en indique la proportion :
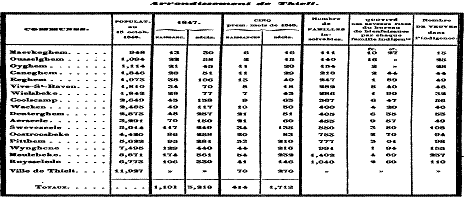
Si l'on se représente que le prix de toutes les autres denrées a dû subir
une augmentation correspondant à celle du grain et des pommes de terre, on
comprendra quelle perte énorme il en est résulté pour la classe ouvrière
pendant les dernières années.
(page 94)
Cette augmentation est avant tout la conséquence fatale des mauvaises récoltes
de 1845 et 1846, et spécialement du fléau qui a atteint les pommes de terre;
mais il faut aussi l'attribuer, du moins en partie, à l'augmentation des
fermages et aux vices de la législation sur les céréales. Au commencement de ce
siècle, on regardait comme un état normal le prix de 12 francs par hectolitre
de froment, et les baux étaient généralement faits d'après cette base. En 1834,
le prix rémunérateur était déjà élevé à 18 francs. La prime d'assurance que la
loi de 1834 avait établie en faveur de l'agriculture, ou plutôt en faveur de la
propriété foncière, s'élevait à fr. 37 50 c. par 1,000 kil. de froment et 21
francs par 1,000 kil. de seigle. Ainsi, en portant à 15 hectolitres, déduction
faite des semences et de la consommation du cultivateur, la portion vendable du
produit d'un hectare de froment, on trouve que chaque hectare de terre recevait
une prime de 45 francs.
Aussi a-t-on vu s'élever rapidement le loyer des terres jusqu'au niveau de cette
prime ajoutée à l'ancien taux des fermages, de telle sorte qu'en définitive,
tout le bénéfice de la loi a été, non pour le cultivateur, mais pour le
propriétaire. Et cette prime, qui l'a payée? Le consommateur, l'ouvrier. Cette
protection exorbitante a duré depuis 1834 jusqu'en 1846, et probablement elle
aurait été maintenue, sinon même augmentée, si la Providence, par un sévère
avertissement, n'était venue arrêter le législateur sur la pente dangereuse où
il s'était engagé.
Les récoltes relativement abondantes de 1847 et 1848 ont amélioré la
situation à certains égards : pendant la dernière de ces deux années, les prix
se sont abaissés, dans la Flandre orientale, pour le froment à fr. 17 46 c.,
pour le seigle à fr. 10 28 c., et pour les pommes de terre à fr. 5 50
c.; dans la Flandre occidentale, pour le froment à fr. 16 48 c., pour le seigle
à fr. 10 41 c., et pour les pommes de terre à fr. 6 12 c. (Exposés de la
situation des provinces de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale en
1848. - Mercuriales). Cette baisse a sans doute apporté un notable
soulagement à la classe ouvrière; (page
95) mais elle peut à son tour faire place à une hausse
nouvelle. Par suite de ces oscillations plus ou moins fréquentes, la position
déjà si précaire de la classe ouvrière reste incessamment menacée; la stabilité
lui échappe. Malgré les alternatives de hausse et de baisse, le taux des
denrées continue sa marche ascendante lorsque l'on compare la moyenne des prix
d'une période avec ceux de la période précédente. Or, les salaires restant le
plus souvent stationnaires lorsqu'ils n'éprouvent pas de réduction, il s'ensuit
que l'équilibre entre les ressources et les besoins se dérange de plus en plus.
C'est là le danger que nous croyons devoir signaler.
§. 7. - Influence des causes
morales. Caractère, habitudes, langage de la population flamande; défaut ou
insuffisance de l'instruction et de l'éducation morale et professionnelle de la
classe ouvrière
La misère des Flandres dépend non seulement de causes physiques, mais
encore de causes morales dont l'étude ne peut être négligée si l'on veut
résoudre complètement le problème qui nous est posé.
Le caractère, les habitudes, le langage, le degré d'intelligence et
d'instruction influent nécessairement sur la situation des travailleurs
flamands. C'est sous ce rapport que l'on peut dire que chaque homme est maître
de sa destinée. Tel peuple placé dans les conditions matérielles les plus
défavorables, s'est cependant élevé, par la seule force de son caractère, de
ses qualités morales, de sa persévérance, à un degré de prospérité supérieur à
celui de tel autre peuple relativement beaucoup plus favorisé par le sol, le
climat et les circonstances extérieures. Tandis que l'Espagne, maîtresse d'une
partie du monde, en possession des plus belles colonies, s'affaissait sur
elle-même et s'abandonnait pour ainsi dire au courant de sa décadence, la
Hollande, circonscrite dans d'humbles limites, sans cesse en lutte contre
l'élément qui semblait conjurer sa perte, marchait d'un pas ferme vers (page 96) ses hautes destinées et venait
se placer au premier rang des puissances européennes.
Qui n'a souvenir de la splendeur des Flandres aux siècles
passés, alors qu'elle étendait ses relations commerciales jusqu'aux limites du
monde connu, que ses villes et ses bourgs regorgeaient de travailleurs actifs,
qu'elle levait des armées et luttait contre des rois, qu'elle initiait les
autres nations aux progrès de son industrie ! C'est qu'alors ces belles
provinces avaient une civilisation qui leur était propre, un stimulant qui
depuis s'est peu à peu affaibli. Des grandes qualités de cette époque, il reste
encore aujourd'hui aux ouvriers flamands leurs vertus privées, leur esprit
d'ordre, leur frugalité, leur patience, leur aptitude spéciale à certains travaux;
mais ce qui leur manque c'est de n'avoir pas compris suffisamment les exigences
d'une civilisation nouvelle. Isolés et immobiles en quelque sorte au sein du
mouvement qui s'opère autour d'eux, fidèles à leurs traditions, à leur langue
comme à leurs vieux procédés, ils devaient souffrir les premiers des crises
périodiques qui atteignent le travail.
Lorsque l'ouvrier anglais ou allemand voit décliner le travail et
s'approcher la misère, il cherche à échapper au danger en transformant son
industrie, en demandant ailleurs les moyens d'occupation qui viennent à manquer
chez lui ; il s'ingénie pour se tirer d'embarras; il lutte jusqu'au bout :
l'ouvrier flamand, au contraire, se résigne sur place aux plus dures
privations; sans rien changer à ses habitudes, il réduit son ordinaire ;
victime de la routine, il succombe sur son métier sans avoir pensé même à
l'abandonner. Aurait-il d'ailleurs la velléité d'aller demander l'emploi de ses
bras dans une autre province ou dans un autre pays? Il en est le plus souvent
empêché par l'obstacle de la différence du langage; si cet obstacle ne l'arrête
pas, le souvenir du village, de la famille, la nostalgie ne tardent pas à le
ramener à son domicile. On a vainement essayé d'appliquer des ouvriers flamands
aux travaux de terrassement exécutés hors des Flandres ; ils ont renoncé les
uns après les autres aux (page 97) avantages qui leur étaient offerts, préférant aller reprendre le
collier de misère suspendu au foyer domestique.
Nous lisions récemment, dans un des recueils périodiques les plus estimés (Des
causes de la prospérité des États- Unis d'Amérique. Revue britannique; juillet 1848), ce remarquable portrait de
l'ouvrier aux États-Unis d'Amérique : « Fort, vigoureux, intelligent, actif, plein
d'audace et d'énergie, mais en même temps positif et réfléchi, l'Américain est
un travailleur incomparable. Il n'y a pas une difficulté qui le rebute, pas un
obstacle qui l'arrête; on pourrait même dire sans paradoxe que les difficultés
et les obstacles ne sont pour lui qu'une chance de succès de plus en le
stimulant vivement. C'est surtout à lui que s'applique la belle pensée de M.
Guizot : Rien n'est obstacle qui ne soit aussi moyen. Esprit net et
pratique, il tend invariablement à son but par le moyen le plus simple et par
le chemin le plus court; génie inventif, il admet toutes les méthodes, mais à
titre de renseignements et pour avoir le plaisir de les perfectionner;
caractère entreprenant, il ne laisse pas une voie inexplorée, pas une expérience
à faire, pas un procédé à employer; combinant, enfin, dans une rare proportion
l'audace et l'habileté, il aborde les entreprises les plus difficiles sans
trouble, sans hésitation, et les mène à bien, en se jouant de mille obstacles
que tout autre aurait, dès l'abord, considérés comme insurmontables. Patient et
résolu, rien ne le rebute et rien ne l'arrête; homme d'action avant tout, il
est toujours sur la brèche : mieux que Beaumarchais, il pourrait prendre pour
devise : Ma vie est un combat. » Quel contraste entre ce pionnier hardi
et infatigable et le travailleur flamand timide, irrésolu, étranger au progrès,
qui n'a jamais perdu de vue le clocher de sa commune, et qui ne conçoit le plus
souvent de remède à ses maux que dans le faible secours qu'il sollicite du
bureau de bienfaisance ! Là où l'ouvrier américain trouverait un aiguillon, le
Flamand se laisse aller au découragement et à la ruine ; (page 98) l'un se roidit contre l'obstacle, l'autre
lui cède passivement; le premier compte avant tout sur lui-même, l'autre
n'attend de soulagement que de l'aide d'autrui. De là cette rapide décadence
qui attriste nos regards et fait saigner nos cœurs. A quoi servirait de nous
faire illusion ? Le médecin consciencieux ne flatte pas son malade; il se garde
bien d'entretenir son incurie ; pour le sauver, il n'hésite pas, s'il le faut,
à lui dévoiler le danger de sa situation, à le faire opter entre la mort ou la
vie. En agissant ainsi, il remplit un saint devoir. C'est sous l'impression
d'un devoir non moins rigoureux que nous sondons la plaie qui ronge les
Flandres, que nous décrivons les symptômes qui se présentent à nos yeux, que
nous disons à nos frères : Si vous voulez que le Ciel vous vienne en aide,
commencez par vous aider vous-mêmes; votre salut doit dépendre avant tout de
vos propres efforts.
Mais si l'individu est le premier maître et le premier responsable de sa
propre destinée, il faut aussi que la société lui prête son concours, qu'elle
lui fournisse les moyens de libre développement et de progrès. Or, qu'a fait la
société pour conjurer les symptômes qui se produisaient sous ses yeux, pour
ranimer l'énergie de la population flamande, pour combattre chez elle cette
disposition sédentaire, cette tendance à l'isolement qui ne dégénère que trop
souvent en incurable apathie, pour l'initier enfin aux bienfaits et aux
nécessités d'une civilisation plus avancée?
L'instruction surtout, nous voulons parler d'une instruction complète
associée à l'éducation, pouvait aider à atteindre ce but. Nous allons voir ce
qu'est cette instruction, d'abord dans le pays entier, puis dans les provinces
qui font plus spécialement l'objet de notre étude. Ici encore nous puisons nos
renseignements exclusivement aux sources officielles (Appendice au rapport
sur l'instruction primaire, transmis par le Ministre de l'intérieur à la
Chambre des Représentants, le 27 novembre 1847. - Exposés annuels des
députations permanentes des conseils provinciaux, 1845 à 1849).
Au 31 décembre 1845, les écoles primaires communales, (page 99) adoptées ou subsidiées et privées, et les
pensionnats du royaume, étaient fréquentés par 438,800 enfants, savoir :
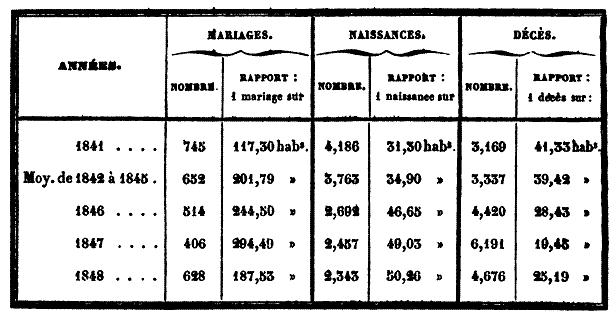
La population du royaume était, à la même date, de 4,298,562 habitants; en
conséquence, le nombre des enfants qui fréquentaient, en 1845, les écoles
primaires et les pensionnats s'élevait à un peu plus du dixième de la
population.
Le nombre d'élèves dans les deux Flandres s'élevait à la même époque :
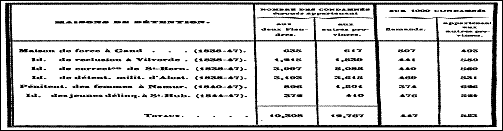
Le rapport du nombre des élèves à la population était donc :
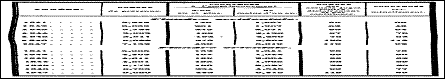
Ces rapports ne s'éloignent pas sensiblement de celui qui a été constaté
pour le royaume entier. Pour apprécier jusqu'à quel point ils correspondent à
la population, il nous suffira de les mettre en parallèle avec le nombre des
enfants âgés de 7 à 14 ans, et jugés aptes, par conséquent, à participer à la (page 100) fréquentation
des écoles primaires et des institutions analogues.
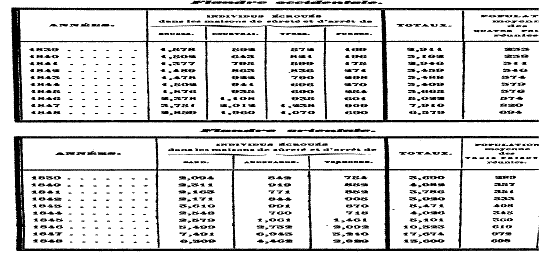
Si l'on compare ces chiffres, on trouve que le nombre des enfants âgés de 7
à 14 ans, qui, en 1845-1846, ne fréquentaient pas les écoles, s'élevait :
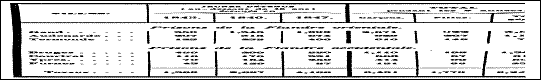
Ainsi donc, 178,700 enfants dans le royaume et près de (page 101) 70,000
enfants dans les deux Flandres seules sont probablement privés de toute
instruction.
Les relevés pour 1845 nous donnent le chiffre des enfants et clés jeunes
gens qui fréquentaient les établissements auxiliaires d'instruction au 31
décembre de la même année :
Écoles gardiennes 18,754
Écoles dominicales ou méridiennes 169,706
Ouvroirs, écoles-manufactures et ateliers de charité 35,996
Total 224,436
Mais il est évident que ces établissements ne peuvent suppléer que très
imparfaitement à l'absence de l'instruction primaire proprement dite. Les
écoles gardiennes ne reçoivent, en effet, que les enfants au-dessous de l'âge
de 6 ans. L'enseignement dans les écoles dominicales se borne d'ordinaire au
catéchisme et à la religion; et dans les ouvroirs, les écoles-manufactures et
les ateliers de charité, l'instruction scolaire est subordonnée au travail,
lorsque même elle ne fait pas entièrement défaut.
Cependant on remarque avec satisfaction que l'instruction se propage,
quoique lentement, dans les rangs de la classe indigente. Nous voyons, en
effet, dans le Rapport triennal sur l'instruction primaire, présenté aux
Chambres législatives le 20 novembre 1846, que le nombre des enfants pauvres,
inscrit dans les neuf provinces, pour participer au bienfait de l'instruction
gratuite, était :
En 1842-1843, de 159,238
En 1843-1844, de 184,119
En 1845-1846, de 189,562
Dans les Flandres, ce progrès s'est fait sentir aussi depuis quelques
années.
Dans la Flandre occidentale, le nombre des élèves dans les écoles primaires,
au 31 décembre 1845, était de 64,973; au 31 décembre 1848, il s'élevait à
66,788, répartis dans 759 écoles. Il y avait, en outre, à cette dernière
époque, 185 écoles dominicales, fréquentées par 56,812 enfants, et 40 écoles
gardiennes, fréquentées par 2,546 enfants.
Dans (page 102) la Flandre
orientale, le nombre des élèves dans les écoles primaires était, au 31 décembre
1845, de 64,434; il s'élevait à 67,826 au 31 décembre 1848, répartis dans 754
écoles. Cette augmentation n'est pas bien considérable, sans doute, mais elle
prouve cependant que les parents et les communes se pénètrent de plus en plus
des bienfaits de l'instruction primaire.
Quant aux écoles gardiennes, aux écoles dominicales et aux
écoles-manufactures, établies dans ces deux provinces, on peut leur appliquer
les observations que nous avons faites en ce qui concerne l'influence exercée
par ces établissements dans le pays entier. Les écoles gardiennes, à
l'exception de celles de Bruges et d'Ypres, ne sont pour la plupart que des asiles
où les jeunes enfants sont gardés pendant une partie de la journée sans
recevoir aucune espèce d'instruction. Les écoles-manufactures se sont
multipliées dans les Flandres, surtout pendant les dernières années : en 1845,
la Flandre orientale en possédait 198, fréquentées par 12,932 enfants des deux
sexes. Dans la Flandre occidentale, leur nombre s'élevait, la même année, à
375, fréquentées par 19,827 enfants. Mais, comme nous l'avons dit, ces
écoles-manufactures doivent plutôt être rangées dans la catégorie des ateliers
d'apprentissage, et n'exercent d'ailleurs qu'une influence très secondaire sur
l'instruction et l'éducation des élèves qui y sont admis.
Il nous reste maintenant à apprécier les résultats de
l'ensemble des mesures prises en faveur de l'instruction populaire, à vérifier
si ces mesures sont suffisantes et si elles remplissent leur but en dotant
effectivement la généralité des jeunes gens de la somme de connaissances
élémentaires indispensables à tout citoyen, quelle que soit la position qu'il
occupe dans la société. Les éléments de cette vérification se trouvent dans les
examens que l'on fait subir aux jeunes gens appelés à participer au service
militaire.
Dans le rapport triennal cité plus haut (tom. II, p. 733-735), nous
trouvons les indications suivantes concernant le degré d'instruction des
miliciens dans le royaume, pendant les trois années 1843, 1844 et 1845:
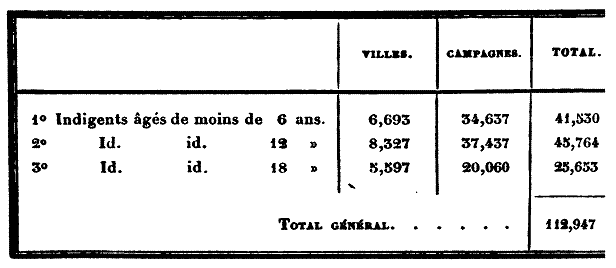
(page 103) Il
résulte de ce relevé que sur quatre miliciens, il en est un à peine qui,
parvenu à l'âge de 18 ans, possède complétement les notions élémentaires
enseignées dans les écoles du premier degré, c'est-à-dire qui sache lire,
écrire et calculer. Un sur deux seulement sait lire et écrire, et 42 sur 100
sont dénués de toute espèce d'instruction.
Dans le tableau qui suit et qui ne se rapporte qu'aux deux Flandres, nous
avons distingué les villes des communes rurales, en mettant en parallèle les
résultats constatés en 1843 et 1847 :
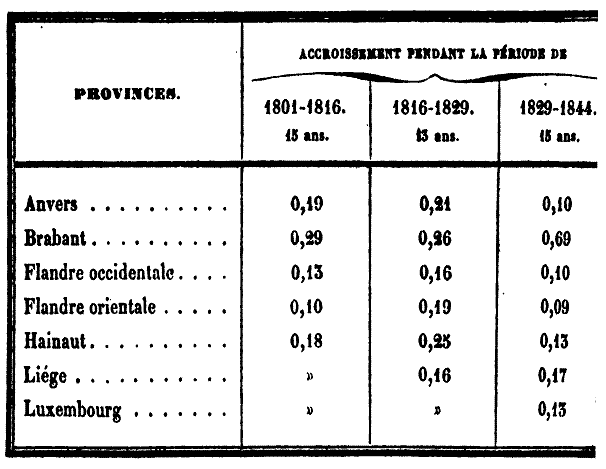
(page 104) On
voit que l'instruction est généralement beaucoup moins répandue dans les
campagnes que dans les villes, et que sur 100 jeunes gens qui ont participé, en
1847, au tirage, il n'y en avait pas même un sur cinq qui sût lire,
écrire et calculer (Note de bas de page : Ce résultat, quelque défavorable
qu'il soit, l'est cependant moins encore que celui que nous trouvons dans le
rapport de la commission chargée de faire une enquête sur la condition de la
classe ouvrière et de préparer un projet de loi sur le travail des enfants.
Cette commission, après avoir dépouillé les renseignements que lui avaient
fournis un certain nombre d'industriels relativement au degré d'instruction de
leurs ouvriers, a constaté que sur 100 ouvriers des deux sexes, il y en a 65
qui ne savent ni lire ni écrire, 25 qui savent lire ou lire et écrire
imparfaitement, et un dixième seulement qui savent bien lire, écrire et
calculer. En prenant à part les ouvrières, on en trouve, sur 100, 72 qui ne
savent ni lire ni écrire, 23 qui savent lire seulement ou lire et écrire
imparfaitement, et enfin 5, ou un vingtième à peine, qui possèdent une
instruction primaire complète. Et, chose plus déplorable encore, on a reconnu
que la jeune génération est plus ignorante que son aînée).
On remarque, d'une autre part, que
l'état de l'instruction des miliciens tend à s'améliorer; mais on voudrait
pouvoir se convaincre que cette amélioration comprend l'instruction des
ouvriers comme celle des jeunes gens appartenant aux autres classes de la
population. Malheureusement les relevés officiels ne font aucune distinction
qui nous permette d'apprécier leurs progrès respectifs : il serait à désirer
que cette lacune fût remplie à l'avenir.
Quoi qu'il en soit, les données que nous venons de résumer succinctement
suffisent pour établir à l'évidence, selon nous, qu'une partie notable des
enfants et des jeunes gens de la classe laborieuse reste plongée dans une
complète ignorance, et que la plupart de ceux qui ont fréquenté plus ou moins
longtemps les écoles ne tardent pas à perdre le fruit et jusqu'au souvenir de
ce premier enseignement.
Si cette observation est vraie pour le pays entier, à plus forte raison
s'applique-t-elle aux provinces flamandes. Sans aucun doute, le défaut
d'instruction contribue à aggraver la position (page 105) de leurs ouvriers ; il les met dans la dépendance absolue
des événements sans que leur intelligence puisse s'élever à la connaissance des
moyens qui pourraient leur venir en aide. L'ignorance sous ce rapport devient
l'auxiliaire du paupérisme
et de la criminalité.
On est généralement d'accord
sur ce fait, que le système des secours publics a été impuissant pour arrêter l'accroissement
de la misère dans les Flandres.
« Partout, dit M. le
commissaire de l'arrondissement de Roulers-Thielt, dans son rapport de 1847,
partout les charges communales sont montées à un taux extrêmement élevé;
« Toutes les
administrations ont été obligées, depuis peu d'années, d'engager l'avenir, en
recourant au moyen ruineux de l'emprunt ;
« La charité privée a été
mise à contribution sous toutes les formes : souscriptions volontaires, quêtes
à domicile et dans les églises, expositions publiques d'objets d'art, loteries,
fêtes au profit des indigents : tout a été employé;
« L'État et la province,
sortant des règles ordinaires, ont voté des sommes considérables, pour suppléer
à l'insuffisance de ces revenus.
« Cependant, toutes ces
ressources créées avec tant de zèle, n'ont pas été capables de combler le
gouffre toujours béant du paupérisme.
« La plaie du déficit,
loin de se cicatriser, loin de se resserrer, continue à s'élargir.
« A mesure que les
charges communales augmentent, le nombre des contribuables diminue »
Dans la première partie de ce mémoire, nous
avons établi que la totalité des dépenses de la bienfaisance publique dans les
deux Flandres,
était, en 1828, de 2,948,566 francs, et qu'elle s'est élevée, en
1847, à 5,626,913 francs; durant la même période de (page 106)
19 ans, le nombre des indigents secourus s'est élevé de 169,379 à
453,658. La quotité moyenne des secours de tous genres pour chaque indigent
était de fr. 17 41 c. en 1828, et seulement de fr. 12 40 c. en 1847.
Les revenus
ordinaires des hospices et des bureaux de bienfaisance n'ont subi qu'un
très-faible accroissement pendant le même intervalle; il s'ensuit que la
différence entre ces revenus et le montant des dépenses doit être couverte au
moyen des subsides des communes, des collectes et des emprunts. En 1847, la
somme de ces ressources extraordinaires a dépassé 2,900,000 francs.
En admettant que ces charges
continuent à augmenter, et ce résultat est infaillible si l'on persiste à
suivre les mêmes errements, on peut dès à présent prédire l'époque, et elle
sera prochaine, où la richesse des deux Flandres sera
frappée à sa source et où le capital qui seul peut leur venir en aide, sera
absorbé peu à peu pour faire face aux besoins de chaque jour. De là un
appauvrissement qui s'étendra de proche en proche pour devenir général. La taxe
des pauvres, cette plaie de l'Angleterre, aura son équivalent dans les Flandres, mais
avec cette différence qu'elle n'affecte encore chez nos voisins que la
propriété immobilière, tandis que chez nous, elle embrasserait dans sa fatale
étreinte toutes les fortunes, toutes les sources de revenus, et pèserait sur le
boutiquier, le marchand, le fabricant, comme sur le propriétaire et le rentier.
Le danger existe ; il est de
notre devoir de le signaler. Il doit, à certains égards, être attribué aux
efforts mêmes mis en œuvre pour venir en aide aux indigents.
La bienfaisance publique est
certes une nécessité, et nul moins que nous ne contestera l'obligation de
soulager la misère, d'alléger les souffrances de toute nature; cette obligation
est imposée à tout homme en particulier; elle l'est aussi, dans une certaine
mesure, à la commune, à la province, à l'État. Le point essentiel n'est pas de
déterminer ses limites, mais bien de définir son caractère.
(page 107) Il y a deux sortes de
charité; la charité qui se borne à l'aumône, qui se contente d'assurer
l'existence du pauvre, et la charité qui, tout en satisfaisant aux besoins du
présent, s'attache aussi à prévoir les nécessités de l'avenir : la première
croit avoir satisfait à sa mission lorsqu'elle a assuré à l'indigent, dans la
mesure des ressources dont elle dispose, un supplément d'aliments, quelques
hardes, du chauffage, des secours en cas de maladie; la seconde, remontant aux
causes de la misère, met tout en œuvre pour la combattre; prévoyante avant
tout, elle sait résister aux entraînements généreux mais aveugles; elle calcule
chacun de ses actes, et s'abstient de tout ce qui pourrait aggraver le mal sous
l'apparence trompeuse d'un soulagement momentané.
Dans les Flandres, comme
généralement dans le reste du pays, la charité de prévoyance, si nous pouvons
l'appeler ainsi, a été malheureusement et est encore subordonnée à la charité
qui se borne à l'aumône. L'action des bureaux de bienfaisance et des hospices ne
sort guère du cercle des besoins journaliers; leur rôle consiste le plus
souvent à assurer la répartition des secours entre les indigents qui se
présentent, et à mettre ces secours en rapport avec les besoins présumés. Il
s'ensuit que le nombre des individus qui demandent à participer aux secours
augmente incessamment ; séduits par l'appât d'un revenu qu'ils considèrent
comme leur propriété commune et dont ils s'exagèrent l'importance, tous
s'empressent de faire valoir leurs droits au partage. Les habitudes d'oisiveté,
de désordre, d'imprévoyance s'enracinent et se propagent ainsi dans la classe
indigente. L'ouvrier qui, obligé de compter avant tout sur lui-même, lutterait
peut-être avec succès contre l'adversité qui le menace, n'hésite pas, entraîné
qu'il est par l'exemple, à tendre la main au bureau de bienfaisance ; il tombe
dès lors dans la catégorie des indigents secourus et vient grossir le chiffre
du paupérisme
officiel.
Cette première chute en
entraîne bientôt une seconde ; les ressources des bureaux de bienfaisance sont
restreintes; les secours sont insuffisants ; alors le pauvre, réduit à la
dernière
(page 108) extrémité, va frapper à
la porte du dépôt de mendicité; si l'encombrement qui y existe le plus souvent ne
permet pas de l'admettre, poussé par le désespoir et la faim, il mendie ou il
vole pour trouver enfin un asile dans la prison.
Cette
gradation est pour ainsi dire inévitable sous l'influence de notre système de
secours publics ; après avoir exalté les espérances, il aboutit à l'abandon. De
là le paupérisme
avec ses funestes conséquences; de là les familles qui se
transmettent, comme un héritage, leur inscription sur les registres de la
bienfaisance publique ; de là le grand nombre d'indigents déclassés qui, après
avoir une fois mis les pieds dans un dépôt ou une prison, ne parviennent plus à
reprendre leur place au foyer domestique et imposent à la société le fardeau de
leur entretien.
Ce mal est profond dans les Flandres et
il s'est sensiblement aggravé depuis quelques années; les subsides accordés par
l'État, loin d'y porter remède, ont contribué au contraire à l'alimenter à
certains égards. Répartis d'ordinaire en raison du nombre d'indigents inscrits
dans chaque localité, quel soulagement réel apportent-ils à la position de
ceux-ci? Un million distribué entre 400,000 indigents donne par tête fr. 2 50
c., à peu près l'équivalent de deux journées de travail. Affectez la même somme
à l'œuvre de la prévoyance, et son bénéfice sera décuplé en raison de l'utilité
de son emploi.
Ce serait donc une grave
erreur que de se reposer sur l'action des établissements de charité et sur
l'aumône pour améliorer la condition des Flandres; ce
palliatif a fait son temps; ses résultats nous prouvent que la charité ne peut
atteindre désormais son but qu'en l'associant à la prévoyance, et que le mode
vicieux des secours publics a peut-être produit, en définitive, des
conséquences plus désastreuses que n'aurait pu le faire l'absence de toute
assistance légale.