de Moreau Alphonse (1840-1911)
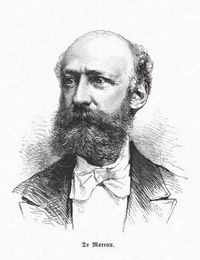
de Moreau Alphonse, Marie, Joseph, Ghislain catholique
né en 1840 à Andoy décédé en 1911 à Ottignies
Ministre (affaires étrangères, agriculture, industrie et travaux publics) entre 1884 et 1888 Représentant 1876-1894 , élu par l'arrondissement de NamurBiographie
(VAN DER SMISSEN Edouard, Le baron de Moreau, dans La Revue Générale, Bruxelles, J. Goemaere, 1911, t. 94, pp. 801-824, partim)
Qui, à Bruxelles, ne se rappelle l'aspect extérieur de celui à qui je viens rendre l'hommage des catholiques belges, sa taille élevée et élégante, sa physionomie vénérable et charmante à la fois, son regard surtout, tendre et grave en même temps?
Une délicate main de femme a tracé du baron de Moreau un portrait moral, aux teintes légères comme celles d'un pastel, dont je veux faire le frontispice de ces notes. « Cette figure spirituelle et douce de gentilhomme et de chrétien est de celles dont la rencontre dans la vie frappe, dont l'influence s'exerce sur ceux qui l'approchent et dont le souvenir ne s'efface pas. Il n'y avait en lui rien de banal ; tout de suite on était conquis par sa bonté si fine, par le charme de son indulgence qui faisait qu'on l'aimait et qu'on se sentait près de lui en confiance. » Les lecteurs de la Revue Générale ne reconnaîtront-ils pas la manière du peintre en même temps qu'ils loueront la frappante ressemblance du portrait ?
Alphonse-Marie-Joseph-Ghislain de Moreau naquit le 8 mars 1840 au château d'Andoy, près de Namur ; il était fils du chevalier Adolphe de Moreau et de la baronne Pauline de Goër de Herve. Sa famille avait toujours occupé une situation des plus considérées dans le Pays de Liége et le Pays de Namur. Elle se divisait en deux branches dont l'aînée portait le titre de baron qui fut repris par la branche cadette, celle du chevalier de Moreau, après l'extinction de la première.
On peut appliquer à ses premières années les paroles que prononçait, le 4 septembre 1877, Mgr Cartuyvels dans l'oraison funèbre de Mgr de Moreau, frère aîné d'Alphonse : « Il trouva réunies autour de son berceau toutes les conditions du bonheur terrestre aussi bien que toutes les salutaires influences d'un foyer (page 802) catholique. Aux traditions de foi et de courage héréditaires dans sa race, les soins d'une mère pieuse ajoutèrent le bienfait d'une éducation première foncièrement chrétienne. Toutefois cette nature heureuse, épanouie au milieu des sourires, devait recevoir bientôt la visite de la grâce sous les traits austères de la douleur. A peine en âge de connaître son père, il éprouva la désolation de sa perte prématurée. »
Alphonse avait alors huit ans. Son père avait confié la tutelle à un ami très cher le chanoine de Montpellier. Le futur évêque de Liége s'occupa dès lors de l'éducation d'Alphonse, de concert avec le frère aîné de celui-ci et avec sa mère, femme d'une haute intelligence.
Après ses études moyennes, faites au collège N. D. de la Paix à Namur, Alphonse de Moreau fut un brillant élève de l'université de Liége, où il conquit avec grande distinction le diplôme de docteur en droit, le 24 août 1864.
De son séjour à Liége datent les premières manifestations du penchant qui l'entraîna toute sa vie vers l'étude des questions sociales. Il y fut parmi les organisateurs les plus actifs d'un des premiers cercles ouvriers fondés dans notre pays, et fit devant les membres de ce cercle et devant ses camarades de l'université plusieurs conférences relatives à cet objet favori de ses préoccupations.
Il fit ensuite un séjour à Rome où il entra en relations avec beaucoup de personnalités marquantes. Il séjourna souvent à Paris où il connut Le Play, Charles de Ribbe et Claudio Jannet.
Il fut amené ainsi à écrire le livre qui le fit connaître du grand public. D'après une lettre de Le Play au jeune sociologue, on peut conjecturer que le chevalier Alphonse de Moreau, conquis déjà par le charme du maître, n'adhéra point sans hésitation à la réforme dont Le Play fait la pierre angulaire de son système, celle de la législation successorale. Ce qui est sûr c'est qu'une fois converti il montra l'ardeur des néophytes et résolut de consacrer un livre au Testament selon la pratique des familles stables et prospères. Tel est le titre de l'ouvrage, titre que Le Play lui-même proposa à l'auteur. Celui-ci y étudie sous toutes les faces le grave problème de la liberté testamentaire dont il se montre partisan dans certaines conditions. Ce problème est de trop d'envergure pour qu'on puisse en disserter ici ; il suffira de dire que le chevalier de Moreau le traitant se montra logicien impeccable et observateur sagace autant que moraliste averti (…)
Le livre du chevalier de Moreau marque une étape de sa belle et utile carrière. Il a été pour le futur ministre l'occasion d'observer et de réfléchir et aussi de traduire au dehors ses impressions. Dès lors nous connaissons et lui-même et sa manière de comprendre son époque. Par sa race comme par sa première éducation il devait être et il fut, en effet, un traditionaliste. Mais le contact de Le Play et sa nature généreuse autant que réfléchie le firent libéral et méthodique. L'emploi de la méthode scientifique tempéra et modernisa son goût pour la tradition, le préparant à être, au cours de sa vie politique, un défenseur de la liberté (…)
Mon distingué collègue, M. Charles De Jace, étudiera ailleurs l'action sociale d'Alphonse de Moreau. Je n'en dirai donc qu'un mot.
Quand l'abbé Henry prit avec Victor Brants et Charles De Jace l'initiative de fonder en Belgique une société d'économie sociale et de donner ainsi une sœur cadette à la grande société qui groupait à Paris l'École de Le Play, ils songèrent tout de suite au chevalier de Moreau pour en être le président.
M. de Moreau fut très fidèle à la société belge d'économie sociale, comme à toutes les tâches qu'il entreprenait, et il présida pendant plusieurs années la plupart des séances. Comme me l'écrivait ces jours-ci M. De Jace, son tact et sa distinction de grand seigneur ont donné, dès le début, aux discussions de la société le caractère de bon ton qu'elles ont toujours conservé.
C'est aussi le chevalier de Moreau qui traça à la société nouvelle sa voie, celle des enquêtes sociales, qu'elle a toujours suivie. Et il n'est pas de commentaire plus adéquat à l'ensemble de ses travaux que le discours prononcé par M. de Moreau, lors du XXV anniversaire, en qualité de président d'honneur, haute fonction à laquelle il avait été élu après son entrée au ministère.
Lorsque fut fondée la société belge d'économie sociale, le chevalier de Moreau avait commencé, depuis plusieurs années déjà, sa carrière d'homme public. Initié aux fonctions administratives par ses fonctions de bourgmestre de sa commune, puis de conseiller provincial, il entra à la Chambre à la suite des élections de 1876.
Il était envoyé au Parlement par l'arrondissement de Namur, qu'il représenta sans interruption jusqu'en 1894, et dont il défendit constamment les intérêts avec une ardeur qui ne connut d'autres limites que son attachement aux intérêts supérieurs du pays. Agé pour lors de trente-six ans, préparé déjà aux assemblées politiques par un stage de six années au conseil provincial de Namur où il s'était fait une place remarquée, présentant un type parfait de gentilhomme dans sa simplicité courtoise et sa distinction mêlée de bonhomie, il conquit immédiatement les sympathies de ses collègues.
Pendant les deux premières sessions de sa carrière parlementaire, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée aux affaires du cabinet libéral de 1878, il intervint peu dans les discussions sur les questions de politique générale, mais déjà, deux mois après son entrée à la Chambre, il était désigné comme rapporteur de la section centrale chargée d'examiner le projet de loi révisant la loi communale, en vue de renforcer le pouvoir de contrôle et de coercition de l'autorité provinciale sur les communes, en matière financière. Il défendit avec vigueur, au cours de la discussion, le principe absolu de l'autonomie communale, contre le gouvernement soutenu par MM. Woeste, Tesch et Anspach, tandis qu'il était lui-même encouragé par MM. Pirmez, Guillery et Victor Jacobs, et il obtint le vote d'un texte de conciliation qui mit presque tout le monde d'accord. Au cours de la même session, il intervint pour faire admettre divers amendements au projet de loi sur la liberté du vote.
Pendant la session suivante, le jeune député fut nommé rapporteur de la section centrale qui examinait le projet de révision du code électoral en vue d'assurer le secret du vote et la répression des fraudes électorales ; il prit une part prépondérante à cet important débat. Il intervint encore dans plusieurs autres discussions au cours de cette session.
En juin 1878, le cabinet Malou démissionna à la suite des élections et les libéraux arrivèrent au pouvoir.
C'est dans l'opposition que M. de Moreau, comme la plupart des hommes qui se sont illustrés dans la politique, s'est véritablement formé à la vie parlementaire. Il fut chargé de mener la première attaque contre le cabinet libéral lorsque celui-ci se présenta devant la Chambre. La tâche était assez ardue pour un jeune parlementaire ; il s'en tira avec le plus grand honneur. Le cabinet avait débuté en sollicitant un crédit pour la création du ministère de l'instruction publique. M. de Moreau le combattit dans un discours où se retrouvent à la fois son amour de la liberté et sa clairvoyance politique. Le nouveau ministère, et les tendances que révèle sa création, l'inquiètent. « C'est parce que nous sommes partisans dans une certaine mesure de l'enseignement officiel, parce que nous le croyons établi par la Constitution et parce que nous comprenons les services réels qu'il a rendus à la Belgique et sa grande utilité sociale, que nous sommes inquiets sur ses aspirations et sur ses tendances.
« ... C'est parce que nous sommes partisans de l'enseignement officiel que nous nous demandons si, au lieu de le favoriser, on ne va pas lui porter un coup mortel. Si l'on veut avoir des maîtres d'école qui sachent remplir leur devoir, il ne faut pas les gonfler d'orgueil. Il ne faut pas les élever en vue de combattre l'enseignement libre. Il faut à un maître d'école tant de qualités diverses qui se rencontrent rarement chez un laïque, que vous amoindrissez l'enseignement libre, vous vous privez, selon moi, de ces modèles, de cette émulation nécessaire pour maintenir les instituteurs à la hauteur de leur tâche. »
Il montre ensuite que la guerre faite à l'enseignement libre encouragera ceux qui prétendent que la Constitution ne permet pas à l'État d'enseigner, ou du moins qu'il ne peut le faire qu'accessoirement. « Voilà la situation que vous faites à l'enseignement officiel, tandis que jusqu'à présent personne ne conteste le droit de l'Etat, tandis qu'aujourd'hui nous y sommes favorables. Si vous entrez dans une voie funeste, si vous voulez supprimer l'atmosphère religieuse de l'école, alors nous viendrons examiner sérieusement l'article 17 de la Constitution, et nous contesterons le droit de l'Etat. » On ne pouvait prévoir plus exactement toutes les conséquences de la « guerre scolaire » dont la dernière bataille n'est pas livrée.
A partir de ce jour, et jusqu'à la chute du cabinet libéral en 1884, il n'est pas une des grandes discussions politiques à laquelle le chevalier de Moreau n'ait été mêlé, pas un des assauts donnés au ministère de M. Frère-Orban auquel il n'ait pris part. La session de 1878-1879 lui fournit l'occasion de plusieurs discours contre la politique inaugurée par le nouveau cabinet, notamment dans la discussion sur le projet d'adresse en réponse au discours du Trône, et surtout dans celle de la loi sur l'enseignement primaire. Il combat celle-ci avec une ardeur passionnée, la dénonçant à la fois comme une cause certaine de désaffection et de ruine pour l'enseignement officiel, comme un outrage aux convictions de la majorité des Belges, et comme une provocation directe à de graves dissensions intérieures à la veille de la célébration du cinquantième anniversaire de notre indépendance, qui aurait dû se faire par l'union de tous les cœurs.
La session suivante le vit continuer en toutes les occasions qui se présentèrent, la défense de ces principes, particulièrement lors de la discussion du budget de l'instruction publique : il terminait son discours par ces belles paroles : « Au lieu de l'homme tel que l'histoire nous le montre partout, de l'homme agenouillé devant son Dieu, supportant avec résignation et le regard tourné vers le ciel sa condition et ses peines, vous n'avez plus que l'homme en face de l'homme, que l'homme se constituant lui-même devant lui-même la seule autorité qu'il puisse reconnaître, l'homme se faisant le centre et le but de la création, l'homme appelant par chacune de ses aspirations, par chaque souffle de son âme, par chaque battement de son cœur ces trois choses qui s'appellent mutuellement comme l'abîme appelle l'abîme l'indépendance absolue, la possession illimitée, la puissance indéfinie; car n'obéir à personne, s'emparer de tout et jouir indéfiniment, voilà l'idéal unique, l'idéal nécessaire de la société entièrement sécularisée, c'est-à-dire entièrement séparée de son Dieu. Notre voie est toute tracée : nous tâcherons de sauver la liberté de conscience et la liberté d'enseignement qui nous permettent de pallier le mal que vous faites et nous lutterons contre un monopole d'autant plus redoutable qu'il se sert pour la première fois depuis 1830 et cela, ironie amère, à la veille de 1880, d'armes illégales pour entraver nos droits constitutionnels.
» Vous nous avez froissés, Messieurs, dans nos convictions de catholiques et de chrétiens. Nous vous avons supplié de n'en rien faire ; vous ne vous êtes arrêtés devant aucune considération ; et aujourd'hui, au lieu d'apaiser les esprits, vous venez encore les surexciter davantage. »
L'intérêt qu'il portait à la question scolaire ne l'empêchait point de s'occuper activement des autres questions soumises à la Chambre, et notamment des questions agricoles pour lesquelles il marquait une sollicitude toute particulière. Il se fit aussi l'ardent protagoniste de l'extension du service téléphonique et des chemins de fer vicinaux dont l'utilité était alors à peine entrevue.
Pendant les dernières sessions qui précédèrent la chute du cabinet libéral, il prit à plusieurs reprises la parole à l'occasion des nombreux incidents que provoquait l'exécution de la loi scolaire, et en 1880 il prononça un discours remarqué sur la politique extérieure du gouvernement et sur la rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Il faisait partie du petit groupe de députés de droite qui, sous la direction de M. Woeste, était sans cesse sur la brèche, ne laissait passer aucune faute du gouvernement de M. Frère-Orban sans la dénoncer aussitôt avec énergie ; la parole de M. de Moreau, d'ailleurs toujours parfaitement courtoise dans la forme, était souvent d'une ironie singulièrement pénible pour le gouvernement et la majorité. On ne connaissait point alors les violences de langage, encore moins les voies de fait. C'était l'époque, bien éloignée de la nôtre, où un discours de M. de Moreau ayant été salué par les applaudissements de la droite, le président croyait devoir réprouver ces marques d'approbation comme peu conformes aux usages de la Chambre !
Le discours qu'il fit en 1883 sur le budget des cultes, mérite une mention spéciale. Il y établissait, par une étude serrée et approfondie des travaux de l'assemblée constituante de 1789, des négociations du concordat, et des discussions du Congrès national belge, le caractère d'« indemnité » des traitements du clergé. Cette thèse, je crois, n'a été nulle part exposée d'une façon plus complète, du point de vue historique comme du point de vue juridique. Il revint encore sur ce même sujet au cours de la session de 1883-1884.
Son activité parlementaire était loin de se limiter aux questions de politique générale ; il menait en même temps une campagne incessante en faveur de plusieurs questions d'ordre économique qui lui étaient particulièrement chères : l'organisation des chemins de fer vicinaux, l'introduction des méthodes scientifiques dans l'agriculture, les grands travaux de la Meuse, toutes questions qu'il eut la satisfaction de résoudre lui-même, comme ministre de l'agriculture et des travaux publics, peu d'années plus tard.
J'ai insisté sur cette période de la carrière de M. de Moreau ; elle est particulièrement intéressante à méditer au moment où les gauches espèrent atteindre le pouvoir. Illusion peut-être, due à certains résultats du cartel sur le terrain communal, où il devait avoir raison des intentions du législateur de 1895. Quoi qu'il en soit, le rappel des grandes discussions de l'époque où gouverna le dernier cabinet libéral suggère des rapprochements intéressants et aussi des prévisions fondées sur l'expérience.
Les élections depuis 1884 mirent le cabinet libéral en échec. M. Malou fut chargé par le roi de constituer le nouveau ministère. Il offrit au chevalier de Moreau le département des affaires étrangères. Celui-ci ne fit qu'y passer. A la suite des élections communales d'octobre 1884 et du remaniement ministériel dont elles furent l'occasion, M. Beernaert, devenu chef du cabinet et ne pouvant conserver la lourde charge du ministère de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics dont la création était nouvelle, demanda au chevalier de Moreau d'accepter ce portefeuille.
Si courte que fut la carrière du ministre des affaires étrangères du cabinet de juin, elle lui apporta une grande satisfaction, celle de pouvoir rétablir les relations diplomatiques avec le Saint-Siège, dont la rupture consommée par M. Frère-Orban, en 1880, avait provoqué naguère une émouvante protestation du député de Namur. Le geste réparateur qui pour tout catholique eût été un honneur, dut être une grande joie pour le pupille de Mgr de Montpellier, pour le frère du prélat éminent qu'une mort prématurée avait enlevé, à 44 ans, à ses fonctions de doyen du chapitre de la cathédrale de Liège.
Le ministère de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics fut institué par un arrêté royal en date du 16 juin 1884, en vertu duquel les services relatifs à l'agriculture, à l'industrie, aux ponts et chaussées et aux mines, aux sciences, aux lettres et aux beaux-arts furent distraits du ministère de l'intérieur et transférés au nouveau département.
L'administration forestière y a été rattachée par arrêté royal du 20 avril 1885.
Quand le chevalier de Moreau succéda à M. Beernaert à la direction de ce ministère multiforme, il eut tout d'abord à s'occuper de la crise agricole. Il y était préparé. S'il put être le restaurateur de l'agriculture belge, ce fut en appliquant la méthode scientifique qui l'amena à créer le corps des agronomes de l'État et à instaurer les champs d'expérience, tandis qu'il faisait procéder au recensement agricole.
De son ministère dépendait le corps des ingénieurs des mines qui avait rendu déjà et a continué depuis à rendre des services si précieux. Ils sont, selon le statut même de leur institution, les conseillers de l'industrie minière. C'est un rôle analogue qui fut dévolu aux agronomes de l'État. Les concessionnaires de mines. disposent de capitaux et de talents, tandis que les agriculteurs,
généralement dénués de ressources pécuniaires, étaient jusque-là, le plus souvent dénués de connaissances et livrés à eux-mêmes. Les agronomes ont eu pour mission de les instruire sur le sol même, sur les cultures et les engrais, sur les régimes d'alimentation du bétail. Ils ont dû, pour remplir leur mission, se livrer à l'étude du sol, appeler l'expérimentation à leur aide, entreprendre ces essais qui sont la méthode scientifique en action, qui sont dans l'art ce que le rôle de l'hypothèse est dans l'élaboration des théories scientifiques.
Le service rendu à l'agriculture par le ministre était d'autant plus grand que l'agriculture était plus éprouvée. Comme M. Morisseaux le rappelait au XXVe anniversaire de l'institution du service des agronomes de l'Etat, les temps étaient difficiles. « La crise qui étreignait l'agriculture était d'autant plus douloureuse que, peu d'années auparavant, celle-ci avait connu une éclatante prospérité. Puis était venue la concurrence du blé d'Amérique ; puis la dépression de l'industrie ; les prix baissaient, baissaient toujours sans qu'on pût deviner où leur chute s'arrêterait. »
Voici en quels termes M. de Moreau exposait la genèse de l'institution, lors de la manifestation dont il fut l'objet au mois de mai 1910 et au cours de laquelle lui fut offert son portrait peint par le comte de Lalaing.
« Comment est né le corps des agronomes de l'Etat ? Il est né de la double nécessité de vulgariser la science agricole et de démontrer aux hommes de la campagne les ressources immenses qui se trouvent dans l'association. La science ? Un savant du milieu du siècle dernier nous dit : L'agriculteur doit être forcément botaniste, il doit être familiarisé avec la physiologie animale, la chimie, la mécanique, la météorologie, il doit être ingénieur, négociant, spéculateur, et enfin praticien proprement dit !
Soit ! mais était-il possible de faire de tous les agriculteurs des savants de cette envergure? Non, sans doute ! Et cependant la science possède le secret de transformer, de perfectionner la culture et l'élevage et d'enrichir ceux qui s'y consacrent. Que faire?
« Nos agriculteurs connaissent à fond ce que j'appellerai la manutention agricole, ils se donnent mille peines, ils n'épargnent ni force ni vigueur. Ils sont d'excellents praticiens ! Mais comment leur communiquer cette science qui féconderait tant de laborieux et souvent stériles efforts ? La science ! Elle n'est pas seulement dans les laboratoires, ou l'apanage exclusif de quelques professeurs ou écrivains éminents. La science, nous l'avons dans chacun de nos ingénieurs agricoles, c'est de là qu'il faut la faire jaillir. Que dans chaque contrée agricole il y ait donc un ou deux agronomes qui instruisent le cultivateur, l'éleveur, par des données scientifiques simples et d'une application pratique aisée. Que ces agronomes, par des champs d'expérience, des conférences, des conseils personnels, répandent les notions scientifiques essentielles, qu'ils forment un bureau de consultation où l'agriculteur trouvera lumière, aide, assistance. Que ces bureaux renseignent les pouvoirs publics sur les vœux, les desiderata des campagnes, qu'ils fassent connaître les progrès réalisés et ceux qui restent à faire. En un mot, il faut créer dans chaque contrée un foyer d'où rayonne la science et qui reflète en même temps tous les phénomènes de l'activité agricole de la région. Ce foyer, c'est l'agronome de l'État...
« Un fait nouveau s'était produit: l'association avec sa toute-puissance, s'était imposée au monde. On entrevoyait déjà en 1885 quelles réformes on pourrait en tirer pour notre agriculture, mais il importait d'abord d'en faire saisir les avantages et de l'organiser ensuite.
« Les agronomes avaient ici encore une mission bien définie qu'ils surent remplir. Aidés d'hommes de bonne volonté et d'hommes de bien, qui, comme M. Schollaert et tant d'autres, se dévouèrent à la cause de l'association, ils multiplièrent partout les mutualités, notre sol se couvrit de sociétés, grandes et petites, qui firent surgir la richesse et apportèrent le bien-être là où l'individualisme et la routine déprimaient les caractères et paralysaient les courages. De là ce magnifique essor de l'association dans nos campagnes. »
L'institution du service des agronomes de l'Etat avait droit à une mention spéciale, car c'est une mesure à grande portée, à portée sociale en même temps qu'économique, et dont les répercussions heureuses ont été considérables, si toutes ne peuvent être mesurées.
L'agriculture, à peine est-il besoin de le dire, fut de la part du chevalier de Moreau, durant tout le cours de sa gestion ministérielle, l'objet d'une attention toute privilégiée. Les mesures qui la concernent et que prit le chevalier de Moreau sont nombreuses laboratoires agricoles créés à Mons, à Anvers, à Louvain, station agronomique créée à Gembloux, publication du Bulletin de l'Agriculture, expériences pour la culture de la betterave, réductions de tarifs en faveur de l'agriculture, extension et développement de l'enseignement agricole, mesures réglementaires utiles à la culture, reboisement, repeuplement des rivières et des fleuves. Et je n'ai rien dit de l'œuvre législative du ministre loi sur les vices rédhibitoires, code rural, réduction de l'impôt sur les échanges de biens ruraux, loi sur la falsification des engrais, etc.
Cependant, d'autres problèmes réclamaient l'attention du ministre. Dans une circonstance récente il rappelait, avec sa bonne grâce et sa bonne humeur coutumières, combien sa tâche avait été lourde : « S'il n'y avait eu que le ministère de l'agriculture à diriger ! s'écriait-il. Mais d'autres soucis m'incombaient. J'avais les travaux publics : je repris, dans l'intérêt de l'agriculture, de nombreux chemins communaux ; je décrétai la création de nombreux chemins de fer vicinaux...
« L'industrie était aussi dans mes attributions; au début, cela semblait peu de chose et je crois bien que mes prédécesseurs ne s'étaient point douté qu'ils en eussent la direction. Mais voilà que surgit la question sociale : il faut rétablir la paix entre le capital et le travail. Une commission, que j'eus l'honneur de créer et de présider, étudia un vaste programme que tous appelaient de leurs vœux. J'eus à présenter et à défendre au Parlement les premières lois qui figurent dans notre code social, ce code social qui servit de modèle à plus d'une nation étrangère.
« Venait ensuite l'administration des mines : tout y était si bien réglé que j'y allai chercher le modèle du corps des agronomes de l'Etat.
« Enfin, j'ai été chargé de la haute direction des lettres, sciences et beaux-arts. Ce sera, me disait-on en me les confiant, votre repos dans les fatigues. Soit. Mais comme il n'y a pas de roses sans épines, il n'y a pas de science et d'art sans les savants et les artistes, et ceux-là ne sont pas toujours reposants pour un ministre. »
Le ministre ne fut inférieur à aucune de ces tâches.
De la carrière de M. de Moreau, ministre des lettres et des arts, je ne signalerai que deux faits : le vote de la loi sur les droits d'auteur et... un autre.
M. de Moreau, qui était un pur Wallon, et chez qui l'amour passionné qu'il portait à son pays n'avait jamais étouffé une prédilection non déguisée pour sa « petite patrie », son cher pays de Namur, s'est néanmoins toujours défendu, au cours de sa vie politique, d'encourager la triste querelle des langues. C'est de son ministère que date la fondation de l'Académie royale flamande. Lors de l'inauguration de celle-ci, à Gand, il prononça un discours dans lequel, tout en s'excusant de ne pouvoir se servir de la langue flamande, il rendait le plus bel hommage aux chefs-d'œuvre littéraires qu'elle avait enfantés, et il disait: « Votre langue est trop belle, trop bien l'expression de votre caractère, le dirais-je, trop bien la gardienne de vos mœurs, pour que vous ne la cultiviez pas avec soin, pour que vous ne recherchiez point dans un même sentiment d'union tout ce qui peut la développer, la grandir, et mieux frapper de l'empreinte de son génie, l'âme si généreuse de nos populations flamandes. »
Tandis que le malaise agricole était patent quand le chevalier de Moreau fut appelé au gouvernement, celui de l'industrie était latent encore ; bien des hommes avisés ne le voyaient pas.
A la grande école de Le Play, Alphonse de Moreau avait appris que nos sociétés sont souffrantes, que la civilisation n'est point toujours la santé sociale et que la réforme de nos sociétés s'impose.
La crise de 1886 ne le surprit pas. Sur sa proposition et celle du chef du cabinet, M. Beernaert ils contresignèrent ensemble le rapport au Roi prélude de la nomination de la Commission du travail fut instituée cette enquête, application mémorable de la méthode d'observation aux faits sociaux, dont les travaux contiennent en germe toute la législation sociale du dernier quart de siècle.
Elle fut, en effet, le point de départ de la législation sociale belge sous ses multiples aspects, depuis la loi concernant les habitations ouvrières jusqu'à celle qui concerne la réparation des accidents du travail. Toutes ne furent pas votées alors que le chevalier de Moreau était ministre, toutes plongent leurs racines dans ce sol extraordinairement riche : les rapports et les résolutions de la Commission du travail où siégèrent les Pirmez et les Jacobs, les Lagasse et les Morisseaux, les Prins, les Brants, les De Jace.
M. de Moreau eut l'honneur et la charge d'assurer le vote des premières et notamment de la loi sur le paiement des salaires.
On aurait plaisir à étudier de plus près l'activité de M. de Moreau, administrateur. On voudrait donner plus et mieux qu'une mention à la question sociale, aux travaux publics sous son consulat, à l'œuvre législative à laquelle il eut sa part.....
On ferait un tableau bien incomplet de sa carrière ministérielle, si l'on ne mentionnait ici quel souvenir excellent le ministre laissa à tous ceux avec lesquels ses fonctions le mirent en rapport et surtout au personnel des administrations qu'il dirigea.
Il faudrait aussi faire la part de ses collaborateurs, ainsi que M. de Moreau l'a faite lui-même et très largement. Il faudrait dire le concours que lui donnèrent MM. Proost et Cartuyvels, M. Morisseaux, son premier chef de cabinet, M. Julien Nyssens, trop tôt disparu qui succéda à M. Morisseaux quand celui fut nommé directeur de l'industrie. Ils ne purent empêcher que le zèle du chevalier de Moreau ne dépassât ses forces. Sa santé s'ébranla et une grave maladie du larynx, dont une cure de plusieurs mois eut enfin raison, le détermina, en 1888, à se démettre de ses fonctions de ministre du roi.
Sa résolution causa les plus vifs regrets, regrets dont témoigne une correspondance précieuse où je trouve les signatures de Victor Jacobs, de Théophile de Lantsheere, de Charles Woeste et de bien d'autres.
Alphonse Nothomb lui écrivait et je ne saurais mieux dire ni davantage : « Vous quittez le champ de bataille en maître, car vous étiez devenu souverain de votre colossal département, aux Chambres comme au dehors, et la voie des réparations sociales que vous avez ouverte est aussi une voie sacrée. »
Redevenu simple député, M. de Moreau reprit sur les bancs de la droite la place marquante qu'il y occupait avant son entrée au ministère. Dès la première session qui suivit sa démission, et sa santé à peine raffermie, nous le voyons intervenir dans plusieurs débats. La défense de sa gestion ministérielle si complexe, au cours de laquelle il avait eu à résoudre à la fois les questions les plus variées concernant l'agriculture, les travaux publics, l'industrie, les constructions de chemins de fer, les sciences et les arts, lui en fournit l'occasion. La première fois qu'il reprit la parole, ce fut pour défendre les efforts faits par lui en faveur de la littérature belge d'expression française. On l'accusait - le grief était sérieux à cette époque - d'avoir tenté la publication d'une anthologie des littérateurs belges, et, circonstance aggravante, d'avoir nommé parmi les membres du comité chargé de cette publication plusieurs écrivains du groupe de la « Jeune Belgique ». Il fit un joli discours pour se féliciter d'avoir voulu honorer l'une de nos littératures nationales, au même titre qu'il avait, lui Wallon, créé l'Académie royale flamande, et rendit un bel hommage à nos écrivains. On a reproché de nos jours l'excès d'encouragements officiels donnés aux gens de lettres de chez nous, et chose plaisante le reproche vient de plusieurs d'entre ceux-ci. En 1889 l'excès, il faut le reconnaître, était plutôt dans l'autre sens, et il y avait quelque mérite pour M. de Moreau a vouloir réagir contre lui.
A cette première session il intervint encore pour prier le gouvernement de participer à la Conférence sur la législation du travail convoquée par le Conseil fédéral suisse, et fit le rapport sur les projets de loi concernant l'enseignement agricole et vétérinaire, dont il était le véritable promoteur, ainsi que le reconnaissait M. De Bruyn, son successeur au ministère.
A la session suivante il fit, à l'occasion de la discussion du projet de loi sur la collation des grades académiques, un discours remarquable en faveur du maintien des humanités classiques et de l'inscription du cours d'économie sociale dans le programme des études de droit et des mines.
Les sessions qui suivirent le virent toujours prendre une part très active aux discussions du budget de l'agriculture ainsi que de toutes les questions agricoles. Ses compétences financières le faisaient aussi désigner chaque année comme rapporteur du budget de la dette publique, ce qui lui valut quelques belles joutes avec M. Graux.
Vint enfin la discussion sur la révision constitutionnelle. M. de Moreau n'était pas favorable à la révision et il lui en coûtait beaucoup cependant de ne pas suivre son ancien collègue et ami, M. Beernaert, pour lequel il professait une admiration et un dévouement absolus.
Pendant toute la campagne révisionniste et pendant la durée de la constituante, son rôle fut beaucoup plus dans les réunions de la droite qu'à la Chambre même. Sacrifiant ses préférences, il sonna constamment le ralliement autour du cabinet et après une réunion importante, où son intervention avait été particulièrement décisive, M. Beernaert lui envoyait ce billet reconnaissant qui porte la date du 9 février 1893 : « Vous n'avez jamais été aussi bien inspiré, je croyais entendre Jacobs ».
Lorsqu'on aborda à la constituante la discussion du système électoral, M. de Moreau se prononça pour le système dit « de l'habitation ». Le discours qu'il y consacra se terminait par ces mots, où se traduisent ses sympathies d'ancienne date pour le foyer familial : « Je crois, disait-il, avoir établi que le système de l'habitation est juste, qu'il s'appuie sur une base sérieuse et fixe, et qu'il proportionne équitablement entre toutes les branches de l'activité sociale, les avantages de l'électorat. Il est en outre l'application de cette idée si vraie, que l'homme pour être complet, pour être réellement attaché au sol de sa Patrie, doit avoir un foyer, où il puisse se recueillir et où, isolé du reste du monde, mais entouré des affections les plus pures, il puisse scruter du fond de sa conscience les devoirs qui lui incombent comme soutien de sa famille et comme citoyen de son pays! A tous les degrés de l'échelle sociale, la meilleure garantie qu'on puisse chercher sera toujours le foyer, la famille, un domicile aimé et attachant ».
Plus tard, quand il s'agit de la désignation des membres du Sénat, ce fut M. de Moreau qui proposa la désignation des sénateurs par l'élection à deux degrés. Ce système réunit, à droite comme à gauche, d'assez nombreuses sympathies et, repoussé finalement dans son ensemble, il réapparut en une certaine manière dans l'institution des sénateurs dits « provinciaux ».
La session de 1893-1894 fut la dernière de sa carrière parlementaire. Il y présenta encore le rapport sur le budget de la dette publique et sur la convention monétaire de 1893. Il prit aussi une grande part à la discussion du code électoral. On se souvient que c'est au cours de cette discussion, à la suite d'un vote des sections défavorable au système de la représentation proportionnelle, que M. Beernaert, considérant comme un échec personnel l'insuccès de cette réforme à laquelle il s'était si complètement attaché, offrit sa démission, suivi dans sa retraite par M. Le Jeune.
La décision de M. Beernaert surprit la plupart de ses amis qui ne pouvaient croire qu'il se retirerait à la suite d'un vote de sections, et elle provoqua sur les bancs de la droite de très profonds regrets.
M. de Moreau prit la parole pour s'en faire l'interprète dans la première séance qui suivit la démission de M. Beernaert. Après avoir déploré qu'un désaccord sur la question de la représentation proportionnelle eût déterminé le départ de celui-ci, il ajoutait : « Les dissentiments passent vite quand ils ne portent que sur un point. Ce qui reste, ce qui ne peut périr, c'est l'attachement entre les hommes qui ont toujours eu les mêmes principes et défendu la même politique. C'est là ce qui nous fait rendre un légitime hommage au grand talent et aux vues élevées de l'homme d'État qui vient de quitter le pouvoir. »
Les élections de 1894 terminèrent la carrière parlementaire de M. de Moreau, qu'il couronna en présidant, à Anvers, le Congrès de la Paix. Il avait siégé à la Chambre pendant dix-huit ans.
Pour faire revivre la physionomie du baron de Moreau, je ne pouvais mieux faire que de lui laisser la parole. Sur son livre Le Testament, sur ses conceptions sociales et politiques, sur son rôle de ministre et de rénovateur de l'agriculture, sur ses fonctions financières, sur son activité jamais lassée, que de réflexions viennent à l'esprit combien on voudrait s'arrêter, méditer, louer à loisir, ou encore, discuter, car la discussion est un hommage quand elle est sérieuse et courtoise.
Lorsque M. de Moreau fut guéri de la grave maladie qui l'avait obligé à abandonner le ministère, une place de directeur s'étant ouverte à la Banque Nationale, le conseil d'administration le fit pressentir pour lui offrir ces fonctions. Le gouvernement désirait voir l'opinion catholique représentée au sein de ce grand établissement financier qui se trouve constamment associé à la gestion des deniers publics, puisqu'il est le caissier de l'État. M. de Moreau hésita d'abord à accepter les propositions qui lui étaient faites, et ne céda qu'aux instances de ses amis.
M. de Moreau apporta à la direction générale le concours précieux de son expérience, de sa haute culture, de son tact parfait. L'administration de la Banque est réalisée selon le principe de la division du travail ; il eut dans ses attributions particulières le service des fonds publics et celui de l'imprimerie et de la comptabilité des billets.
Il y a peu de chose à dire du premier parce, qu'à l'exemple des nations heureuses, il n'a pas d'histoire. Le second, au contraire, est d'un intérêt tangible pour le public. Le billet a pris dans la circulation une place prépondérante et toujours grandissante, dépassant, et de beaucoup, le rôle des billets des banques d'émission des autres pays : le billet, chez nous, ne sert pas seulement aux grosses transactions, les coupures de vingt francs tiennent la place de l'or.
Voici un chiffre qui en dit long sur le développement de l'émission au cours des vingt-trois années où M. de Moreau en eut la surintendance : tandis que, en 1888, l'on imprimait 6,700 billets environ par jour ouvrable, l'émission journalière a dépassé cette année le nombre de 30,500 billets.
Il s'agit, remarquez-le, de manipulations où l'attention et le contrôle doivent être extrêmes, où la technique est compliquée. M. de Lantsheere, gouverneur de la Banque nationale, expliquait ceci, à l'assemblée des actionnaires qui eut lieu quelques jours après le décès du baron de Moreau. « Le service de l'imprimerie des billets, disait-il, ressemble à un champ de bataille permanent. Il ne suffit pas de maintenir à la circulation un caractère artistique s'améliorant sans cesse. Il importe surtout d'assurer à celle-ci une sécurité qui protège le billet contre l'éternelle contrefaçon, si bien qu'impuissants à réaliser la chimère du billet inimitable, il nous soit du moins possible d'approcher chaque jour davantage de cet idéal.
« La direction de M. de Moreau a été à ce point de vue féconde en progrès. C'est sur sa proposition que fut, en 1894, acquise la première presse à quatre couleurs. Elle fut immédiatement appliquée au billet de 20 francs dont le type est encore en cours. Dès 1906, la Banque se conformant à ses vues, commença l'organisation d'un bureau de dessin appliqué à la technique des billets de banque et d'un atelier de photogravure ».
Qu'il me soit permis de rappeler ici l'hommage rendu dans le même discours à la bonté de M. de Moreau envers le personnel qu'il dirigeait. «< Des cent dix-huit fonctionnaires ou employés de tout ordre dont il avait spécialement la direction, il n'en est aucun, dit M. de Lantsheere, auquel le défunt ne s'intéressât individuellement. Il croyait sa mission plus haute que la simple surveillance de la tâche quotidienne. Bon envers les humbles, il était pour ses égaux d'un commerce égal et agréable. »
Le gouverneur de la Banque, parlant au nom des directeurs de celle-ci, a pu ajouter à cet éloge cette appréciation que ratifieront tous ceux qui ont eu l'honneur et le plaisir d'être les collaborateurs du baron de Moreau en d'autres circonstances : « Chacun de nous se voit enlever à la fois le meilleur des collègues et le plus fidèle des amis. »
Dans les dernières années de sa vie, le baron de Moreau avait renoncé à la vie politique, mais il ne cessa point de s'intéresser à l'économie sociale et rurale, de se dévouer aux œuvres humanitaires, catholiques et patriotiques.
Il voit, non plus de la plaine où l'effort se produit, mais des sommets d'où l'on peut mieux juger les résultats, les choses de la politique et de l'administration, les progrès et les besoins de l'agriculture et du commerce. Nous le retrouvons en 1895 conférencier à Bruxelles où il parle des grands travaux du XIXe siècle, où il célèbre l'avènement ministériel d'Albert Nyssens. Par la suite, il est prêt, chaque fois qu'il le peut, à apporter l'honneur de sa présence et le réconfort de sa parole aux mutualistes, aux ouvriers, aux associations catholiques, aux établissements d'instruction. Appelé à siéger au conseil supérieur de l'agriculture, lorsqu'il quitta le ministère, il devint, en 1901, président de cette assemblée. Il avait été élu, en 1898, président de la société centrale d'agriculture, et ouvrit le congrès agricole de 1900. En 1903, il participe à la manifestation en l'honneur de M. Proost.
Nous le voyons aussi prendre part à l'action de la fédération pour la défense des intérêts belges à l'étranger, dont il fut successivement vice-président et membre d'honneur. Depuis 1906, il présidait la société d'études belgo-japonaises. La même année, il représenta la société belge d'économie sociale à la cérémonie du centenaire de Le Play. Jusqu'à la fin de sa vie il resta l'orateur élégant qu'il avait été dès ses jeunes années : sa parole est toujours charmeuse; ses discours de style châtié, abondant, rythmé, ont grande allure. Il est alors une personnalité éminemment représentative, gardant dans la vieillesse les forces intellectuelles de la maturité.
Je ne dirai qu'un mot de sa vie privée.
Le baron de Moreau eut un foyer charmant. Il avait su se choisir choix où l'homme donne sa mesure en Mademoiselle Gabrielle de Grand Ry, une compagne digne de lui, qui a la douleur de lui survivre. Elle a la consolation, combien douce, de se dire qu'elle a embelli et ennobli son foyer pendant quarante-cinq ans.
Quelle belle lignée aussi que celle du baron Alphonse de Moreau! De ses huit enfants, il n'en perdit qu'un, Edmond, mort officier de la force publique au Congo en 1900 : il eut la joie de voir tous ses fils se vouer à de nobles tâches, au service de Dieu et de la Patrie.
Le baron de Moreau avait souffert, au commencement du printemps dernier, d'une pleurésie dont il était à peu près remis, et s'était rendu chez un de ses fils, à Ottignies, pour y compléter sa convalescence. Mais son état s'empira subitement et, en quelques jours, il fut enlevé à l'affection des siens, le 2 août 1911.
Dès le premier jour de l'aggravation de son mal, il semble qu'il ait eu le pressentiment de sa fin prochaine. A ses enfants et beaux-enfants qui, l'un après l'autre, arrivèrent auprès de lui, il recommanda de rester bons chrétiens. Il reçut avec une ferveur admirable les derniers sacrements des mains de son fils, puis attendit la mort avec calme, offrant à Dieu ses souffrances qui, par moments, étaient très grandes.
Citons un trait qui peint l'âme religieuse du défunt. Les médecins lui avaient fait des injections de morphine, dont il ressentait un grand soulagement. Il s'inquiéta de ce remède, ne jugeant pas qu'il fût bien de diminuer ses souffrances.
Il y a une trentaine d'années, quand sévissait la mode des Confession books, M. de Moreau se vit invité à répondre au questionnaire habituel. En face de la question: Comment désirez-vous mourir ? Il écrivit : « En paix avec Dieu, entouré de mes enfants. » Le Ciel exauça ce vœu. Le baron de Moreau s'éteignit doucement, tandis que sa femme et tous ses enfants et beaux-enfants, agenouillés autour de lui, récitaient les prières des agonisants. Ainsi finit, comme il avait vécu, celui qu'on peut appeler un patriarche de notre temps, qui fut un homme politique d'une distinction presque perdue, modèle d'honnête homme, de citoyen et de chrétien.