Van Meenen Pierre (1772-1858)
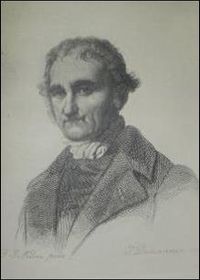
Van Meenen Pierre, François libéral
né en 1772 à Espierres décédé en 1858 à Bruxelles
Représentant 1831-1832 , élu par l'arrondissement de Ypres Congressiste élu par l'arrondissement de LouvainBiographie
(Extrait de : Ch. CHRISTOPHE, Biographie nationale de Belgique, t. XIV, 1897, col. 229-232)
VAN MEENEN (Pierre-François), philosophe, publiciste, magistrat, né à Espierres (Flandre occidentale), le 4 mai 1772, mort à Bruxelles, le 2 mars 1858. Jacques-François, son père, était un honnête paysan, rien de plus ; Anne-Christine Landrier, sa mère, tout simplement une femme d'élite. Elle se chargea de former le cœur et le caractère de ses enfants, et le chef de la famille n'eut qu'à se louer de son abdication. Le fils cadet, notre Pierre-François, devenu octogénaire, consacra, dans une page touchante, le souvenir profond qu'il avait gardé des leçons et des exemples de cette excellente mère. Peut-être expliquerait-on par la même influence l'intérêt particulier que Van Meenen attacha toute sa vie à la première éducation des enfants.
Jacques-François ayant transféré ses pénates à Anserœul, en Hainaut, non loin de Renaix, profita du voisinage de cette ville pour y envoyer son plus jeune fils, destiné à la prêtrise. Trois ans plus tard, il le fit entrer, pour achever ses humanités, au collège du chapitre de Tournai. Le pays s'agitant de plus en plus, grâce aux ordonnances de Joseph II, il jugea prudent de le rappeler au foyer domestique, ce qui entraîna une interruption d'études de deux ans. Ces vacances forcées agirent puissamment sur les dispositions du jeune homme. Il se prit à réfléchir sur les causes de l'ébranlement de l'édifice social. Passionné pour la lecture et trouvant par hasard sous sa main quelques écrits de philosophes français, il en fit ses délices et se laissa insensiblement séduire par leurs hardiesses. Il en était là en 1792, quand l'obtention d'une bourse lui ouvrit les portes de l'université de Louvain.
Il fit son cours de philosophie dans la pédagogie du Lys, s'y distingua, puis, sur la fin de 1793, fut admis comme théologien au collège de Driutius, à la veille d'être transformé en hôpital militaire. Sa bourse lui fit trouver un refuge au collège de Liège : à peine y était-il installé que l'invasion française, en juillet 1794, amena la dispersion des étudiants. Anne-Christine, sur ces entrefaites, avait perdu son mari. Pierre-François rentra cette fois au logis en grand deuil, mais surtout changé au moral, convaincu de la stérilité de l'enseignement philosophique de l'Alma Mater et, d'autre part, mis en garde contre le sensualisme et le matérialisme, alors en vogue, par ses lectures assidues de Bacon, de Descartes, de Spinoza de Leibniz, et peut-être aussi par l'influence du professeur Liebaert, qui paraît avoir trouvé grâce à ses yeux.
Il ne resta pas longtemps au village. Le magistrat de Louvain le délégua à Paris pour y suivre les cours de l'Ecole normale, instituée par décret du 9 brumaire an III (30 octobre 1794). Il passa là six mois environ ; il en revint animé de l'enthousiasme d'un apôtre, grisé des idées nouvelles, ardent révolutionnaire. On le vit, dans une solennité républicaine, prendre la parole dans l'église Saint-Michel, devenue temple de la loi, pour vanter les avantages de l'annexion de la Belgique à la France. L'université ayant rouvert ses cours, on le vit se déclarer ouvertement contre elle dans une brochure où il prenait la défense du décret substituant au congé du dimanche le congé du décadi, mesure devant laquelle eût reculé Joseph II ! Son attitude lui valut la place de secrétaire-greffier de la municipalité de Louvain (1797) ; le contact des affaires lui apprit bientôt à compter avec les mœurs.
Il était encore eu plein enthousiasme lorsque l'université fut supprimée par décret du 4 brumaire an VI (25 octobre 1797). On rapporte qu'il ferma lui-même les portes des Halles : « Voici u, dit-il, au maire, les clefs du temple de l'ignorance. »
Son beau zèle se montra encore dans une pièce de vers en style pompeux, qu'il débita, le 29 janvier 1798, dans la chaire de Saint-Michel, pour célébrer la ratification du traité de CampoFormio. Il commença à voir les choses d'un autre œil, en revanche, lorsque le Directoire exigea du clergé le fameux serment de haine, et que toutes sortes de mesures vexatoires visant l'ancien culte eurent pour première conséquence de faire éclater une chouannerie des Flamands, la guerre des paysans. Louvain fut menacé : la panique saisit les autorités locales, qui abandonnèrent leur poste. Van Meenen, ainsi que le maire et le commissaire même du Directoire, se réfugièrent à Bruxelles, où leur arrivée fit sensation. Ils en furent quittes pour une semonce fraternelle de l'autorité départementale (voir ORTS, la Guerre des Paysans, Bruxelles, 1863 ; in-8°).
L'administration supérieure ne garda pas rancune à Van Meenen ; il devint secrétaire de la sous-préfecture de Louvain (1800), et fut, en outre, investi, dans le cours des années suivantes, de divers mandats de confiance. Pendant quatorze ans, à partir de 1802, il siégea au conseil municipal de Louvain ; procureur syndic du conseil général des hospices et secours de son arrondissement (1803), président du collège électoral de la même circonscription, il s'acquit une réputation de capacité et de dévouement qui le fit porter, en 1805, sur la liste des candidats au Corps légis-latif. Cependant les fonctions qu'il remplissait avec succès ne répondaient que tout juste à ses goûts, et le despotisme impérial, d'autre part, achevait de dissiper ses illusions de vingt ans. Il finit par prendre la résolution de renoncer aux fonctions publiques pour embrasser la carrière du barreau. A force de volonté, et grâce à ses rares aptitudes, grâce aussi à une disposition de la loi du 13 mars 1804, autorisant le gouvernement à dispenser, pendant dix ans, de la production de diplômes, les individus ayant rempli des fonctions législatives, administratives ou judiciaires et réclamant la faveur d'exercer toutes les fonctions ou professions pour lesquelles le titre de licencié en droit était exigé, il en vint à se mettre en règle et fut admis à prêter serment, comme avocat à la cour d'appel de Bruxelles, le 30 août 1808. Il ne se détacha toutefois complètement de l'administration que vers fa lin de l'année suivante pour se livrer, toujours à Louvain, aux travaux de sa nouvelle profession.
Elle ne l'absorba pas tout entier : il sut se créer de studieux loisirs, qu'il consacra con amore à la philosophie, à l'idéologie, comme on disait alors, en attachant à cette expression je ne sais quelle acception dédaigneuse. Mais ses méditations n'eurent pas seulement pour objet des pures théories ; il s'inquiéta surtout, comme son contemporain Benjamin Constant, de la solution pratique des grands problèmes de la morale sociale et du droit constitutionnel. Aussi bien il s'inquiétait des destinées de son pays, qui subirait tôt ou tard le contre-coup des fautes de l'Empire ; il se préparait à un rôle actif, et il se trouva, en effet, à son poste lorsque la tragédie napoléonienne approcha de son dénouement. Le 2 février 1815, parut à Bruxelles, chez P.-J. Demat, le premier numéro de l'Observateur politique, administratif, historique et littéraire de la Belgique, par une société de jurisconsultes et d'hommes de lettres, avec cette épigraphe : Rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis et quae senties dicere licet. Van Meenen y ouvrit le feu par un article intitulé : Droit public (Note de bas de page : Du 2 février au 30 avril 18i5. l'Observateur parut deux fois la semaine, par numéros d'une feuille chacun : les vingt-six premiers forment le tome 1 de la collection. Les numéros suivants (27-529) furent distribués par fascicules ou par volumes, à des époques indéterminées. Le recueil comprend vingt volumes, dont le dernier est resté inachevé (fin 1819). Il eut pour premier propriétaire Carton, qui le céda, en mai 1815, aux avocats d'Elhoungne, Doncker et Van Meenen, Il continua de s'imprimer à Bruxelles, mais le bureau fut transféré à Louvain. Parmi les collaborateurs de l'Observateur, nous citerons, indépendamment des trois jurisconsultes précités, les deux frères Tarte, Antoine Barthélemy, le même dont un boulevard de Bruxelles porte le nom, N. Cornelissen et Plasschaert (le créateur du parc de Wespelaer), Les principaux articles portent les initiales de leurs auteurs).
L'épigraphe avait beau dire : dans la situation critique où se trouvaient nos provinces, la presse n'était pas sûre de son lendemain. Quelle serait l'attitude du prince d'Orange ; le futur souverain des Pays-Bas ? Résisterait-il aux exigences de Maurice de Broglie, l'évêque de Gand, organe d'un clergé puissant et remuant ? On verrait peut-être se renouveler les agitations du règne de Joseph II. Entrerait- il dans la voie des concessions ? Que deviendraient alors les conquêtes de la révolution ? Tenir un juste milieu ? Ce serait ne contenter personne. Quoi qu'il arrivât, la presse devait s'attendre à un bâillon. Nos courageux publicistes ne se laissèrent pas effrayer : naviguant entre des écueils, ils suivirent imperturbablement la ligne droite des principes, à leurs risques et périls. Libéraux sincères, ils réclamaient la. liberté pour tous, pour le clergé comme pour les adversaires ; confiants à l'origine dans les intentions et dans la prudence du nouveau gouvernement, ils n'eurent pourtant jamais la faiblesse de s'incliner devant tous ses actes et de lui ménager des avertissements, si bien qu'ils finirent par lui devenir suspects. On a insinué qu'ils ne se seraient pas jetés graduellement dans l'opposition, si tout au commencement, Guillaume 1er s'était montré plus sensible à leurs avarices. C'est un reproche immérité. L'Observateur prit part à l'allégresse générale, lorsque le roi fit son entrée solennelle dans Bruxelles, le 30 mars 1815 ; mais il n'avait rien à renier pour acclamer le nouveau régime ; sa confiance en lui ne l'empêcha pas de le surveiller de près, fidèle en cela à sa profession de foi constitutionnelle publiée le 2 février par l'organe de Van Meenen. Il fut maladroit peut-être, mais il fut loyal, et ce qui le prouve, c'est qu'il ne se décida que très lentement à se placer sur le terrain de la critique. Peu à peu, sans doute, il se montra moins accommodant : ce ne fut point dépit, mais désenchantement, illusions perdues.
Dans les premiers volumes de l'Observateur, Van Meenen se montra philosophe plutôt que politique. Le plus pressant, à ses yeux, puisqu'un projet de constitution va être élaboré, c'est d'affirmer les grands principes. Avant tout, les citoyens réclament, dans la mesure la plus large, des garanties individuelles, la liberté civile, la sécurité la plus entière. Pourquoi la liberté politique fut-elle réduite à rien dans la France impériale ? Parce que la liberté civile y était anéantie. Notre histoire n'est pas moins instructive sur ce point. « Par la charte de Cortenbergh, comme par toutes les Joyeuses Entrées, les libertés, tant nationales qu'individuelles, n'avaient pour garantie que le droit de refuser tout service et toute obéissance au prince qui les avait violées, jusqu'au redressement et à la réparation de ces violations : remède extrême, souvent pire que le mal, et qu'on ne pouvait employer sans l'outrer, comme, on fit en 1789. »
Si Joseph II, au lieu de tout brusquer, s'était associé l'un après l'autre ,tous les intérêts, au lieu de les froisser tous en même temps, en moins d'un quart de siècle, là révolution qu'il rêvait eût été un fait accompli ; mais il n'en est pas moins vrai qu'il se serait vu arrêté dès les premiers pas, si la nation avait eu sérieusement part à l'autorité législative, si les ministres eussent été responsables, si enfin les droits individuels, soit des corps, soit des particuliers eussent été protégés sur ce point capital. Ce n'est pas que les constitutions, prises en elles-mêmes, soient des panacées ; cependant, de nos jours, on s'en passerait difficilement ; mais on aurait peu de chance d'aboutir si l'on ne s'entendait avant tout sur les principes. Il faut se dire que constituer, c'est organiser les pouvoirs, non les exercer. La France s'est égarée sous ce rapport : prenez ses constitutions une à une, ce sont des codes, des œuvres éphémères. L'Angleterre et l'Amérique ont fait, au contraire, besogne durable, parce qu'elles ne se sont attachées qu'aux principes.
Mais tandis que Van Meenen disserte, les événements se précipitent. La com-mission chargée de réviser la loi fondamentale a terminé ses travaux. La pro-clamation du 18 juillet éclate comme un coup de foudre. Il s'agit de savoir sous quelle forme on votera, pour ou contre le projet, et qui votera. Quoi ! deux poids et deux mesures ! En Hollande, conformément à la loi en vigueur, le projet sera soumis à la délibération d'une assemblée. Formée de membres des Etats généraux et d'un nombre égal de membres extraordinaires ; en Belgique, au contraire, des notables, un sur deux mille habitants, seront convoqués par arrondissement pour voter sur le dit projet, et le recensement des votes se fera à Bruxelles, Ainsi, les Hollandais délibéreront sur ce qui nous intéresse autant qu'eux-mêmes, et nous ne pourrons dire que oui ou non ! Tout ici est étrange et disproportionné. Et si les deux parties du nouveau royaume ne s'accordent pas ? Dans quelle balance les pèsera-t-on ? La Constitution deviendra-t-elle hollandaise de par la Belgique, ou belgique de par la Hollande ?
Van Meenen signale ces anomalies ; il se contente, du reste, du rôle d'observateur et ne songe pas à brûler ses vaisseaux, si peu qu'il engage ses amis politiques à voter pour le projet. Il redoute par dessus tout les prétentions du clergé : voilà le secret. Les évêques belges n'avaient pas attendu pour dessiner leur attitude, que le texte du projet soumis à l'approbation des notables fût connu. Ils firent feu sur toute la ligne ; la police eut beau saisir les mandements : le coup était porté. Indifférence ou scrupule, les cinq dixièmes des notables s'abstinrent de donner leurs suffrages ; des 1,373 votants, 527 seulement adhérèrent au projet. Le roi Guillaume n'en démordit point : il affecta de considérer comme affirmatifs les votes de 136 opposants qui n'avaient entendu repousser formellement que les articles relatifs au culte ; d'autre part, il appliqua l'adage : Qui tacet consentit, aux notables qui n'avaient pas voté et crut pouvoir passer outre. Une proclamation du 24 août déclara la Constitution adoptée.
Calculs équivoques s'il en fut ; mieux eût valu cent fois, dit fort bien Th. Juste, décréter souverainement la loi fondamentale. Ce qu'on n'a peut-être pas re-marqué, c'est que l'idée de ces calculs paraît avoir été suggérée par Van Meenen lui-même. Ce n'est pas sans étonnement que nous avons lu dans l'Observateur (t. II, pages 266) les lignes suivantes à propos de la formation définitive des listes de notables : « Un beau principe à appliquer ici, c'est que, lorsqu'on en appelle à des votes de rejet, il faut considérer le silence des habiles à voter comme des votes de maintien ; sans cela, on s'exposerait à juger des dispositions de tous par les mouvements du petit nombre des gens turbulents, et une minorité désapprobatrice prévaudrait sur la masse qui n'a pu manifester son opinion que par son silence, parce que tout autre moyen lui était interdit ». L'analogie des deux situations n'est sans doute pas complète ; mais la pensée est la même.
L'irritation du clergé se traduisit par des exposés de doctrines et par des actes. L'abbé De Foere, rédacteur du Spectateur belge, recueil très influent dans la Flandre, proscrivit la tolérante publique, qu'il définissait une loi de l'Etat, par laquelle on garantit à tous la libre circulation des opinions religieuses et l'exercice public de tous les cultes ; l'évêque de Gand, de son côté, mit au ban de l'Eglise, dans son fameux Jugement doctrinal, les adhérents de la loi fondamentale et fit aux fonctionnaires un crime de leur serment. Le gouvernement entra alors dans des fureurs qui lui firent oublier toute prudence, et finalement inspirèrent des inquiétudes à ceux mêmes qui s'étaient montrés les plus disposés à se grouper autour. de lui. Van Meenen combattit l'abbé De Foere, apologiste, disait-il, du despotisme, sauf à prendre loyalement sa défense quand il vit plus tard la liberté de la presse menacée dans sa personne. Le vaillant publiciste de Louvain trouva exorbitantes les déclarations de l'évêque De Broglie ; mais dès que le prélat put se dire à son tour victime de l'intolérance, l'Observateur déploya toute son énergie et toute sa science juridique pour blâmer sévèrement ses persécuteurs. La publication du concordat, la mort de Maurice de Broglie eurent pour effet d'apaiser le clergé flamand et de le rallier à la loi fondamentale ; mais le calme n'existait qu'à la surface. Peu à peu, le roi se laissa en traîner à des mesures violentes et impopulaires, et peu à peu le désaffectionnement gagna Van Meenen et ses Collaborateurs. Leur langage s'accentua ; leur intrépide éloquence devint gênante ; on essaya de les museler en leur intentant des procès ridicules. Ils ne cédèrent pas ; néanmoins la première ferveur était passée ; l'Observateur disparut tout d'un coup de son plein gré, et ses rédacteurs prirent une attitude expectante.
En 1817, lors de la grande crise commerciale des Flandres, Van Meenen prit part à la fondation d'une Association patriotique pour le soutien de l'industrie nationale, dont tous les membres devaient s'engager d'honneur, non seulement à ne pas employer sciemment des toiles, des draps et des étoffes de coton fabriqués à l'étranger, mais encore à en interdire l'usage aux personnes placées sous leur dépendance. Les adhésions furent nombreuses ; des comités locaux s'organisèrent. Van Meenen était partisan de la liberté commerciale ; mais l'effet désastreux des lois protectrices lui paraissait ne pouvoir être mieux combattu que par la prohibition elle-même. Le gouvernement ouvrit enfin les yeux ; d'abord il s'en tint à des modifications de tarifs et des avances aux industriels ; ensuite il imagina le million Merlin, prélevé sur les revenus des douanes au profit des industries grevées de droits élevés ; enfin, il mérita bien du pays en créant la Société générale. L'initiative de Van Meenen et de ses amis contribua sans contredit pour beaucoup à provoquer ces mesures utiles.
Mais Van Meenen ne s'intéressait pas seulement aux affaires du jour ; c'était avant tout un philosophe. Dans les années qui précédèrent la réorganisation de l'enseignement supérieur, nous le voyons s'entourer de jeunes gens qu'il incite à penser par eux-mêmes. Nous ne citerons que Sylvain Van de Weyer, le futur diplomate, qui resta toute sa vie profondément imbu des leçons de ce maître. Van Meenen avait l'esprit large : il rêvait la conciliation du cartésianisme avec la philosophie expérimentale importée d'Angleterre, lorsque les Inductions de Kératry lui tombèrent sous la main. Non bis in idem, se dit-il ; et il abandonna son projet. Si Van Meenen prit au sérieux la philosophie de Condillac, ce ne fut qu'un instant et pour l'éprouver, comme il disait ; il en reconnut l'insuffisance et les contradictions, correspondit avec Destut de Tracy pour lui déclarer qu'il n'était pas d'accord avec lui, puis se rapprocha de Royer-Collard et mérita, pour sa Lettre à Haumont (voir ce nom), insérée dans l'Observateur, les éloges de Victor Cousin. Van Meenen se montra sévère à l'égard de son adversaire, dont il appréciait cependant la valeur ; il y eut un échange de lettres, au cours desquelles l'avocat philosophe essaya de circonscrire le débat, en le faisant porter sur la question du langage. Jacotot faisait alors beaucoup de bruit à Louvain. Haumont ne s'intéressant guère à la nouvelle méthode, Van Meenen résolut lui-même de rompre une lance avec le fondateur de l'émancipation intellectuelle : d'une part, il tenait à réduire à sa juste valeur une théorie grosse de conséquences pédagogiques de première importance ; de l'autre, il n'était pas fâché de trouver l'occasion de lancer quelques pointes au gouvernement, à propos de l'invasion officielle de la langue hollandaise en Belgique. (Nous renvoyons le lecteur à l'article JACOTOT, de la Biographie nationale.)
Van Meenen avait ses idées à lui, en matière d'éducation ; il n'aimait pas les formulaires et pensait qu'il ne convient pas de couler les jeunes intelligences toujours dans le même moule, mais de les rendre assez vigoureuses pour marcher ensuite par elles-mêmes. Il réalisa ses vœux en dirigeant personnellement l'éducation de ses enfants, et n'eut point à s'en repentir. En même temps, il suivit avec attention les progrès de la réaction qui s'opérait en France contre le pur sensualisme. Il entra en relation avec Laromiguière, qui, tout en restant condillacien, commençait à reconnaître que l'âme n'est pas entièrement passive et que les sensations ne suffisent pas à expliquer la pensée. Il prit la peine de commenter, page par page, le Discours sur la langue du raisonnement et les Leçons de philosophie. Ce travail, presque aussi étendu que les ouvrages dont il était l'objet, fut communiqué à Laromiguière sur le désir manifesté par celui-ci au baron de Reiffenberg, alors occupé de traduire les Leçons en latin. Le penseur français se fit un devoir de ne laisser sans réponse aucune des objections de Van Meenen. On se prend à regretter que ces notes n'aient pas été coordonnées de manière à former un livre ; la réputation de notre compatriote y eût gagné, et l'histoire de l'éclectisme se fût enrichie d'un bon chapitre. Mentionnons encore parmi les ouvrages philosophiques inédits de Van Meenen une dissertation sur la morale de Bentham, qui ne doit pas avoir été sans influence sur la Rédaction du même système, par Vande Weyer (Opusc. t. Il). Citons enfin, comme tenant à la fois à la philosophie et à la politique, un écrit intitulé : Essai sur quelques théories civiles et pénales germaniques, et vues sur la philosophie allemande. Le début de ce morceau, qui vise le projet de code pénal de 1827, donne la mesure de l'irritation et des craintes qu'avait graduellement éveillées la politique intérieure du gouvernement des Pays-Bas. Notre polémiste s'en prend aux nouveaux jurisconsultes, qui se couvrent du manteau de la philosophie allemande, avec une arrière-pensée. « Quand nous serons devenus des demi-allemands, s'écrie-t-il, on aura moins de peine à nous faire Hollandais ». Il entre ensuite dans le vif des questions pour combattre la peine de mort soutenue par les rédacteurs de la Tydschrijt voor wysbegeerte de La Haye, qui se sont abusivement servis des noms de Leibnitz et de Kant à l'appui de leurs thèses. C'est dans le Courrier des Pays-Bas que le philosophe belge échangea des passes d'armes avec la Tydschrijt. Les audaces du Cour-rier ne s'en tinrent pas là : ses rédacteurs en surent quelque chose. La philoso-phie spéculative eut un temps d'arrêt. Van Meenen eut à défendre devant les tribunaux deux de ses collaborateurs, Claes et Coché-Mommens. De jour en jour la situation s'aggrava : bientôt il n'y eut plus en Belgique que des amis de l'indépendance. Que de chemin parcouru depuis 1815 !
Les idées lamennaisiennes se répandirent dans le pays et rendirent possible l'union des catholiques et des libéraux. Van Meenen et l'abbé De Foere en furent les véritables fondateurs. Mais l'alliance des deux partis ne fut tout à fait scellée qu'en juin 1829, par la publication d'une brochure de L. de Potter, alors détenu aux Petits-Carmes pour un article du Courrier. Le retentissement de cet écrit fut sans effet sur une cour terrifiée. Cependant la colère du peuple devenait décidément menaçante. Un nouvel acte d'accusation fut dressé contre de Potter et son ami Tielemans, à propos de la publication, dans le Courrier, des Lettres de Démophile. Van Meenen et Gendebien les défendirent devant la cour d'assises du Brabant méridional : une sentence d'exil frappa les accusés, qui ne devaient pas tarder de rentrer avec tous les honneurs de la guerre. Mais ce qui parut vraiment odieux dans cette affaire, c'est que trois jours après la condamnation aux assises (3 mai 1830), la correspondance de Tielemans et de Potter parut en deux gros volumes in-8°, chez Baes Van Kempen, c'est-à-dire chez Libri-Bagnano. Elle avait donc été imprimée pendant le procès ! On avait commis l'infamie de la livrer au typographe avant le jugement ! Il en résulta que ce jugement passa pour avoir été dicté au tribunal. Les intéressés réclamèrent : ceux qui devaient s'expliquer restèrent muets. La mesure était comble.
La révolution éclata. Van Meenen ne fut pas le dernier à se prononcer pour la séparation des deux pays. A Louvain, avec quelques notables, il s'empara du pouvoir le jour même où la garnison fut chassée, grâce à leur ferme contenance. Bruxelles, tranquille de ce côté, put résister plus aisément à l'attaque des forces envoyées contre elle. Van Meenen fut appelé par le gouvernement provisoire, dès le 28 septembre, au poste important de gouverneur du Brabant. Il accepta ce mandat pour aider ses amis à traverser la crise. Mais une fois ce résultat obtenu, il se hâta de démissionner (1er décembre) ; il avait toujours montré peu de goût pour l'administration, Le 6 octobre, du reste, il avait été nommé. procureur général près de la cour supérieure de justice de Bruxelles. Le 6 décembre, il fut désigné pour faire partie de la commission de constitution.
Les électeurs louvanistes l'envoyèrent siéger au Congrès national ; il se trouva là dans son véritable milieu, et déploya tout son zèle en coopérant assidûment à l'élaboration de notre précieuse charte. C'est sur sa proposition qu'elle fut adoptée dans son ensemble et sanctionnée solennellement le 7 février 1831.
Il vota pour la monarchie constitutionnelle sous un chef héréditaire, pour l'ex-clusion des Nassau, pour deux Chambres législatives, contre les 18 articles, etc. ; mais c'est surtout dans la discussion du titre II de la Constitution : Des Belges et de leurs droits, qu'il eut l'occasion d'appliquer ses principes et de se rendre utile. C'est sa rédaction, sous-amendée par le comte de Theux, qui fut adoptée pour l'important article 11 : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester son opinion en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de ces mêmes libertés. » Les mots soulignés furent ajoutés au texte primitif de l'article ; Van Meenen ne voulait pas consacrer un privi-lège contre le culte catholique, « le seul qui s'exerce au dehors des temples » ; il était conséquent avec lui-même. C'est à lui également et à Mr Deleeuw qu'est due la formule non moins essentielle de l'article 17 : « L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n'est réglée que par la loi ». Telle fut l'attitude de Van Meenen. Quand on y regarde de bien près, on trouve en lui plus de loyal enthousiasme que de prudence défiante. Il ne prévoyait pas qu'on pût jamais tenter de remettre en question les libertés proclamées au Congrès comme des droits naturels - car ainsi les jugeait cet enfant du XVIIIe siècle - et qu'une Encyclique foudroyante relèverait un jour, contre les lamennaisiens du journal l'Avenir, les théories du Jugement doc-trinal.
Lors des premières élections pour la Chambre des représentants, Van Meenen fut élu député d'Ypres ; Il n'assista qu'à la session 1831-1832, où les 18 articles firent place aux 24, et où la Belgique dut s'imposer un douloureux sacrifice pour ne pas tester isolée. Cédant à la nécessité, Van Meenen oublia son vote du Congrès, Le 4 octobre 1832, Raikem étant ministre de la justice, il fut nommé président de chambre à la cour de cassation ; il entra en fonction le 15 du même mois, le jour même où il dit adieu à la Chambre des représentants. L'arrêté royal qui le mit à la pension date du 25 février 1857 ; il ne jouit qu'un an des loisirs de la retraite.
Van Meenen avait impérieusement besoin de « remplir toute sa vie » ; les glaces de l'âge ne surent ni refroidir son énergie morale, ni le détourner de ses études, ni modérer ce besoin d'activité incessante et variée, ce qui est le propre des hommes de propagande. Tant qu'il fut debout il travailla, il écrivit, il s'associa soit à des œuvres de progrès, soit à des manifestations politiques. Dès 1826, il était entré avec Baron, Quetelet, Lesbroussart, Vande Weyer, de Potter, etc., dans la Société des XII, fondée pour répandre dans le peuple les principes de la tolérance religieuse la plus large ; il fut à la même époque un des organisa-teurs du Comité hellénique ; l'année suivante, l'enseignement philosophique du Musée s'ouvrit pour ainsi dire sous ses auspices ; on l'a vu reprendre sa plume de journaliste la veille de la révolution et la tenir d'une main ferme pendant la tourmente ; magistrat, il ne changea point d'allures. De 1830 à 1836, puis de 1847 à 1849, il siège au Conseil communal de Bruxelles ; de 1836 à 1843, il prend part aux travaux remarquables du Conseil de salubrité, pour lequel il rédige, avec MM. Daumerie et Bigot, un rapport très intéressant sur les sociétés de tempérance ; en 1847, il a l'honneur de présider le congrès pénitentiaire de Bruxelles, dont il inaugure les travaux par un discours où il développe les idées les plus élevées, notamment à propos de la grave question de l'amendement des condamnés. Quand il cessa de prendre directement part à la polémique des journaux, ce ne fut pas par indifférence ; on est même assez fondé à croire qu'il resta l'inspirateur de certains feuillets, Il s'associa à la société de l'Alliance et prit part au Congrès libéral de 1846. En 1847, la nuance qu'on a depuis qualifiée de doctrinaire triompha ; il resta néanmoins dans le camp des « avancés »/ Un article du journal la Nation, du 26 avril 1848, donne l'idée de son attitude : « Le véritable objet de son culte, dans l'ordre politique, comme il eut l'occasion de le dire le 22 avril, c'était la nation belge avec le double attribut de sa souveraineté et de son indépendance de toute puissance humaine ».
Van Meenen avait pris une part, en 1834, à la fondation de l'université libre de Bruxelles. Il fit plus : il tint à honneur de figurer sur la liste de ses professeurs. Il y fit un cours d'encyclopédie de la philosophie, qu'il échangea bientôt pour la philosophie morale, En 1841, il fut élevé à la dignité rectorale ; son mandat d'un an fut plusieurs fois renouvelé. C'est comme recteur qu'il prononça, le 20 novembre 1844, à l'occasion du decennium de l'université, un discours énergique et significatif, où il évoqua le souvenir de l'Encyclique de 1832 et des Vrais principes de l'évêque de Liège Van Rommel, en matière d'instruction publique. Il y représenta l'université de Bruxelles comme ayant sa raison d'être dans la nécessité de résister aux envahissements de la théocratie, et de soutenir les institutions nationales au nom de l'indépendance et de la science, « la souveraine du monde ». Il ne repoussait pas la religion, mais voyait dans l'étude elle-même, dans la recherche sincère de la vérité, un acte de foi en la Providence ; il s'élevait avec une égale vigueur contre le fanatisme et le scepticisme.
L'Académie royale de Belgique ayant été réorganisée par Léopold 1er (1er décembre 1845), sur le rapport de S. vande Weyer, alors ministre de l'intérieur, la classe des lettres résolut, dès le 27 janvier suivant, d'associer à ses travaux plusieurs hommes éminents, parmi lesquels Van Meenen ne pouvait être oublié. L'élection du digne vieillard devait paraître un hommage rendu à son mérite, plutôt qu'un appel direct à sa coopération. Il ne l'entendit pas ainsi : il tint à se montrer aussi actif que ses collègues plus jeunes. Son rapport sur un ouvrage de Quetelet concernant la Statistique morale parut si important à la classe qu'elle en ordonna l'impression dans le recueil in-4° de ses Mémoires (t. XXI). Il eut d'autres occasions d'intervenir dans des débats philosophiques, notamment dans la discussion qui s'éleva sur la liberté humaine entre Tissot et Gruyer, le premier penchant trop du côté de Leibnitz, le second glissant sur la pente du mécanisme cartésien. Van Meenen s'abstint de proposer une solution et soutint seulement que la liberté humaine est un fait immédiatement certain, au-dessus de toute argumentation. Il eut ensuite à juger un travail de L. Bara, avocat, à Mons, sur la Méthode pure (1988 pages in-folio, sans les tables). Il recula épouvanté et prit le parti d'enterrer Bara sous des fleurs. .
En 1855, une chute malheureuse obligea Van Meenen de se séparer pour toujours de ses collègues de la cour et de s'éloigner des affaires publiques. Il souffrit de sa condamnation au repos ; sa puissante constitution en fut minée peu à peu. Comme Charles-Quint, il mourut trois ans après son abdication. Ses funérailles furent imposantes, digne d'un grand citoyen. Une discordance se fit cependant entendre à Louvain. Van Meenen avait été enterré civilement : il avait professé une religion philosophique, en dehors de toute théologie.
On a peine à se figurer de pareilles colères. La carrière tout entière du défunt fut représentée comme un tissu de palinodies. Le vénérable abbé de Haerne, son collègue au Congrès, se crut obligé de formuler lui-même une généreuse protestation.
L'université de Bruxelles possède un portrait de Van Meenen, œuvre magis-trale de Navez. La ressemblance, paraît-il, est frappante. Front haut et large, sourcils froncés par l'habitude de la pensée, regard dont la sévérité ne parvient pas à dissiper un penchant à l'indulgence, nez droit et allongé, qui revêt tout à la fois une probité native et, dans les narines, une nuance d'ironie perceptible seulement à l'œil attentif ; des lèvres serrées et un peu relevées du côté gauche, confirmant ce dernier trait et en même temps accusant un orateur ; un menton carré, signe de fermeté et de respect de soi-même ; dans l'ensemble, une expression d'honnêteté et de simplicité un peu rustique, mais surtout de dignité presque solennelle, tels sont les traits matériels et moraux, pour ainsi dire, de cette remarquable physionomie. Van Meenen était d'une taille élevée, d'une complexion sèche, osseuse et robuste ; sans être négligé dans sa toilette, il en avait peu de souci : les délicats le surnommaient « l'homme aux grosses botte »s. Il était de cette race énergique et sûre d'elle-même qui a fourni, au temps de la première révolution française, tant d'individualités fortes, devant lesquelles nous ne sommes que des mirmidons. Comment se fait-il qu'un homme aussi distingué, aussi bien doué, aussi influent sur ses contemporains, soit si peu connu de la génération présente, à coup sûr ingrate sans le savoir ? Nous voyons à cela deux causes : d'abord Van Meenen en dehors de ses articles de jour-naux, n'a publié qu'un petit nombre d'opuscules ; ensuite, son influence a été celle d'un puissant critique plutôt que celle d'un fondateur et d'un homme d'action. Il faut aussi tenir compte de son absence d'ambition personnelle : il ne tenait pas à briller, mais à se satisfaire lui-même. Il ne se donnait pas la peine de soigner son style, trop souvent délayé et diffus. Il se tenait, d'autre part, presque toujours sur le terrain des idées générales, peut-être à raison de son éloignement pour le sensualisme. En somme, Van Meenen fut un généreux enthousiaste, rêvant une société nouvelle, parce qu'il avait trop connu l'ancienne, et la voyant déjà debout dans ses théories. Nous ne le comprenons plus, mais ses premiers lecteurs le comprirent, parce qu'ils partageaient ses espérances. Nous lui devons un pieux souvenir. Il fut de l'un de ceux qui préparèrent l'indépendance de la Belgique ; il montra par son exemple comment il faut aimer la liberté ; il contribua pour une bonne part à la rédaction du pacte fondamental qui nous la garantit ; il prépara enfin dans notre pays la renaissance de l'enseignement spiritualiste ; l'oublier serait une injustice. Il n'a pu, sans doute, que planter des jalons ; mais on peut dire que la génération nouvelle est largement son obligée.