Gendebien Jean-François (1753-1838)
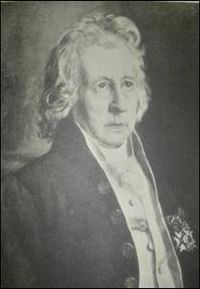
Gendebien Jean-François
né en 1753 à Givet décédé en 1838 à Mons
Congressiste élu par l'arrondissement de SoigniesBiographie
(Extrait de : L. FRANCOIS, dans Nouvelle biographie nationale, t. II, , 1990, pp. 188-189)
GENDEBIEN, Jean-François, membre du Congrès, du Corps Législatif, de la Deuxième Chambre et du Congrès National, intendant et conseiller dans l'exploitation minière, né à Givet (France, département des Ardennes) le 21 février 1753, décédé à Mons le 4 mars 1838.
Au début de sa carrière, Jean-François Gendebien suivit les traces de son père. Il étudia le droit à Louvain, à Vienne et à Paris ; s'installa comme avocat à Mons en 1779 et devint intendant de la famille d'Arenberg en 1780. Après avoir obtenu la naturalisation le 1er avril 1784, il fut nommé greffier échevinal du magistrat de Mons. Comme personnalité jouissant d'une certaine audience, il était partisan d'une modernisation progressive des institutions.
Gendebien n'était toutefois pas d'accord sur la manière despotique dont Joseph II poursuivait ses réformes. En 1787, il joua un rôle assez significatif contre les réformes administratives ; en janvier, il fut l'un des rédacteurs d'une requête adressée à l'Empereur et, en décembre, le coauteur d'un rapport sur les violations des droits de notre pays.
Du 24 octobre au 23 novembre 1789, Gendebien fut emprisonné comme otage entre les mains du commandant d'Haponcourt. Dès sa mise en liberté, il reprit ses fonctions de greffier échevinal du magistrat renouvelé de Mons. En décembre 1789, il fut nommé également conseiller pensionnaire.
En 1790, il devint membre du Congrès des Etats Généraux et, suivant le rôle, il présida à plusieurs reprises cette assemblée et il fut coauteur du projet de texte des Etats-Belgiques-Unis. Dans le conflit, qui opposa les démocrates et les statistes, Gendebien ne prit pas position. Il ne sympathisait certes pas avec Vonck, mais il n'était pas partisan non plus d'un régime qui donnerait le monopole du pouvoir à l'Eglise et qui s'imposerait par la terreur. Gendebien se fondait sur l'interprétation stricte des principes du contrat social. Bien qu'il présageât, dès l'été 1790, le développement de la révolution, il essaya de l'endiguer en collaborant à la réorganisation des institutions et en misant au maximum, mais en vain, la carte française.
Gendebien sut se réconcilier au mieux avec la première restauration autrichienne. Dans une note circonstanciée à Metternich datée de février 1792, il exposa son point de vue modéré. Il tend ainsi à donner satisfaction à tous les partis dans l'espoir de parvenir à résister aux Français. Etant resté entièrement neutre de novembre 1792 à mars 1793, il fut nommé, en juin 1793, membre du Conseil communal de Mons et conseiller-pensionnaire des Etats de Hainaut.
De juin 1794 à l'été 1795, Gendebien séjourna en Allemagne. Après son retour, il exerça à nouveau sa profession d'avocat et ses fonctions d'intendant des d'Arenberg. Il refusa, en avril 1797, un mandat au Conseil des Anciens, alors que le Gouvernement lui-même avait été déçu par le caractère royaliste et antifrançais des élus. Gendebien s'intéressa de plus en plus aux affaires minières. Par ses conseils juridiques et par sa participation financière, il acquit une position clé dans ce secteur industriel, au moment où celui-ci recevait une nouvelle impulsion grâce à l'emploi des machines à vapeur. Sous le Consulat, Gendebien sortit de son isolement politique : en juillet 1800, il fut nommé membre du Conseil général du Département de Jemappes, membre du Conseil communal et président du Tribunal de première instance de Mons. Depuis 1804, il siégea, en outre, au Corps Législatif de France. Comme parlementaire, il défendit principalement la rationalisation et le développement des exploitations houillères. Il fut l'un des principaux rédacteurs de la loi de 1810 sur les mines.
Bien qu'il se fût tout à fait intégré au régime de l'Empire (en 1810, par exemple, il fut décoré de la Légion d'Honneur), il œuvra, certainement à partir de 1811, pour instaurer des contacts réguliers et des prises de position communes entre les parlementaires de Hollande et de Belgique.
Cette attitude de Gendebien contribua certainement à le faire bien voir, en 1814-1815, dans l'entourage du prince-souverain et à le faire désigner, au printemps de 1815, comme membre de la Commission chargée de préparer la Loi fondamentale. Il s'y manifesta comme défenseur d'un état unitaire moderne (pour les garanties à donner aux acheteurs des biens nationaux, pour le maintien de l'organisation administrative), mais aussi comme défenseur des intérêts de la Belgique (contre le choix d'Amsterdam comme capitale, pour le français comme langue officielle, pour la représentation parlementaire à la proportionnelle).
Le Roi désigna Gendebien comme membre de la Deuxième Chambre, en septembre 1815. Bien qu'il fût très content du nouveau Royaume et de ses institutions, il notifia souvent, au Gouvernement, des avis au franc-parler, ce qui apparaissait à l'autorité comme le langage de l'opposition, tandis que Gendebien était considéré par ses collègues, comme un parlementaire indépendant. Il avait des conceptions très nettes : en matière de l'armée (pas d'étrangers dans l'armée nationale), de la jurisprudence (autant que possible, uniformité et délimitation stricte des compétences), du droit civil (pour une codification et contre le droit coutumier) et pour une interprétation exacte de la Loi fondamentale (pour le droit de pétition, pour une interprétation maximaliste des droits de la Deuxième Chambre).
L'étendue croissante du pouvoir, le nombre grandissant des fonctionnaires et l'augmentation des dépenses de l'appareil de l'Etat déçurent profondément Gendebien. Aussi s'opposa-t-il, chaque année, aux propositions de budget et certainement contre les propositions de dépenses consenties pour dix ans. Il était aussi adversaire de la plupart des lois fiscales : selon lui, les impôts indirects pouvaient uniquement être perçus .sur les biens de consommation. Il défendit également au parlement les mesures en faveur de l'agriculture et du commerce international.
On peut affirmer que Gendebien fut un parlementaire très actif et qu'il monta très souvent à la tribune. Il irrita bien des fois le Roi et le Gouvernement par ses prises de position et il n'est pas exclu que ceux-ci intervinrent pour écarter Gendebien de la Deuxième Chambre lors des élections de 1821.
En octobre 1830, il devient membre de la « Société de la Constitution » à Mons et il fut nommé président du Tribunal de première instance par le Gouvernement provisoire. Les collèges électoraux tant des patriotes que des réunionistes le présentèrent comme candidat au Congrès National. Bien qu'il eût adopté une attitude d'expectative pendant la révolution, il fut élu et présida, en tant que doyen d'âge la première assemblée le 10 novembre 1830. Gendebien n'était pas d'avis de donner la priorité à la discussion sur l'exclusion de la famille Orange-Nassau du trône de Belgique, mais il était bien d'accord sur l'exclusion même. Il s'opposa au bicaméralisme ; il préconisa l'élection du duc de Nemours comme roi et celle de Surlet de Chokier comme régent (février 1831). En mai-juin 1831, il était acquis au choix rapide de Léopold de Saxe-Cobourg comme chef d'état et pour l'acceptation du traité des XVIII articles, car pour lui, c'était le seul moyen de garantir l'indépendance de la Belgique.
La carrière politique de Gendebien prit fin avec la dissolution du Congrès National. Il resta membre du Conseil communal et président du Tribunal de Mons jusqu'à son décès. Jusqu'en 1834, il dirigea le Comité de secours des réfugiés politiques et, depuis 1835, il se retira progressivement des affaires. En agissant de la sorte, Gendebien se montra, encore une fois, un parfait intendant car ainsi ses héritiers échappèrent, pour une grande partie, au payement des droits de succession.
Ses héritiers étaient ses fils : Alexandre, qui fit une carrière politique ; Jean-Baptiste, qui fut industriel, et ses filles : Thérèse, qui épousa Félix Gantois, négociant ; Marie, qui épousa Louis Monjot, imprimeur-éditeur et exploitant minier et Victoire, qui épousa le général Louis Duvivier. La famille Gendebien fut anoblie au début du XXe siècle.