De Robaulx Alexandre (1798-1861)
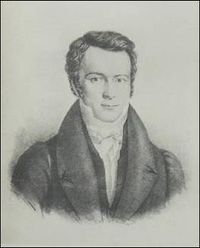
De Robaulx Alexandre libéral
né en 1798 à Fontaine-l'Evêque décédé en 1861 à Liège
Représentant 1831-1833 (Thuin) et 1833-1835 (Soignies) Congressiste élu par l'arrondissement de PhilippevilleBiographie
(Extrait de : A. FRESON, dans Biographie nationale de Belgique, t. XIX, 1907, col. 398-400)
DE ROBAULX (Alexandre), homme politique né à Fontaine-l'Evêque, le 20 avril 1798, mort à Liége, le 5 février 1861. Après avoir terminé ses études de droit, il s'établit à Liége comme avocat. Le 3 novembre 1830, il fut élu membre du Congrès national par le district de Philippeville. Au Congrès, dont il fut un des questeurs, A. de Robaulx prit la parole dans toutes les discussions importantes. Il fut un des treize membres qui, le 22 novembre 1830, se prononcèrent en faveur de la république. Le 3 février 1831 il vota pour le duc de Nemours, et, le 14 février, quand on apprit à Bruxelles que Louis-Philippe refusait la couronne de Belgique pour son fils, il proposa de proclamer la république ; sa proposition fut écartée par la question préalable. En juin 1831 il combattit la candidature du prince Léopold et, avec treize autres membres du congrès, vota pour Surlet de Chokier. Entre-temps, l' « impétueux » M. de Robaulx - comme l'appelle Louis Blanc dans son Histoire de dix ans - avait deux duels, l'un avec Charles Rogier et l'autre avec l'intendant Chazal, plus tard général et mi-nistre de la guerre.
Aux élections de 1831, A. de Robaulx fut élu représentant par l'arrondissement de Thuin. Un arrêté royal du 5 octobre 1832 le nomma substitut du procureur général à Liége. Jaloux de son indépendance, A. de Robaulx n'accepta pas ces fonctions. En avril 1833, la proposition de F.-G. Pirson et de Robaulx de ne voter le budget de la guerre que pour le premier semestre de l'année mit le ministère Goblet-Lebeau en échec, et la Chambre fut dissoute le 28 avril. Aux élections qui suivirent, de Robaulx échoua à Thuin, à Soignies et à Liége, mais le 4 juillet 1833, à une élection partielle, il fut élu par l'arrondissement de Soignies. En 1835, ayant constaté l'inutilité de continuer une lutte par trop inégale en faveur de la liberté et de la prospérité du pays, il déposa son mandat.
A. de Robaulx habita le château des Hautes (Thuin), puis s'établit en 1846 à Liége où il s'occupa d'affaires industrielles, Il prit part au congrès libéral du 14 juin 1846 et il y fit adopter, notamment, la proposition. de donner un témoignage public à la malheureuse et noble Pologne. En 1847, à Liége, l'Association libérale et l'Union libérale se coalisèrent pour les élections : les trois députés sortants, MM. Lesoinne, Delfosse et de Tornaco seraient réélus ; un siège serait attribué à l'Association et un siège à l'Union. Le candidat de l'Association fut Frère-Orban : des membres du comité de l’Union offrirent une candidature à de Robaulx, qui refusa ; il n'admettait pas que des candidatures fussent imposées à des associations politiques qui s'interdiraient le droit de les discuter. Le candidat de l'Union fut Destriveaux. A. de Robaulx se présenta seul aux élections et il échoua. En 1857 sa candidature fut présentée à l'Association libérale de Liége en opposition aux députés sortants, qui furent tous réélus. A. de Robaulx mourut en 1861. Il avait été nommé chevalier de l'ordre de Léopold en 1855.
(Extrait de : J. HANQUET, L'impétueux M. de Robaulx (1798-1861), dans Les gens de robe liégeois et la révolution de 1830, Liège, Thone, 1930, pp. 313-320)
Figure intéressante, personnalité mouvementée que celle de cet Alexandre de Robaulx, qui perpétua, dans une assemblée parlementaire, l'esprit du soulèvement populaire et qui fit quelque peu contraste avec la réputation de sagesse bien établie des hommes de robe liégeois, qui siégèrent au Congrès.
Né au château d'Hantes en 1798, il était issu d'une famille d'épée, qui, à de nombreuses reprises, avait marqué sur le champ de bataille. Il allait, lui, ferrailler dans le champ clos de la politique et même dans cet autre champ clos, où la discussion terminée, les députés, plus souvent que de nos jours, s'alignaient pour vider leurs querelles.
Si j'en crois les renseignements que me communique très aimablement, son petit-fils, le baron Robert de Rossius d'Humain, dans sa famille on ne manque ni d'indépendance, ni d'originalité son père pour ne pas s'engager dans l'état ecclésiastique, auquel le destinait sa famille, préféra s'expatrier aux Antilles et devenir « l'Américain ». Lui-même au Collège des Jésuites de Soignies où il commença ses études, manifesta un jour la même répugnance, et au Père Préfet qui l'engageait, paraît-il, à entrer dans les Ordres, il répondit qu'il le voulait bien mais à la condition d'être nommé évêque sur-le-champ.
Après cette vocation manquée, il poursuivit ses études à l'Université de Bruxelles pour terminer enfin son Droit à Liège. Il est reçu docteur le 12 juillet 1819 et il suit alors avec succès les travaux et la vie du Barreau de notre Cour. Il y restera jusqu'en 1830, et l'on a conservé le témoignage de Joseph Forgeur faisant l'éloge de son esprit et de sa rapidité de conception et qui disait qu'au banc des avocats, il avait des arguments et des répliques qui déroutaient l'adversaire.
Mais la Révolution allait l'enlever à l'existence du Palais. Entré au Congrès National le 10 novembre 1830, il y déploiera les multiples ressources d'une réelle éloquence et d'une personnalité trépidante. Venu à la vie active, à cette même période de bouillonnement des idées, qui devait nous donner tant d'hommes politiques liégeois, il partagera leurs vicissitudes, leurs réactions et leurs illusions, mais il sera sans doute le seul qui, jamais, n'en sera revenu.
Chez lui, rien de banal ; dans cette assemblée de graves bourgeois en redingote, il apporte avec beaucoup de dignité, une note plus pittoresque. Nul plus fréquemment que lui, n'interviendra dans les débats de notre premier parlement. Il ne peut se passer une séance sans que sa voix ne s'élève : interventions peu fructueuses souvent, car il n'a pas le sens des majorités. Il lui arrive d'incarner à lui seul l'opposition et il se résigne fort bien, comme il l'a dit avec humour, à voter seul ses propositions ou dans la seule compagnie de M. Seron. Député l'un et l'autre de Philippeville, gardant au fond du cœur, les idées de 1789, d'une souveraineté populaire qui ne peut se tromper, ils représentent avec constance l'idéal de la Grande Révolution, où l'Europe se conquérait au son de la Marche de Sambre-et-Meuse.
Alexandre de Robaulx n'est pas l'orateur aux longs discours, mais suivant avec un zèle qui ne se dément pas, toutes les questions qui se discutent, désirant assurément jouer un rôle dans ces débats, il lui arrivera maintes fois de congestionner l'assemblée.
Il apporte dans ces discussions une certaine candeur et l'avocat à peine en rupture de prétoire, mettra le Congrès en gaieté en glissant dans la langue parlementaire, la saveur de quelques expressions de notre jargon judiciaire.
Candeur encore et confiance dans la vertu immunisante du suffrage universel, que ce sentiment qui le poussera à voter pour l'élection populaire des juges de paix et des magistrats du tribunal de première instance, car il préfère cette nomination au choix dû à la faveur et à la protection des flatteurs.
Il sera mieux inspiré et ralliera à sa manière de voir Raikem, quand il défendra activement le jury et le réclamera non seulement en matière de presse mais aussi en matière criminelle. Au lendemain du régime hollandais, cela constituait un progrès manifeste. Il y voyait, lui, une protection de la liberté des partis, pour laquelle, il fait appel, lui libéral, aux catholiques de l'assemblée. C'est alors que cet autre généreux illusionniste, l'abbé de Haerne fera état d'un calcul des probabilités, en chiffrant à un trillion les verdicts qui seraient rendus exactement et en réduisant à une douzaine les erreurs judiciaires possi-bles. Il semble bien que c'est à l'intervention énergique du député de Philippeville que l'on doit l'inscription dans notre pacte fondamental de cette institution.
Alexandre de Robaulx est catholique de religion, mais il est avant tout philosophe et appartient à la fraction libérale de l'assemblée. Il veut la liberté complète et une indépendance absolue du pouvoir civil et du pouvoir religieux, qui ressemble fort à la séparation de l'Eglise et de l'Etat, mais poussant jusqu'au bout la logique de ses principes, il ne veut pas - et il imite en cela Lebeau - que l'on puisse imposer le mariage civil avant le mariage religieux.
Quand vint la discussion sur la forme du gouvernement, républicain par principe, il vota contre la royauté. Lors de la désignation du chef de l'Etat, son suffrage par trop confiant alla s'égarer sur la tête bouclée du régent Surlet de Chokier, tout comme celui de l'abbé de Haerne ; le libéral et le prêtre, idéalistes tous deux, se retrouvaient d'ailleurs fréquemment au plafond de l'assemblée.
Comme lui aussi, il soutint l'idée d'une « cour d'équité » élue par les deux chambres et chargée de dire quand les citoyens seraient déliés de leur serment de fidélité et d'obéissance au chef de l'Etat.
Mais c'est surtout dans la politique extérieure qu'il entend jouer son rôle d'opposant. Les négociations secrètes lui déplaisent ; il se méfie, et avec quelle raison, du « diplomate boiteux » et le gouvernement français encourt plus d'une fois ses critiques, partagées d'ailleurs par le Congrès dans sa majorité.
On est arrivé à ce moment où la Conférence de Londres nous submerge de notes, à cette période d'ultimatums qu'un caricaturiste du temps traduisait en montrant un volontaire en blouse, balayant à l'égout une poubelle de ces protocoles en disant avec mépris : « Quand il n'y en a plus, il y en a encore. » C'est alors que de Robaulx se déchaîne. Peu lui importe l'approbation de ses collègues : il parle au peuple belge par dessus l'assemblée, comme il s'adresse au peuple français par dessus son gouvernement et le public souvent docile à sa voix l'ovationne dans les tribunes.
Les éphémérides du Congrès, au début de 1831, le montrent harcelant sans cesse le comité diplomatique, dénonçant l'action des Puissances, ou encore déposant telle proposition, véritable brûlot, où l'on réclamait la déclaration de guerre à l'Europe.
Voyez-le à la séance du 15 janvier. M. Le Hon vient d'annoncer une communication de lord Ponsomby et de M. Bresson en date du 14 du même mois, concernant l'exécution de l'armistice. Il y a grande effervescence dans la salle. Tous les membres se précipitent dans l'hémicycle et de Robaulx dont la voix domine le tumulte, de critiquer ce qu'il appelle « le cloaque de la diplomatie» et de s'écrier : « Il est de la dignité du Congrès de renvoyer ce protocole. C'est une intervention. Il n'y a plus de nation, plus d'indépendance, il ne nous reste plus qu'à nous retirer chez nous. »
Un autre jour il s'en prend à la fois aux grandes puissances et au gouvernement français : « Je proteste contre semblable conduite, je la dénonce à la nation française, et j'espère que cette nation généreuse, justement indignée renverra ce ministère peu digne d'elle et qu'elle demandera qu'il soit mis en accusation. » Il est vrai que ce jour-là la France venait d'exclure la candidature Leuchtenberg. Il eut Lebeau à ses côtés, et l'un et l'autre eurent à l'adresse du cabinet Sébastiani des harangues véhémentes qui synthétisaient admirablement l'âme tumultueuse de ce peuple en pleine ébullition.
Le 24 janvier, il réclame la publicité de toutes les négociations. Il attaque la Sainte-Alliance des puissances et veut lui opposer la Sainte-Alliance des peuples : il demande la levée en masse de la nation et la reprise de l'offensive contre les Hollandais : « Hâtons-nous de protester, car les puissances veulent étouffer la liberté et replacer sous le joug du despotisme, les peuples qui ont levé la tête au cri de la liberté. »
Tel devient son leitmotiv. Sceptique sur le succès des négociateurs, plus sceptique encore sur le succès de la combinaison Saxe-Cobourg, il veut la guerre, exige qu'on mette fin aux notes verbales pour passer aux hostilités ; il lance à l'adresse de Charles Rogier un lazzi : « Au moins on ne devra pas me mettre un pistolet sur la gorge pour me faire marcher et l'on a depuis longtemps crié « aux voix» qu'il profère encore son delenda Carthago.
Tout dans sa politique devait l'opposer à Joseph Lebeau et ce dut être assez plaisant de voir plus d'une fois, ces deux confrères liégeois, presque contemporains, se dresser face à face, l'un distant et habile, diplomate, conciliant à la fois la considération pour les puissances de l'Europe et le respect de ces susceptibilités patriotiques que son adversaire connaissait seules, et celui-ci « l'impétueux M. de Robaulx » comme a dit Louis Blanc dans son Histoire de Dix ans, rongeant son frein, supportant mal la tutelle de l'Europe, accusant Lebeau de s'entourer de baïonnettes, et l'un et l'autre marquant toute la distance qu'il y aura toujours entre un chef de gouvernement et un chef de parti.
Lorsque le Ministre des affaires étrangères remporta son succès décisif par le vote des XVIII Articles, Robaulx déclara avec quelque ironie : « M. Lebeau ne m'a pas ébranlé. J'ai écouté des phrases de rhéteur... J'ai entendu beaucoup de sophismes. Aussi suis-je resté insensible et je n'ai pas embrassé l'orateur. »
Cependant après l'élection du Prince Léopold, il se rallia loyalement à la monarchie. A un personnage qui, dans la suite, semblait en douter, il envoya ses témoins. Le duel eut lieu, mais la balle de son adversaire rencontra la crosse de son pistolet, et Alexandre de Robaulx dut probablement la vie à cet heureux hasard.
Aux élections qui suivirent le Congrès, il fut élu membre de la Chambre des Représentants. En 1835, n'étant point réélu, il se retira à son château d'Hantes, mais sans perdre le droit de dire à chacun son fait, comme cela lui arriva à l'égard des doctrinaires de l'association libérale de Liège.
Il mourut dans cette ville en 1861.
En terminant la courte biographie de ce Belge qui mit tant d'ardeur dans son patriotisme et tant de passion dans sa vie publique, nous voulons donner les extraits de cette lettre, que lui-même adressa à son fils, le jour de la majorité de celui-ci, le 3 juillet 1859 et qui est une sorte de testament spirituel.
L'âge est venu, la sagesse politique aussi, le désintéressement touchant est resté et à notre époque où tend à se développer ce qu'on a appelé « la politique alimentaire» cette lettre mérite de terminer dans le ton noble et modeste cet ouvrage consacré au souvenir de nos Grands Belges de Liège :
« Apportez tous vos soins à devenir un bon citoyen... et si plus tard quand vous vous sentirez assez de talent, de désintéressement, de loyauté et de patriotisme pour vous dévouer au service de votre pays, si votre intervention est réclamée, vous n'avez pas le droit de refuser, parce que l'homme se doit à sa patrie ; et quel que soit le poste où vous soyez appelé, souvenez-vous que les fonctions publiques ne sont pas des bénéfices pour les titulaires, mais de véritables charges créées pour les besoins de la société. Et quand l'homme public a rempli ces devoirs loyalement, quand se posant en face de lui-même et dans le recueillement, il se demande : L'acte que tu as posé, ce vote que tu as émis l'ont-ils été de bonne foi et sans arrière-pensée ? Si sa réponse est favorable, cela doit lui suffire, car le meilleur et le plus sincère juge de l'homme, c'est lui-même. »
Et la lettre se termine par ces mots : « Ces principes, mon cher fils, je vous affirme que je les ai toujours pratiqués autant que je l'ai pu. »