Sabatier Gustave (1819-1894)
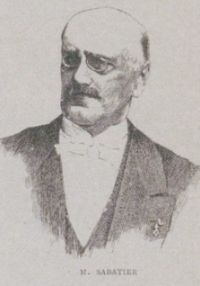
Sabatier Gustave, Charles, Victor libéral
né en 1819 à Paris (France) décédé en 1894 à Bruxelles
Représentant 1857-1870 et 1874-1894 , élu par l'arrondissement de CharleroiBiographie
(Extrait de : E. BOCHART, Biographie des membres des deux chambres législatives, session 1857-1858, Bruxelles, M. Périchon, 1858, folio n°91)
SABATIER, Charles-Gustave
Né à Paris, le 15 novembre 1819,
Représentant, élu par l’arrondissement de Charleroi
M. Sabatier, né à Paris de parents belges, entra à l'école militaire de Bruxelles en 1836.
Sous-lieutenant en 1838, il sortit de l'école d'application pour entrer dans la carrière industrielle, suivant ainsi l'exemple de plusieurs de ses camarades d'école qui occupent aujourd'hui de hautes positions dans l'administration des ponts et chaussées et du chemin de fer.
On sait que les études de l'école militaire sont les mêmes que celles de l'école polytechnique, qui fournit des ingénieurs civils et militaires, et que les principaux métallurgistes de France sont sortis de cette institution.
Obligé de se mettre au courant des détails pratiques de l'industrie métallurgique, dont les théories seules lui avaient été enseignées, M. Sabatier débuta comme simple employé ; son intelligence et son activité lui firent bientôt obtenir le poste de Directeur de fabrication; il est depuis quelques années directeur-gérant de la Société des hauts-fourneaux et charbonnages de Monceau-sur-Sambre, l'une des plus importantes du pays.
Tout entier à ses travaux industriels et aux intérêts qui lui sont confiés, M. Sabatier n'avait voulu accepter aucune fonction publique, si ce n'est celle de membre du bureau de bienfaisance de la commune de Monceau-sur-Sambre.
Lorsque, en 1857, le parti libéral fit appel à tous les dévouements, M. Sabatier répondit au vœu que lui exprimèrent les électeurs de l'arrondissement de Charleroi, en acceptant la candidature qui lui fut offerte pour le corps législatif. Il fut nommé, à une immense majorité, Membre de la Chambre des représentants.
A peine entré à la Chambre, il fit partie de la commission de l'industrie.
De nombreux rapports, présentés par l'honorable député de Charleroi, au nom de cette commission, ont donné à la fois la preuve de son savoir et de son expérience.
Il s'occupe plus particulièrement des questions d'ordre matériel, et défend énergiquement les intérêts industriels si nombreux de son arrondissement.
M. Sabatier, fils de ses œuvres, est arrivé à la plus haute position dans l'industrie ; le titre de membre de la Chambre des représentants, l'élève au plus haut degré civique.
Travail et talent, voilà la fortune de l'honorable député de l'arrondissement de Charleroi.
(Extrait de la Gazette de Charleroi, du 12 mai 1894)
Mort de M. Gustave Sabatier
Le doyen de la députation de Charleroi à la Chambre. M. Gustave Sabatier, vient de mourir. Depuis quelque temps, sa santé, ébranlée par les inquiétudes que lui avait données l'année dernière une grave maladie de Mme Sabatier, inspirait certaines alarmes de son entourage. Ces alarmes devinrent tout à fait vives à la suite d'un refroidissement que contracta dernièrement M. Sabatier. Elles n'étaient que trop justifiées et dans l'après-midi de jeudi, notre vénérable représentant succombait aux conséquences de ce mal qui avait achevé de saper une existence toute de labeur.
M. Sabatier était né à Paris en 1819. D’abord officier du génie dans l'armée belge, de bonne heure il fut mêlé à l'activité industrielle de notre bassin et sa vie est tout entière dans celle de notre mouvement économique depuis lors.
Il débuta à la Société des Hauts Fourneaux et Usines de Monceau en 1845 comme ingénieur directeur de fabrication. En il devient directeur- gérant. A celte époque le charbonnage de Bayemont faisait partie de la Société de Monceau. En 1873 ce charbonnage est constitué en société distincte: M. Sabatier en est un des premiers administrateurs et il reste Monceau en qualité d'administrateur-délégué, puis de président du conseil d'administration lorsqu'en 1878 M. Arthur Bron est nommé directeur-gérant.
Dans l'intervalle, ses hautes capacités avaient appelé sur lui l'attention du monde politique. Le parti libéral l'envoie pour la première fois à la Chambre en 1857, lors de la grande tourmente. Il était entré dans l'arène avec celui qui devait être son alter ego, le plus fidèle compagnon de ses luttes politiques et économiques, M. Eudore Pirmez. Il est réélu en 1861, en 1864, lors d'une dissolution, et en 1866. En 870 survient à Charleroi la fameuse scission provoquée par M. Charles Lebeau. Au scrutin régulier de juin, M. Sabatier est élu au ballotage. Mais la dissolution est prononcée, et, à l’élection du 2 août de la même année, M. Sabatier reste sur le carreau avec M. Hippolyte Defontaine, autre candidat libéral. M. Eudore Pirmez échappa seul au naufrage de notre liste. M. Baliseaux s’était posé à cette époque comme indépendant ; il fut élu avec trois candidats de la liste catholique, MM. Adolphe Brion, Eug. de Dorlodot et Albert Hermant.
Cette méconnaissance du talent de M. Sabatier par le corps électoral ne devait pas durer longtemps. Aux élections qui suivirent immédiatement, en 1871, on le renvoya occuper à la Chambre le siège où il s’était déjà brillamment distingué et qu’il ne devait plus cesser d’occuper jusqu’au jour de sa mort.
En 1886, il eut, il est vrai, l’amertume d'être envoyé au ballotage d'où il sortit en tête de liste. Mais, par contre, quel hommage éclatant on lui rendit à diverses reprises, lorsque, désireux de prendre un repos bien gagné, il voulut rentrer dans la vie privée ! La manifestation dont il fut l’objet à cet égard, le 29 mars 1882, en même temps que M. Eudore Pirmez est encore présente au souvenir de tous. Elle fut provoquée par l'honorable secrétaire de l’Association charbonnière, M. Stainier, qui se fit l’écho du monde industriel tout entier pour démontrer que la disparition de deux hommes aussi distingués par le talent et le caractère que MM. Sabatier et Pirmez serait un véritable désastre pour notre bassin. La politique paraissait d'ailleurs avoir désarmé vis- à-vis d’eux et ce fut d’un élan unanime que trois à quatre cents industriels se groupèrent pour faire renoncer MM. Sabatier et Pirmez à leur projet de retraite. Ce groupe imposant se rendit à Bruxelles et M. Frison, président de la commission organisatrice, se fit son interprète en excellents termes. Nos deux députés résistèrent longuement et vivement. Mais ils finirent par être vaincus dans cette joute oratoire où, pour rappeler l'expression heureuse de la Revue industrielle, « les sentiments les plus affectueux de part et d'autre formaient les principaux arguments. »
Cette manifestation trouvait principalement sa justification dans une mission de la plus haute importance confiée à M. Sabatier, celle de délégué consultant dans les négociations pour le renouvellement du traité de commerce avec la France. En cette matière délicate, la collaboration de M. Sabatier était aussi précieuse que celle de M. Eudore Pirmez dans tous les Congrès où s'agitait la question monétaire. M. Sabatier justifia la confiance que l'on avait mise en lui par le rapport remarquable qu'il présenta à la Chambre à l’occasion de ce traité et qui contribua par-dessus tout à établir sa haute réputation d'économiste.
Le gouvernement belge et le gouvernement français proclamèrent à l'envi les services qu'il avait rendus en cette circonstance aux intérêts industriels et commerciaux des deux nations en le nommant à fois commandeur dans les ordres de Léopold et de la Légion d'honneur.
Ce fut là l'occasion d'une manifestation nouvelle et presque sans précédent, en l'honneur de M. Gustave Sabatier. Elle fut organisée cette fois par la chambre de commerce de Charleroi, auprès de laquelle il avait également joué le grand rôle.
Il en avait été nommé membre en 1870, en remplacement de M. Jean Wautelet, décédé ; l'année suivante il devenait vice-président en remplacement de M. Godefroid Goret et gardait ces fonctions jusqu'en 1872, époque à laquelle il succédait à M. Dominique Jonet en qualité de président.
M. Gustave Sabatier fut le dernier président de la chambre de commerce officielle de Charleroi supprimée avec les institutions similaires du pays par la loi du II juin 1875 et le premier président de la Chambre d'industrie, d'agriculture et de commerce créée en 1877. Chaque année le conseil général lui avait renouvelé son mandat.
La chambre de commercé de Charleroi saisit donc avec empressement l'occasion de fêter le président qui lui avait imprimé une activité toute spéciale et qui l'avait dirigée avec sa sagesse. sa distinction et son tact habituels.
Le 9 octobre 1882, elle lui fit en grande solennité la remise d'une médaille d'or de grand module représentant le profil de M. Sabatier„ gravé par Wener. Au revers, la médaille portait cette légende : « La chambre de commerce à son président, Gustave Sabatier, commandeur de l'ordre d e Léopold et de la Légion d'honneur, membre de la Chambre des représentants. - Témoignage de reconnaissance – 1882. »
La Chambre de commerce de Charleroi, qui avait fonctionné pendant un demi-siècle, n'avait jamais rendu pareil honneur qu'à l'un de ses membres, M. Jean Wautelet : C'est lorsqu'elle fit remise d'une médaille d'or à sa famille, le 28 février 1872, en commémoration des services qu'il avait rendus à l’institution pendant une carrière présidentielle de plus de vingt années.
M. Alfred Maroquin, qui était vice-président de la chambre de commerce, à l'époque de la manifestation Sabatier, énuméra d'éloquente façon les titres que le regretté défunt d'aujourd'hui avait déjà alors à la reconnaissance publique. II rappela notamment que les fonctions de ministre des travaux publics lui avaient été offertes en 1881, à la démission de M. Sainctelette. Pour des considérations personnelles M. Sabatier refusa, au grand regret de tous ceux qui avaient espéré voir entrer pour la première fois un des membres de la députation carolorégienne au ministère des travaux publics.
« Ces marques de haute considération qui s'est attachée à sa personne, disait M. Maroquin, M. Sabatier les doit surtout à une infatigable activité mise au service d'un esprit réellement supérieur. Qu'il soit à la Chambre de commerce ou au Palais de la Nation, sa parole, toujours sobre et claire, fait autorité : on l'a vu, à la législature, depuis près de vingt-cinq ans, prendre part à toutes les discussions sur les questions économiques qui intéressent le pays et spécialement l'arrondissement de Charleroi. La situation qu'il s'est faite, il la doit à la façon remarquable dont il a toujours présenté ou défendu les questions de transport, de tarifs de chemin de fer, de péages, de tramways, de canaux, les questions monétaires, de tarifs douaniers, de traités de commerce, de liberté commerciale. M. Gustave Sabatier, dans toute sa longue et laborieuse carrière, est resté l'un des porte-drapeau de la bienfaisante doctrine du libre échange et c'est avec un zèle digne des plus grands éloges qu'il n'a cessé de la défendre et de la propager
Nous ne saurions définir de plus sobre mais de plus exacte façon le rôle que M. Sabatier joua pendant toute la durée de sa carrière parlementaire. C’est lui qui à la Chambre lança les questions de réductions des droits de péages sur les voies navigables et sur les chemins de fer. Il leur donna une grande ampleur, et par l'autorité qu'il avait conquis sur le gouvernement et sur ses collègues il contribua pour une large part dans les satisfactions qui furent accordées à nos industries.
Bien que son esprit fût ainsi sans cesse tourné vers les questions économiques et qu’il fit peu de politique à la Chambre, M. Sabatier a toujours été un inébranlable libéral, qui n'a jamais connu les défaillances. Aussi, en 1892, lors des élections pour la Constituante, comme il avait de nouveau manifesté l'intention de se retirer de la vie publique, l'Association libérale de notre arrondissement fit de grands efforts pour combattre sa résolution et conserver à notre liste le prestige de son nom.
Elle invita les présidents de nos différentes associations industrielles à se joindre à elle pour tenter auprès de M. Sabatier une démarche qui eût le caractère d’une manifestation émanant à la fois de la politique, du commerce et de l'industrie. La démarche eut lieu le 20 avril au Palais de la Nation ; elle eut un heureux résultat et la Constituante de 1893 compta M. Sabatier parmi ses membres. II s'y prononça, on le sait, dans le sens de la plus extension du droit de suffrage.
Cependant ce grand travailleur avait été touché par l'âge et par la fatigue. Depuis un certain temps il avait résigné les différentes fonctions qu'il occupait dans les conseils d'administration de nos industries. Les cléricaux, oublieux des services rendus, en profitèrent pour demander la radiation de M. Sabatier de la liste des électeurs de Monceau, où il était domicilié depuis 46 ans et où il s'honorait d'être membre du bureau de bienfaisance depuis à peu près autant de temps. Les pauvres et les malheureux de Monceau savent le bien que M. Sabatier leur a fait en cette dernière qualité et son nom restera certainement dans leur souvenir. La manœuvre des catholiques de Monceau fut d'ailleurs jugée par tous les hommes sensés comme la marque d'une petitesse d'esprit et d'une mesquinerie sans nom.
Tandis qu'ils cherchaient à frapper d’ostracisme un homme que tous, catholiques et libéraux, eussent dû s'estimer fiers de compter au nombre de leurs concitoyens, le Roi donnait à notre regreffé représentant une nouvelle marque de la haute estime dans laquelle il le tenait depuis longtemps. Par ses instances aussi vives que flatteuses, il le forçait à renoncer à ses idées de repos absolu et à apporter à l'œuvre naissante du Congo l'appui de son expérience. M. Sabatier déféra d'ailleurs avec un complet dévouement au désir royal parce qu'il entrevoyait là le moyen de faire bénéficier le commerce belge de cette noble et vaste entreprise. Il accepta la présidence de la Société mère du commerce au Congo, Société dont sortirent les compagnies actuelles.
Si haute que fût la situation de M. Sabatier jamais il ne dépouilla la bonhomie, la franchise et l'obligeance qui l'avaient toujours rendu accessible aux plus humbles. Son affabilité était exquise et sa causerie d'un charme inexprimable. Toujours il mettait avec une bonne grâce sans bornes son autorité, sa compétence et ses connaissances au service de ceux qui allaient les lui réclamer. Quant à ceux, plus heureux, qui étaient entrés dans son amitié, c'était une véritable affection qui le liait à eux et il la leur a gardée jusqu'à son dernier souffle.
Comme Eudore Pirmez, M. Gustave Sabatier laissera dans l'histoire industrielle du bassin de Charleroi un souvenir impérissable.
Ses funérailles civiles auront lieu lundi 14 courant, à 2 heures de l'après-midi, au cimetière d'Evere. Notre regretté représentant a demandé à être enterré sans le moindre apparat, sans honneurs militaires ni discours.
Il avait été promu dans ces dernières années au grade de grand-officier de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre de la Légion d'honneur.
(Extrait de : E. DISCAILLES, dans Biographie nationale de Belgique, t. XXI, 1911-1913, col. 1-7)
SABATIER (Gustave- Charles), industriel et homme d'affaires, membre de la Chambre des représentants, né à Paris, le 15 novembre 1819, mort à Bruxelles, le 10 mai 1894. Son père, Gaspard-Bertrand, originaire de Thaun (Bas-Rhin), vivait depuis 1813 en Belgique ; il y occupait un modeste emploi dans la maison de banque bruxelloise Odier-Roman et Anspach et épousa, le 22 juin 1815, Françoise, Josèphe Stapleaux, née à Bruxelles le 10 août 1796.
Entré à l'école militaire de Bruxelles en 1836, Gustave serait devenu, dans le génie, un officier des plus distingués, mais, l'industrie l'ayant tenté, il changea de carrière, conservant toujours, de ses études initiales et de sa première éducation, une précision mathématique et une énergie toute militaire.
Après avoir débuté à Ougrée, où il se lia avec son futur beau-frère, l'ancien capitaine d'artillerie Hochereau, administrateur et hygiéniste de réelle valeur, Sabatier devint, à 30 ans, directeur de fabrication à la Société des Hauts-Fourneaux de Monceau-sur-Sambre.
En 1850, la direction de la Société de Monceau-sur-Sambre et des Charbonnages de Bayemont lui fut confiée.
li paraissait bien décidé à n'accepter (dit la publication Bochart) d'autre fonction publique que celle de membre du bureau de bienfaisance de Monceau, qu'il remplissait avec un dévouement rare et une parfaite intelligence des besoins de la classe ouvrière, depuis l'année 1848. lorsque survinrent les agitations politiqua de 1857. Cédant aux instances des chefs du parti libéral carolorégien, il accepta, le 10 décembre, avec Lebeau et Pirmez, une candidature à la Chambre des représentants en compétition avec Dechamps, Brixhe et Wautelet, défenseurs de la loi dite des couvents. Ni le prestige du nom de Dechamps, ni son éloquence, ni son titre de ministre d'Etat ne purent le sauver ce jour-là : Sabatier le distança de près de 1,500 voix sur 2,500 votants.
Sabatier ne garda pas, comme l'ont dit par erreur quelques journaux, son mandat parlementaire toute sa vie. Il fut éliminé de la Chambre, treize ans après. Il avait cependant fait vaillamment sa tâche de député de 1857 à 1870. Assidu aux séances de la Chambre, il avait traité avec une rare compétence quantité de questions industrielles, commerciales, financières, ne se préoccupant pas exclusivement des intérêts spéciaux charbonniers et métallurgiques de l'arrondissement de Charleroi, mais des intérêts généraux du pays, discutant aussi habilement les affaires politiques que les affaires d'argent. Très versé dans les sciences économiques, aucune question fiscale ne le trouvait indifférent, Les tarifs douaniers, le régime des transports, les débouchés commerciaux furent l'objet de sa constante attention. Le nombre de ses rapports est considérable : la netteté, la précision sobre les distinguent. Il avait le véritable langage des affaires.
En attendant que le renouvellement de la Chambre fournit aux électeurs de l'arrondissement l'occasion de le renvoyer au Parlement, où il rentra en juin 1874 pour n'en plus sortir qu'à sa mort, et où il fit preuve des mêmes qualités et rendit les mêmes services que de 1857 à 1870, les commerçants et les industriels du pays carolorégien lui donnèrent, dès le mois de novembre 1870, un témoignage de sympathie en le nommant membre de la chambre de commerce. Le 24 octobre 1871, il en fut élu vice-président et, le 28 février 1872, président. La loi du 11 juin 1875 ayant supprimé les chambres de commerce officielles, il fut, le 18 février 1878, le premier président de la chambre d'industrie, d'agriculture et de commerce créée en 1877 et, chaque année, le conseil général lui renouvela ce mandat. La chambre carolorégienne admirait surtout, en Sabatier, l'ardeur avec laquelle, libre-échangiste convaincu comme l'étaient presque tous ses membres, il défendait, partout où il en avait l'occasion, les tarifs douaniers libéraux.
« Le salut de nos industries, » ne cessait-il de répéter, et il le disait encore le 9 octobre 1882 lorsque, dans une manifestation mémorable à laquelle prirent part cinq cents industriels el négociants, on fêta sa nomination de commandeur dans l'Ordre de Léopold (il avait été nommé chevalier en 1861 et officier en 1870), « le salut de nos industries est dans le progrès. S'arrêter, c'est déchoir. La plus solide garantie de nos intérêts est dans l'initiative privée. Nous ne réclamons que les armes qui favorisent nos concurrents étrangers. » Il demandait l'amélioration du tarif douanier dans le sens de la liberté la plus complète et disait, en terminant, à ceux que la crainte de la concurrence étrangère rendait encore hésitants à ouvrir toutes larges nos portes : « Nous vous opposons ces années qui occupent une place si importante dans l'histoire de notre régime commercial, 1851 et 1861, pour les comparer entre elles et aussi pour les comparer à l'année 1881 et nous inscrivons en regard de ces millésimes les chiffres respectifs et suffisamment éloquents de 200 millions, 430 millions et 1,250 millions de francs, montant de nos exportations… A tous égards, la voie suivie est la bonne ; elle donne le travail et l'aisance, il y faut persévérer sans nous laisser atteindre par la défection de quelques grandes nations au principe de la liberté. » L'album remis à Sabatier à cette occasion était décoré, par Constantin Meunier, de dessins représentant un bouilleur, un puddleur, un souffleur,. un tailleur de pierres, un faucheur (première idée du Monument du travail).
Bien des associations, comme celle de l' Union syndicale de Bruxelles, s’associèrent aux industriels et négociant du bassin de Charleroi. Elles avaient tenu à prouver à Sabatier que le malheur qui venait d'atteindre une grande institution, la Banque de Belgique, dont il était administrateur, ne lui avait rien enlevé de la confiance et de la sympathie qu'il leur inspirait, et dont il s'était montré du reste plus digne que jamais en donnant à ceux que le désastre frappait la très grande partie de sa fortune.
Le gouvernement, lui aussi, avait conservé à Sabatier sou entière estime. Le 22 septembre 1881, le chef du cabinet, Frère-Orban, le nommait délégué consultant dans les négociations qui allaient s'ouvrir à Paris pour le renouvellement du traité de commerce de la Belgique avec la France, et il remplit avec un vif éclat cette mission. Son rapport à la Chambre est celui qui a le plus contribué à établir sa haute réputation d'économiste (Traité de commerce avec la France du 31 octobre 1881, Annales parlementaires).
Quelques semaines plus tard, quand Sainctelette fut obligé, par la maladie, de donner sa démission, c'est Sabatier que le cabinet, répondant, peut-on dire, au vœu général, offrit le portefeuille des travaux publics. Mais celui-ci, qui commençait à prendre de l'âge (il allait avoir 63 ans), et qui redoutait peut-être d'être écrasé, comme Sainctelette, par la lourde tâche qu'on lui offrait, déclina cet honneur.
Nature foncièrement honnête et bonne, ayant des vues larges et généreuses, son activité devait être acquise à l'œuvre de civilisation qu'entreprit Léopold II. Nous trouvons son nom dans le comité belge de l' Association internationale pour réprimer la traité et occuper l’Afrique centrale, qui tint sa première séance le 6 novembre 1876. Il fut des premiers à comprendre l'influence que la colonisation exercerait sur la Belgique, et la société mère des entreprises du Congo lui confia la présidence de son groupe. D’ailleurs, à tout instant on faisait appel à sa grande expérience et à son rare bon sens. De nombreuses sociétés, entre lesquelles il partageait son activité, purent compter sur lui dans des circonstances difficiles, les divers cabinets également. Même un de ses adversaires, politiques, Mr de Moreau. ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. lui envoya, au lendemain de la mission de haute confiance qu'il remplit en 1887, une lettre de remerciements conçue en termes chaleureux (8 juillet).
On retrouve un langage pareil dans la lettre qu'un ministre français, Mr Tirard lui adressait, deux ans après, pour lui confier le poste si délicat et si élevé de président du jury de métallurgie à la grande exposition de 1889. On avait appris à le connaitre d'ailleurs en France, où les brillantes qualités qu'il avait déployées dans diverses occasions, et spécialement lors du traité de 1881, lui avaient valu le grade de commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur.
Bien qu'il n'aimât pas se mêler aux petits détails de ce que nous pourrions appeler « la cuisine parlementaire », il prenait part aux débats politiques du moment qu'ils prenaient une certaine envergure. Il avait une finesse de langage, une verve et un esprit caustique qui parfois emportaient la pièce; lorsque, dans son premier séjour au parlement, on discutait cette éternelle question du cens où la Chambre passa souvent le plus clair de son temps. Indépendant dans l'honnête sens du mot, il savait différer d'opinions avec ses meilleurs amis politiques. Sur la question du sucre, sur celle de la monnaie, etc., etc., il ne jura pas toujours in verba ministri. Il en différa surtout la fin de sa vie.
Lors de la révision de la Constitution, en 1893, contrairement l'avis de Frère et Bara, il reconnut pour son parti la nécessité d'une évolution dans le sens du suffrage universel. Cette évolution lui paraissait s'imposer au libéralisme du jour où la révision fut décidée. Il était dominé par cette conviction depuis le retour des catholiques aux affaires en 1884. Les tristes événements de mars 1886, dans les pays industriels et la dernière grève des houilleurs, qu'il travailla habilement à calmer au commencement de 1898, l’y avaient confirmé.
Au début de la discussion, il donna l'assurance à Alphonse Nothomb, un député catholique qui était partisan décidé du suffrage universel, que, sur ce terrain, lui et quelques-uns de ses coreligionnaires pourraient sans doute, moyennant quelques concessions, arriver à un accord utile au peuple. Telle est l'origine de la proposition que, conjointement avec MM. Janson, Houzeau de Lehaie, Fléchet, Paternoster et Brouwet, il déposa le 29 mars 1893 et qui fut appelée la proposition des XXVI parce que vingt autres députés déclarèrent le jour même y adhérer.
Les représentants seraient élue directement par les citoyens âgés de 25 ans au moins; la durée de résidence nécessaire pour acquérir le droit de vote serait de deux ans au plus ; la loi pourrait accorder un double vote aux chefs de famille ; telles étaient les grandes lignes de cette proposition à laquelle Sabatier ne réussit pas rallier ses vieux compagnons de lutte, les Frère, les Bara, les Sainctelette et ce lui fut, nous le savons de source certaine, une douleur amère.
Sabatier était presque à la veille de l'élection mémorable de juin 1894 lorsque la mort l’atteignit.