Robert Eugène (1839-1911)
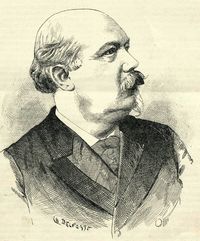
Robert Eugène, Firmin, Antoine libéral
né en 1839 à Gand décédé en 1911 à Ixelles
Représentant 1882-1884 et 1892-1894 , élu par l'arrondissement de BruxellesBiographie
(Extrait du Peuple, du 23 mars 1911)
Dans la bousculade des événements politiques d’hier et dans la hâte de la confection des dernières éditions, il ne nous a été permis que d’envoyer un hommage d’émotion et de tristesse accablée au prestigieux maître de la parole, au bon et vaillant démocrate, que la mort venait de nos enlever.
Nous devons à nous-mêmes, à l’idée démocratique, que Eugène Robert servit avec un si pur et noble désintéressement, d’évoquer une fois encore cette physionomie toute de finesse, d’intelligence et de droiture.
Eugène Robert meurt drapé dans l’honneur de sa vaillante et probe carrière, mais dépourvu des honneurs que la politique rapporte à d’aucuns. Il s’efface, presque inconnu de la génération actuelle dans un injuste et inexcusable oubli. Et pourtant il fut un des grands orateurs de notre vue publique nationale, un de ces remueurs d’idées dont la personnalité éveillait l’enthousiaste admiration de la jeunesse.
Quand, dans les vastes assemblées publiques d’il y a vingt ans, aux temps héroïques de la bataille contre le censitarisme, le nom d’Eugène Robert était prononcé, à l’égal de ceux de Paul Janson et ou de Jean Volders, il déchaînait les ovations.
Et pourtant le secret de son éloquence ne résidait pas dans la mâle énergie, dan la puissante pesée de volonté qui dompte les foules. Les tribuns ont l’art spontané de conquérir ces foules ; Eugène Robert avait l’art de les séduire et de les captiver. Ce qui le frappait dans la justice, c’était sa beauté rayonnante et cette beauté, Eugène Robert la mettait en relief avec un charme pressant et délicat, connaissant jusque dans les moindres recoins l’admirable coffret à joyaux qu’est la langue française, y puisant les pierreries les plus étincelantes pour parer et enjoliver la phrase, restée claire et lumineuse pourtant. Il démontait avec éloquence, la mauvaise réputation du meeting que les snobs de l’aristocratie littéraire dénomment injustement l’école de vulgarité publique.
Avec Eugène Robert, à la tribune, aucune de ces choquantes surprises n’était à redouter. Par contre que de trouvailles heureuses, que de tras d’une ironie exquise parce qu’elle désarmait par la bonne humeur sans tuer par le ridicule et la charge.
Cette ironie était le reflet d’un visage fin, frais et rose, comme le masque d’un adolescent, joliment encadré par les mèches folles d’un artiste et tout éclairé par des yeux railleurs de philosophie épicurien. Pourtant cet ironiste n’était pas un sceptique et moins encore un égoïste ; il avait aussi le don précieux entre tous de la bonté, de la bonté fière d’aller jusqu’au désintéressement total et insouciante d’être conduite jusqu’à la naïveté.
C’est cette bonté qui le poussa à défendre le prolétariat, la classe laborieuse, quand celle-ci, trop déprimée par la misère et l’ignorance, ne songeait pas à s’émanciper.
En 1868 – il avait alors 28 ans, étant né à Gand en 1840 – il fut e la pléiade des jeunes avocats qui, réclamant le suffrage universel, en lieu et place des travailleurs engourdis, signèrent le fameux Manifeste des Ouvriers.
Les camarades qui partageaient ses espoirs s’appelaient Paul Janson, Edmond Picard, Victor Arnould, Charles Graux et Xavier Olin. Avec eux il fonda la « Liberté » puis, quand se produisit la scission, il suivit [deux mots illisibles] et Emile Feron et fonda le « Libre Examen. »
C’est dans ce sillage que se poursuivit sa vie politique. Ami fidèle et disciple de Paul Janson, il rejoignit celui-ci à la Chambre en 1882 et fut de cette batailleuse extrême-gauche qui tua le doctrinarisme gouvernemental et censitaire.
La campagne révisionniste le vit à la tête du mouvement. Il écrivait dans la « Réforme » des articles étincelants, il parcourait le pays, joignant son chant de joliesse conquérante aux fanfares des tribunes. Aussi fut-il renvoyé à la Chambre muée en Constituante pour tenter d’arracher aux censitaires le suffrage universel.
En 1894, la tourmente cléricale le balaya, avec les autres progressistes.
En 1896, il fut une des têtes de la liste de coalition progressiste-socialiste, qui échoua, à Bruxelles, par la défection des doctrinaires.
En 1900, quand la R.P. permit au parlti libéral de reconquérir sa place parlementaire, Eugène Robert fut oublié. Il n’en témoignant aucune amertume, sa souriante philosophie l’ayant armée contre l’ingratitude des hommes. Il retourna plus fréquemment au barreau, où ses succès, ses interventions éloquentes, notamment au procès De Buck, au procès Peltzer et au Grand Complot l’avaient classé au tout premier rang.
C’est là d’ailleurs qu’il trouvait l’atmosphère adéquate à sa combativité.
Lorsqu’il y a un an et demi, en juin 1909, le barreau tout entier célébra ses « noces d’or avec Thémis » on le vit pour la première fois accablé sous les éloges qui lui semblaient prématurés, destinés à ses funérailles, envahi par la mélancolie.
« J’avais toujours eu la pensée, dit-il, - que j’exprima naguère dans un discours de rentrée de la Conférence du Jeune Barreau sur « le rôle public de l’avocat » - que notre éducation spéciale et les facultés que cette éducation développe, nous prédestinent à la vie publique, à la défense des intérêts généraux et des droits du peuple. Je me rends à moi-même ce témoignage d’avoir été fidèle à cette pensée, à ce devoir. Ma parole et mes efforts n'ont jamais été mis au service que des causes de justice. J’ai été ou je me suis efforcé d’être l’avocat de l’humanité.
« Lorsque enfin j’abandonnai la politique ou pour être plus exact lorsque je fus abandonné par elle, je rentrai dans mon cabinet appauvri et déserté par suite des animosités que mon imprudente ardeur avait suscitées contre mes principes et contre ma personne, je dus m’efforcer par un âpre labeur de reconstruire une situation presque ruinée. Je repris le collier, sans amertume, sans découragements, car je retrouvai mes occupations professionnelles, mes chers dossiers, mes bons confrères et, je goûtai dans ce doux commerce le rafraîchissement et la consolation de mes déboires.
« Regardant en arrière, je vois, dit-il, le passé comme un cimetière, tant il est rempli de tombeaux.
« Je vois approcher l'heure de la vieillesse, et constate que j'occupe le fatidique n°13 dans le tableau du barreau. Mais j'accepte vos hommages fraternels avec joie, avec reconnaissance, parce qu'ils projettent un rayon de fierté, de bonheur sur mon âge mûr. »
Une échappée de joviale finesse dans ce discours fusa dans ce discours mélancolique, quand, avant d’avoir dit un merci affectueux, Eugène Robert se garda, dit-il, de prononcer le mot de vieillesse, de crainte d'appeler celle qui l'a oublié.
Elle est venue, cette fois, emportant un être exquis et bon, gloire et honneur de sa corporation autant que de la démocratie.
Le Parti ouvrier se gardera d'ajouter une ingratitude à celles qui arrêtèrent le sourire sur cette bouche moqueuse et embrumèrent de larmes ces yeux spirituels et doux. Il n'oublie pas qu'Eugène Robert défendit les travailleurs quand il n'y avait pas de parti pour les soutenir, qu'il créa le comité de défense juridique qui soutint leurs droits devant la justice : qu'il plaida avec la magie de son éloquence élégante et ferme, la plus grande des causes : celle de l’égalité politique.
Tout cela explique notre émotion, justifie nos regrets et commande notre profond et respectueux homme suprême.
F. F.
(Extrait de La Meuse, du 22 mars 1911)
La mort d’Eugène Robert
Ce n'est pas sans un profond regret que la Chambre a appris la mort d’Eugène Robert.
Eugène Robert, personnalité très en vue du barreau bruxellois, était Liégeois, mais le hasard voulut qu'il naquit en chemin de fer, c'est-à-dire, accidentellement au moment où le convoi amenait Mme Robert à Gand.
Robert s'en voulait, lui esprit essentiellement français, d'être né en pays flamand. Son père était fonctionnaire de l'Etat ; il laissa, à sa mort, son fils sans fortune. Devenu avocat, Eugène Robert fit montre de beaucoup de talent. Il eut bientôt une clientèle. Il plaida des procès célèbres, entre autre celui des frères Peltzer. Les affaires de divorce surtout l'intéressaient. Il y mettait infiniment d'esprit. Son éloquence était très châtiée, sa forme vraiment Impeccable.
Robert était un bon bougre qui donnait son argent à tout le monde ; il fut l'éternelle proie des tapeurs : Aussi, meurt-il pauvre.
Il y a une couple d'années, on fêta son jubilé de cinquante années d'avocat. Ce fut une belle fête à laquelle prit part tout le barreau. Il allait régulièrement au Palais de Justice ; mais depuis quelque temps, la voix commençait à lui manquer ; elle était réduite à un mince filet. Et cela le désolait profondément.
Eugène Robert était né le 4 juillet 1839.Il fut élu député de Bruxelles le 20 février 1882, en remplacement de M. Alexandre Jamar, démissionnaire. Le 10 juin 1884, il dut céder sa place à un indépendant. M. Slingeneyer. De nouveau candidat en 1894, il mordit la poussière.
Il appartenait au petit groupe Janson-Denis-Picard-Feron, qui, il y a une trentaine d'années, agitèrent « les grelots progressistes » si funestes au parti libéral.
Robert était célibataire. Il habitait depuis longtemps une jolie maison, rue du Prince Royal, à Ixelles, où, sous des apparences de fastes, il cachait assez bien un état qui confinant parfois à la gêne.
Les mots d’esprit d’Eugène Robert ne se comptent plus ; on pourrait en faire tout un livre.
Pauvre vieux Robert, il n'y a pas 15 jours que je l'ai aperçus à son balcon ; il fumait un misérable brûle-gueule et, souriant, se chauffait au soleil !
Valentin de Maroy.
(Extrait de La Dernière Heure, du 24 mars 1911)
Les funérailles d'Eugène Robert
Ah ! la douce, la sincère émotion, que celle éprouvée devant la bière du Maitre aimé qui vient de disparaître! Il semblait que l’âme gracieuse et charmante du spirituel avocat planait dans cette chambre funèbre, qu'elle épandait une atmosphère de cordialité sereine, de mélancolie poétique, de tristesse que l'on eut dite langoureuse ! C'était aussi la simplicité de cette même âme qui se révélait dans le sobre décor du petit salon où Eugène Robert vécut sa vie et dans lequel, par une attention délicate et filiale de ses anciens collaborateurs, de ses amis, il acheva, couché dans le cercueil, ses dernières heures ici-bas ! Nul bruit autour de ce mort charmant, mais le calme absolu, religieux et profond, - le môme qui s'emparait des auditoires dès que la vox claire et harmonieuse de l'orateur se faisait entendre.
C'est le Barreau qui voulut assumer la charge et l’honneur des funérailles de celui dont, il y a deux ans à peine, il fêta si glorieusement le cinquantenaire professionnel.
Et il y avait là, pour représenter la « famille judiciaire », Maîtres Edmond Picard, G. Sahoenfeld et Latour ; le bâtonnier Botson ; De Jonghe, Coosemans, Georges Lorand, Feron, père et fils : P.E. Janson, Fernand Cocq, Hector Denis.
Eugène Robert ne possédait plus que de lointains parents ; ceux-ci étaient représentés par MM. Roestenberg, de Malines.
Le défilé a été long. Nous avons noté : MM. Samuel Wiener, Hanrez, Goblet d'Alviella, Lambillotte, L a Fontaine, sénateurs ; Duray, bourgmestre d'Ixelles ; Lemonnier, Hymans, députés ; Janssen, Jules Janson, députés permanents ; Coppez, père, oculistes ; l'écrivain Camille Lemonnier, Cattier, Monseur, professeurs à l’université ; Van Langenhove, président du conseil des hospices ; Guillaume De Greet, E. Flagey, Raymond Bôn, avocats ; Max, échevin à Schaerbeek, etc., etc.
Maître Bodson, en sa qualité de bâtonnier a, le premier, rendu hommage au défunt.
« La mort frappe à coups répétés la grande famille du barreau, a-t-il dit, mais parmi les disparus, la perte que nous pleurons aujourd’hui nous atteint particulièrement. Il s'en est allé sans secousses et sans souffrances, presque souriant. Après les luttes de la politique autour de son nom s'est fait le calme qui a mis admirablement en relief sa belle vie professionnelle. Sa parole était d'une exquise pureté ; son langage ignorait le trait qui blesse. Sa logique s'enveloppait de toutes les séductions d'une profonde érudition. Il marcha bientôt de succès en succès. En 1865, il fit un discours-type sur lé rôle public de l'avocat ; ce discours fut pour lui un guide sûr et fidèle. Il connut la fièvre des luttes victorieuses en assises et conserva partout sa personnalité si fine.
« Mais la beauté de son talent n'était rien à côté de la beauté de son caractère. La majesté de la mort ne changera rien à son souvenir ; elle ne fera que le glorifier davantage, car ii a réuni en lui toutes les vertus professionnelles. »
M. Georges Lorand, an nom du Conseil général de la fédération progressiste, a salué en Maître Robert, l'un des plus brillants représentants de la pléiade qui furent nos précurseurs dans la démocratie. Il fut l’avocat des ouvriers à l'heure où il n’y avait pas de parti socialiste : il se fit, avec un noble dévouement, le défenseur de tous les proscrits. C'était un polémiste à la plume alerte, légère, spirituelle : son style, que personne n'égala, rappelle celui de Camille Desmoulins. La Belgique n’a pas fait à Robert, orateur et écrivain, la place qu'il méritait : seul le barreau a su l'apprécier comme il convenait. Il avait peu le souci des honneurs et des mandats; mais il eut la joie de voir le parti libéral tout entier se ranger aux idées qu’il avait défendues toute sa vie.
M.. Fernand Cocq, président de l'Association libérale, s’est exprimé ainsi
« L’Association libérale et Union Constitutionnelle de l'arrondissement de Bruxelles porte le deuil d'un de ses chefs les plus illustres et les plus aimés.
« Associé depuis un demi-siècle à toutes les manifestations de son activité, à toutes les glorieuses campagnes qu'elle a poursuivies pour le triomphe de l'égalité politique et le respect des droits de la conscience, il lui est resté inébranlablement fidèle jusqu'à la mort.
« Présenté pour la deuxième fois par elle aux suffrages du corps électoral, en février 1882, il fut envoyé au Parlement où il occupa tout de suite une place en vue dans cette brillante pléiade de l'extrême-gauche, qui comptait des hommes comme Adolphe Demeur, Victor Arnould, Paul Janson, Emile Feron. Sa parole châtiée, spirituelle et mordante, sa vaste érudition, l'inébranlable fermeté de ses principes faisaient de lui un « debater » accompli, destiné à fournir une éclatante carrière parlementaire.
« La débâcle de 1884 l'enleva à la tribune nationale, d’où il resta exilé pendant huit années.
« En 1892, une élection triomphale envoya à la Constituante une députation bruxelloise entièrement libérale, dans laquelle figurait Eugène Robert dans tout l’éclat de son talent.
« Sa mort cause parmi nous d'universels ct douloureux regrets !
« Cher et vaillant ami, ton souvenir restera longtemps enveloppé de notre gratitude et de notre affection. Il y a deux ans, tu disais, en caractérisant toi-même ta carrière d'avocat, ces mots si profondément vrais et qui peuvent s’appliquer aussi à ta carrière politique : « Ma parole et mes efforts n'ont jamais été mis au service que des causes de justice. J'ai été ou je me suis efforcé d'être l'avocat de l'humanité. »
« Oui, tu l'as été toute ta vie et de tout ton cœur et c'est le plus bel éloge qu'on puisse faire de toi à ce moment de l’éternel adieu ! »
M. Lerat, au nom de la Loge les Amis Philanthropes N°1, a rappelé la vie maçonnique d’Eugène Robert. Il entra dans l'ordre en 1875. Jamais il ne se dépouilla de ses vertus : la loyauté et le désintéressement. Il reste l'image la plus pure et la plus nette du désintéressement et l’on peut répéter ses paroles à savoir : « Que tous ses efforts ne contribuèrent qu'à un but : le bien-être de l'humanité ! »
Les discours sont terminés. Le cortège précédé de drapeaux bleus, se dirige par l’avenue Louise vers le cimetière d’Ixelles. (…)
(Extrait du Journal de Charleroi, du 26 mars 1911)
Avec notre ami Eugène Robert disparaît un de ceux qui furent de l’époque héroïque du socialisme. Dès ses débats, il ne se contenta pas de la revendication des libertés politiques, mais, en nos congrès d’étudiants, il proclamait la nécessité d’étudier t de résoudre les questions sociales. C’est pourquoi, après avoir pris part à la campagne pour le suffrage universel, à laquelle – « momentanément » - collaborèrent les progressistes, et les socialistes, il ne tarda pa à se séparer de ceux qui ne poursuivaient que la conquête des droits politiques, et après avoir qui la première « Liberté » - progressiste – pour fonder avec Paul Janson le « Libre Examen », il devint par la fusion, en 1868, de cet organe avec la « Liberté » (socialiste) collaborateur de celle-ci, fondée en 1867 par Victor Arnould, Guillaume Degreef, Hector Denis, Eugène Hans, Paul Robin et Oscar Van Goidtselhoven. En 1868, par suite de la fusion, « La Liberté » se renforça de la collaboration de Paul Janson, Eugène Robert, Pierre Splingard et Emile Leclercq.
On s’étonnera peut-être du titre choisi par des socialistes pour leur journal ; mais, l’ayant repris des mains des progressistes, nous n’avons pas jugé nécessaire de changer le titre, n’attachant pas d’importance à ce détail. Ce fut une faute, sans doute, puisque, bien peu d’année après, il apparaît que les socialistes n’ont plus conservé le souvenir de nos cinq ans de propagande et nous confondent avec l’organe progressiste ou plutôt ne connaissent que celui-là.
Robert fut, comme journaliste, ce qu’il était comme orateur, étincelant d’esprit et de verve. Mais ici il se révéla sous un aspect que nous ne lui soupçonnions point. En une série d’articles fortement documentés, sous le titre général de « La pieuvre financière », il s’attaqua à la féodalité financière et dénonça le premier chez nous la honteuse complicité des hommes politiques apportant leur concours à ces féodalité contre de grasses sinécures d’administrateurs.
Il fut, naturellement, de l’Internationale, en lorsqu’en 1868, après la fusillade de l’Epine, le gouvernement fit comparaître, devant la Cour d’assises de Mons, une trentaine de houillers et houilleuses, traités en criminels du chef de grève, il fut de la pléiade d’avocats démocrates et socialistes, qui firent acquitter ceux qu’on avait tenté de faire les boucs émissaires des crimes du capitalisme.
En 1869-1870, il prit une art active à la campagne en faveur de la « Représentation du travail », menée principalement par la réaction de la « Liberté » : il s’agissait d’opposer à la Chambre bourgeoise, celle des ouvriers, qui eût représenté la société ouvrière en face de la société bourgeoise et obligé celle-ci à reconnaître les droits de la collectivité ouvrière. Cette campagne, menée dans tous les grands centres industriel et durant laquelle les ouvriers accouraient par milliers entendre les orateurs, fut malheureusement interrompue par la guerre franco-allemande qui eut, entre autres, pour conséquences d’entraver pour un temps le mouvement prolétarien vers l’émancipation.
L’Internationale n’ayant survécu que peu à la guerre de 1870 et à l’écrasement de la Commune – qui ne furent pas d’ailleurs les seuls causes de la chute de celle-là, mais ce n’est pas le moment de nous étendre là-dessus ) Robert se lança dans la politique… d’application, si l’on peut s’exprimer ainsi. Il fut des « huit » (rappelons les noms : Janson, Dansaert, Demeur et Guillery, d’abord : rejoints plus tard, au fur et à mesure des succès électoraux, par Feron, Scailquin, Robert et Arnould) lesquels tentèrent, avant 1884, d’entraîner le parti libéral dans les voies démocratiques.
S’ils eussent été suivis, nous n’aurions pas eu à subir plus d’un quart de siècle de domination cléricale ininterrompue ; mais ils se heurtèrent à l’obstination de Frère-Orban.
Enfin, pour couronnement de sa carrière politique, il fut de la Constituante.
Nous avons signalé, en commençant, sa collaboration au « Libre Examen ». Eugène Robert fut de la Libre-Pensée dès le début, ce qui ‘harmonisait avec ses convictions socialistes ; car en ces temps-là, on ne concevait pas un socialisme qui ne fût libre-penseur. – Nous entendons les socialistes conscients.
Et ses débuts dans la carrière d’avocats furent signalés par le retentissant procès De Buck, qu’il plaida avec Paul Janson, et qui aboutit d’abord à l’acquittement de De Buck, que le jésuites voulaient faire condamner après l’avoir dépouillé, ensuite à la restitution de la succession captée par les révérends pères.
Démocrate et libre-penseur, Eugène Robert l’est resté jusqu’au bout. C’est le plus bel hommage qu’on puisse rendre à sa mémoire. Puissent tous les jeunes qui marchèrent sur ses traces persévérer et finir comme lui.
* * *
Après nous acquitté de l’hommage que nous devions au vieux compagnon de lutte, nous ne pouvons nous empêcher de témoigner notre regret au sujet de l'article qui est consacré par le « Peuple » du 23 mars, reproduit par le « Journal de Charleroi » du 24.
D'abord il n'y est pas dit un mot des services rendus par Robert à la cause socialiste ; pas un mot de sa collaboration à la « Liberté socialiste », que l'on continue à ignorer dans le Parti ouvrier, ainsi que l’ancienne internationale tout entière, d'ailleurs. Et qu'est-ce que c'est que cette perpétuelle remémoration du fameux « Manifeste des ouvriers » de 1868, auquel on revient toujours, et qu'on paraît prendre pour le point de départ du mouvement socialiste. Qu'une fois pour toutes les dirigeants et écrivains du parti socialiste actuel veuillent bien retenir que le mouvement socialiste est sorti de la société « Le Peuple », dont furent Brismée, De Paepe, Steens, Verrycken, tant d' autres aujourd'hui couchés dans la tombe ; puis parmi les vivants Brasseur, Denis, Degreef, pour ne parler que de ceux dont les noms viennent sous ma plume ; qu’en 1864, la section belge de l’Internationale prit naissance au sein de la société « Le Peuple » et qu’en 1868 – date du « fameux manifeste » - elle comptait des dizaines de milliers d’adhérents, qui certes ne se réclamaient pas dudit manifeste.
Qu’ils apprennent aussi que la « Génération ouvrière » qu’on exalte et dont on cite les chefs dans l’histoire rédigée sous les auspices du « Parti ouvrier », c’était le Parti ouvrier libéral d’alors, tandis que les socialistes étaient dirigés par un Conseil général dont on n’a pas songé à citer les noms.
Ce n’est pas en notre nom, c’est au nom de tous les grands oubliés que nous protestons !
Eugène HINS
(Extrait des Hommes du jour, 1883, n°18)
Eugène Robert est certes une des personnalités les plus sympathiques du barreau et de la politique. Sa serviabilité, son grand savoir, lui ont créé de nombreuses amitiés.
Depuis trente ans, Eugène Robert est sur la brèche pour défendre les idées démocratiques et il a donné sans compter tout son talent pour les faire triompher.
Avec Janson, Feron, Splingard, Arnould, Denis, De Greef, Eugène Robert a pris part à tous les grands mouvements pour la revision de la Constitution, et, si la Constituante a élargi les bases du droit de suffrage, on le doit en grande partie à la propagande incessante de ces hommes qui ne désespérèrent jamais du résultat final.
Le père d'Eugène Robert était Français et il prit part aux combats de 1830. Au moment de la révolution belge, M. Robert père était employé au ministère de l'intérieur, et, en 1834, il entra à l'administration des chemins de fer. Peu de temps après, il épousait une jeune Néerlandaise qui fut la mère d'Eugène Robert.
Eugène Robert est né à Gand en 1840 ; il commença ses études humanitaires au collège Saint-Michel, à Bruxelles, et au petit séminaire de Malines et les termina à l'Athénée de Bruxelles.
Au sortir de cet établissement, Eugène Robert entra à l'Université libre où il fit la connaissance de toute cette jeunesse qui a joué un grand rôle politique dans ces dernières années.
Après de brillants examens, il entra au barreau, très peu de temps avant le décès de son père, qui eut lieu en 1862. Mme Robert était morte en 1857.
Les parents d'Eugène Robert ne laissaient absolument aucune fortune, et le jeune avocat eut des débuts assez pénibles. Il fit son stage chez Me Albert Picard, dont il devint l'élève préféré.
L'affaire Delimal, journaliste accusé de rébellion parce qu'il s'était opposé a une perquisition tendant à découvrir l'auteur d'un article contre l'empereur Napoléon III, mit Eugène Roberte n évidence, et sa parole incisive, ses traits mordants firent merveille en ce procès, où il obtint l'acquittement de son client.
Ce qui mit définitivement Eugène Robert au premier plan, fut le procès De Buck, qu'il plaida avec Paul Janson devant la Cour d'assisses.
Ce procès, presque oublié aujourd'hui, est des plus curieux. Un vieil Anversois, nommé de Boye, plusieurs fois millionnaire, avait légué toute sa fortune à un sieur Valentyns, avocat, homme de paille des jésuites. La plupart des héritiers ne soufflèrent mot, sauf Benoît De Buck,un neveu du mort, qui ne voulut pas se laisser dévaliser sans crier. On essaya d'abord de le calmer en lui versant des petites sommes dont le total ne dépassa point mille francs ; mais comme il insistait, réclamant sa part s'élevant à près de 800,000 francs, les jésuites organisèrent une série de conspirations grâce auxquelles la victime s'entendit condamner à dix ans de prison pour vagabondage. Non content de cette scandaleuse condamnation, et voulant se débarrasser complètement du gêneur, le révérend père Lhoir accusa De Buck de l'avoir menacé de mort et donné à sa menace un commencement d'exécution.
De Buck fut traduit en Cour d'assises. Il comparut devant le jury du Brabant assisté de MM. Janson et Eugène Robert, avocats d'office, et fut acquitté après d'admirables plaidoiries. Les défenseurs allèrent plus loin, ils actionnèrent devant le tribunal civil d'Anvers le sieur Valentyns, et, après quatre ans de lutte, obtinrent 800.000 francs pour leur client.
A partir de ce moment, Eugène Robert fut de tous les procès politiques, qu'il plaida d'ailleurs avec un désintéressement absolu. Citons les procès Vésinier, Bachellery, (offenses envers des souverains étrangers), où Robert flagella le régime napoléonien.
Les procès Delimal avec Arnould ; Otterbein (affaire de la Cigale), avec P. Splingard, et le fameux procès devant la Cour d'assisses de Mons (affaire de la fusillade de l'Epine), où Robert défendait Delposen, le principal accusé, tous ces procès se résolurent en acquittements.
En 1863, Eugène Robert fait son entrée dans la politique, et participe activement aux luttes et aux travaux du meeting libéral et deux ans après, il fonde avec Janson, Picard, Graux et Olin, la « Liberté » dont il est nommé rédacteur en chef. On connaît le succès qu'a obtenu ce journal et quelle a été son influence.
En 1865, l'Association Générale des Etudiants de Liége provoque la réunion d'un Congrès international des étudiants et porte à l'ordre du jour la question de l'enseignement. Ce Congrès eut une importance capitale ; de tous les pays accoururent en foule des jeunes gens animés d'idées libérales, qui prononcèrent d'éloquents discours en faveur de la démocratie et de la libre-pensée. Eugène Robert prit une part active aux travaux du Congrès et son discours sur l'enseignement obligatoire fut un des mieux pensés.
Au moment où cette importante question vient de donner lieu à la Chambre à un débat des plus passionnés, il est utile de reproduire les idées préconisées par Eugène Robert, il y a trente ans : « Je veux, disait-il, que l'on prenne des mesures pour que l'intérêt matériel des familles ne souffre pas de l'obligation d'envoyer l'enfant à l'école, recevoir le bienfait de l'instruction. Il ne faut pas que le père et la mère meurent de faim pendant que l'enfant s'instruit. Voilà mes conclusions : Au nom de l'égalité, au nom du droit, au nom du progrès, au nom de l'enseignement universel qui appartient à tous en vertu du droit universel, il faut que l'instruction obligatoire apparaisse dans nos lois avec les corollaires que j'ai indiqués. Je ferai donc au Congrès la proposition d'inscrire parmi les résolutions qui seront formulées, d'envoyer aux Chambres la demande de rendre le plus tôt possible l'instruction gratuite et obligatoire. «
Après trente ans, nous sommes encore bien loin du but indiqué par Eugène Robert.
L'année suivante, en 1866, se produisit un dissentiment entre les rédacteurs de la « Liberté », incident déjà connu de nos lecteurs. Robert, Janson et Splingard se retirèrent et quelques mois après, fondèrent le « Libre examen », avec Emile Feron, et Robert comme rédacteur en chef.
En 1869, Eugène Robert et Paul Janson posent leur candidature au Conseil communal de Bruxelles. A cet effet, ils lancent un manifeste républicain socialiste et échouent avec 1,100 voix.
Pendant cette période, Robert donne meetings sur meetings, conférences sur conférences, soutenant et défendant toutes les idées socialistes et révolutionnaires et se faisant recevoir membre de l'Association internationale des Travailleurs.
Au meeting de Liége en 1868, meeting qui eut un grand retentissement, Eugène Robert, s'adressant aux ouvriers disait : « … Et d'ailleurs, de quoi pourriez-vous être mécontents ? N'avez-vous pas des caisses d'épargne, des buanderies, des maisons ouvrières, des caisses de secours ? Si vous êtes assez ingrats pour méconnaître ces bienfaits, prenez y garde, vous savez qu'on a pour vous châtier de bons fusils arrangés à neuf, qui reproduiront sans merci les mitraillades de l'Epine !
« Ah! vous le comprenez comme moi. Ce n'est pas à une pareille société qu'il faut des émollients, les cataplasmes, les emplâtres de la pharmacie. Quand la gangrène a gagné le membre, ce n'est pas l'apothicaire qu'on doit appeler, c'est le chirurgien qu'il faut !... »
Depuis lors, Eugène Robert a mis pas mal d'eau dans son vin rouge et plus tard, en 1883, lors de la discussion sur la révision, un éhonté transfuge de la démocratie, M. Ch. Graux, alors ministre des finances, a pu lui lancer l'apostrophe suivante : « Le jour où l'honorable M. Robert a accepté de l'Association libérale de Bruxelles une candidature de représentant, il a fait, sur le chemin de Damas, le plus long des trajets que jamais mortel ait accompli ! (…) L'honorable M. Robert, en venant s'asseoir sur ces bancs, a changé complètement d'idées. Il n'est plus le républicain-socialiste d'autrefois ; il est devenu partisan de la monarchie constitutionnelle ! Il ne rêve plus la régénération sociale par l'organisation du prolétariat, il est devenu le défenseur de nos institutions politiques et économiques. »
Le reproche était dur, mais avait peu de valeur venant d'une girouette politique comme M. Graux.
Bien des fois depuis, M. Robert a dû regretter les compromis auxquels il devait se soumettre pour conserver - quelle illusion ! - l'alliance doctrinaire progressiste.
Pendant quelques années, Eugène Robert continue sa propagande démocratique, un peu attiédie par son entrée à l'Association libérale, où il avait suivi son chef et ami Paul Janson, qui s'était incliné devant dame Doctrine pour forcer les portes du Parlement.
En 1877, une candidature pour la Chambre est offerte à Eugène Robert ; ses compétiteurs sont Washer et Scailquin ; il se retire en faveur de ce dernier.
En 1879, il refuse une candidature en compétition avec Emile Feron, mais accepte la lutte avec M. Vanderkindere, qui triomphe au poll de l'Association libérale avec une centaine de voix de majorité.
En 1882, M. Jamar, représentant de Bruxelles, nommé directeur de la Banque nationale, donne sa démission et Eugène Robert et Pierre Splingard briguèrent sa succession. Les deux candidats se présentent avec un programme identique. Cette lutte, absolument loyale et courtoise, n'altéra en rien les rapports de vieille amitié entre les deux concurrents.
Cette fois, Robert triompha et le corps électoral ratifia le verdict de l'Association libérale.
Son programme progressiste et démocratique comprenait la revision de l'article 47 de la Constitution.
A la Chambre, Eugène Robert a tenu ses promesses, il a prononcé des discours bien pensés et bien dits en faveur de la liberté de la presse et, pendant la discussion de la revision en 1883, il fit un discours mordant et incisif qui obtint dans le pays un très vif succès. Mettant M. Graux sur la sellette, il lui reprocha ses palinodies et signala au public une déclaration de MM. Buls, Graux, Ed. Picard et Vanderkindere réclamant la revision immédiate de la Constitution.
Les suites de ces discussions à la Chambre, où la moitié des députés progressistes de Bruxelles combattit ardemment l'autre moitié doctrinaire, furent mémorables.
Après une campagne électorale violente, le poll de l'Association libérale proclama candidats tous les députés sortants. La vieille Association ne voulut pas trancher la question qui lui était soumise, se prononcer entre les deux politiques en présence.
Sur seize candidats sortants, Eugène Robert seul n'obtint pas la majorité et un ballottage entre lui et M. De Mot, le dernier des doctrinaires, était nécessaire. M. De Mot, qui pouvait passer dans le tas n'eut pas le courage, et avec raison, de risquer le second tour de scrutin ; il se retira de la lutte.
On connaît le résultat définitif de cette élection, à laquelle nous devons le ministère clérical. Le 10 juin 1884, les électeurs bruxellois, pour la première fois depuis 1830, élisaient seize députés clérico-indépendants.
Après quelques années de domination cléricale, l'arrondissement de Bruxelles revint à de meilleurs sentiments et lors de l'élection pour la Constituante il élut une liste panachée de libéraux et de progressistes, parmi lesquels Eugène Robert. Comme précédemment, ce dernier prit une part très active aux discussions concernant les conditions de l'électorat, et, de guerre lasse, après avoir épuisé tous les moyens, se rallia au vote plural.
Nous avons raconté longuement, à propos de la biographie de Léon Furnémont, la séparation qui se produisit en septembre 1894, entre les dirigeants de l'Association libérale et les jeunes, à propos de l'alliance à faire, soit entre les libéraux doctrinaires et progressistes, soit entre progressistes et socialistes. La majorité de l'Association préféra l'alliance avec la « Ligue », en offrant quelques sièges aux socialistes - que ceux-ci refusèrent dédaigneusement - et un nouveau désastre fut le résultat de cette décision malheureuse. Eugène Robert, qui présidait cette réunion ou fut décrétée la défaite, prononça un discours qui rallia la majorité en faveur de la triple alliance, mais dont le vote devait livrer pour de longues années le pays aux cléricaux.
Le 14 octobre, le corps électoral bruxellois accordait 60,000 voix aux libéraux unis, 40,000 voix aux socialistes et 92,000 voix aux cléricaux. Au scrutin de ballottage du 21 octobre, les libéraux étaient définitivement battus par plus de 10,000 voix de majorité. Eugène Robert obtenait 95,107 voix.
Eugène Robert est un des orateurs les plus aimés et les plus applaudis. Au palais, dans les affaires civiles où son esprit peut s'épandre à son aise, il charme et éblouit, il raille sans jamais blesser, il égratigne simplement ; son attaque est prompte et rapide, il est d'une admirable dextérité dans la riposte : c'est un séducteur. Un de ses biographes a tracé de lui un portrait très juste : « Eugène Robert lit avec art ; il récite avec charme et séduction ; c'est un lettré délicat, un épicurien frotté de démocratie ; c'est un parleur exquis, mais un peu vide, délicieux comme une fraise, savoureux comme une pêche ; mais ne lui demandez pas la force et les vertus substantielles du vin et des viandes qui réparent les forces épuisées. Bref, c'est un dilettante, un précieux et non un politique, c'est un orateur charmant qu'on écoute avec plaisir, mais il ne jette pas dans le cœur de ses auditeurs frémissants, des brandons de haine ou d'enthousiasme, qui les font courir au feu ou aux barricades. »
Malgré ces légères critiques, Eugène Robert est resté l'homme des enthousiasmes de ses jeunes années, et si parfois, entraîné par de vieilles amitiés, il a pu commettre des fautes politiques, il reste chez lui un grand fond d'amour pour les idées généreuses et démocratiques pour lesquelles il a lutté pendant de longues années, et qu'il défendra encore, nous en sommes certain, car un homme de sa valeur et de son talent a sa place marquée au Parlement.
(Extrait du Journal des tribunaux, du 20 juin 1909)
Maître Eugène Robert, qu'unanimement tous les « chers maîtres » vont ovationner le 19 juin, est inscrit au tableau de notre Ordre depuis le 4 novembre 1863, étant docteur en droit depuis le 10 août 1860. c'est-à-dire que depuis un demi-siècle, à quelques mois près, il porte notre robe avec une distinction, une élégance, un esprit et une probité que des « voix plus autorisées » surchargeront d'épithètes aussi éclatantes que méritées.
Quand il va et vient, dans les couloirs du Palais, de son petit pas majestueux, on le salue avec une déférente gaité, car il est de ceux dont le regard, partant d'une paire de petits yeux malins, provoquent la bonne humeur. Il vous tend sa main courte aux doigts fins et potelés et vous dit d'une voix caressante des phrases où se mêlent l'onctuosité d'un abbé de Cour et le scepticisme aimable d'un philosophe du XVIIIème siècle.
De taille plutôt petite, l'embonpoint léger et plein de finesse, les cheveux blancs dont les boucles ont des reflets de vieil or, la figure chaude, éclairée, la joue toujours rasée de frais, la moustache blanche coquettement retroussée, Maître Eugène Robert est un plaideur qu'on écoute toujours avec plaisir. Il a sa manière : il cause, et ses gestes harmonieusement s'arrondissent comme ses périodes. Dans sa bouche
les arguments prennent une façon élégante qui n'est pas exclusive de fermeté. Et tout cela est spirituel en diable, plein de malice et - ce qui est plus joli - jamais méchant.
On peut dire que le premier il a parlé à la barre une langue châtiée en un temps où on se souciait de cela comme de sa première grammaire. Le premier il a soigné la forme du débit et songé à faire œuvre d’artiste tout en restant avocat. Après lui, d'autres sont venus qui l'ont imité ou plutôt qui ont fait comme lui, mais alors... Il est vrai que, depuis, les magistrats voudraient, comme Napoléon, couper la langue aux avocats à raison de l'arriéré des affaires... Oh ! rien qu'à raison de cela !
Très en vue comme homme politique, mêlé aux procès retentissants, Maître Robert est toujours demeuré le bon et l'aimable confrère, ne connaissant ni la morgue, ni la froideur compassée qui rapetissent leur homme et dont on se gausse au fond. Or, cinquante ans de cette indéfectible urbanité dans la confrérie, c'est quelque chose, que dis je.' c'est énorme... par le temps qui court !
Non ! ce n'est pas en argent qu'on devait couler la statuette qu'on va offrir au jubilaire, c'est en or !
Me A. V. D. K. (Thémis, n°2, juin 1909.)
Voir aussi : Jean PUISSANT, Euège ROBERT, sur le site du Maîtron (consulté le 28 octobre 2025)
Par ailleurs, Eugène Robert est repris (n°4) dans la célèbre caricature de l’Hydre du socialisme (juin 1879) (consulté le 28 octobre 2025)