Prévinaire Eugène (1805-1877)
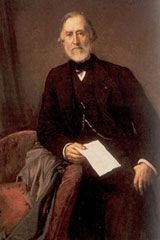
Prévinaire Eugène, Marie, Ignace libéral
né en 1805 à Louvain décédé en 1877 à Bruxelles
Représentant 1848-1864 , élu par l'arrondissement de BruxellesBiographie
KAUCH P. Eugène Prévinaire (1805-1877). Deuxième gouverneur de la Banque nationale de Belgique
(Tiré à part d’un article paru dans la Revue du personnel de la Banque nationale de Belgique, Bruxelles, avril 1954, n°4)
(page 3) Prévinaire au milieu de sa vie
« J'ai l'intention de voir M. Prévinaire, afin de le prier de vouloir bien me donner son avis sur vos actions... M. Prévinaire est un de nos représentants les plus distingués, un de nos financiers les plus habiles ; c'est un homme de bon ton et qui possède une grande facilité d'élocution ; il résout une question très promptement ; homme d'exécution, il faut le prendre au moment même qu'une idée lui surgit de son génie, vous êtes surpris que cette haute nature passe outre et vous oublie : c'est un effet du travail de son esprit... Il n'est financier que sur le papier, car il répand le bonheur autour de lui. Si je puis causer un instant avec lui, je saurai te dire le résultat de notre entretien. »
Voilà comment la baronne Willmar qui, dans sa correspondance, a croqué sur le vif la société bruxelloise au milieu du siècle passé, portraiturait en 1862 Eugène-Marie-Ignace Prévinaire. industriel, député, directeur de la Banque Nationale. Tel le montrent aussi ses portraits. les comptes rendus de ses interventions à la Chambre et aux conseils de l'institut d'émission.
Arrivé presque au faîte de sa carrière au moment où Mme Willmar désirait ses conseils, élevé dans un milieu de fonctionnaires et d'intellectuels huppés, gendre d'un gros industriel, industriel lui-même, député libéral mais croyant convaincu, banquier allié des banquiers, répandu en Hollande, en France, en Angleterre, Prévinaire était un parfait homme du monde, membre de cercles très fermés et de plusieurs sociétés scientifiques et philanthropiques. Portant beau, grand, mince, racé, d'autant plus attiré par l'aristocratie que les traditions familiales le rattachaient à la vieille noblesse hesbignonne continuant à vivre noblement, Cet homme de la capitale faisait un vif contraste avec le premier gouverneur de la Banque, François-Philippe (page 4) de Haussy. petit, replet, bourgeoisant, baron authentique mais industriel de province, fréquentant les conseils d'administration, les usines plutôt que les salons et préférant sa retraite champêtre de Laeken aux charmes du Vaux-hall. aux fauteuils de la Monnaie.
Son langage était aussi châtié que ses manières étaient distinguées. Même à cette époque, cela se remarquait à la Chambre, où un scrutin de plus en plus démocratique favorisait déjà le verbe haut et le mot vert. Ce qui, pour un de ses collègues, était « la misère du peuple » était pour lui « l'état fâcheux dans lequel se trouve une partie de la classe ouvrière. » D'un député qui avait commis une bévue en parlant de la Banque Nationale, il relève « une erreur bien étrange de la part d'un homme qui, depuis huit ans, scrute scrupuleusement et consciencieusement, j'aime le croire, tous les chiffres de notre établissement » Ve que Coomans, parlant du produit de la ferme des boues, appelle « un impôt sur les matières fécales », il le définit une redevance « sur les engrais formés à Bruxelles et mis sans entrave à la disposition des agriculteurs. »
Il est distant sans être hautain, imbu de son rang sans être prétentieux, fort de ses droits mais respectueux de ceux d'autrui. Avec Frère-Orban et Malou. il traite d'égal à égal ; il tient à distance Louis Hymans, député, père du futur leader libéral, mais publiciste et militant d'association. Au parlement il prie un importun plein de faconde « de ne pas l'interrompre: M. Delahaye est coutumier du fait, bien qu'il soit lui-même très sensible aux interruptions » ; mais il demande à la Chambre « la permission de lui dire quelques mots sur l'article en discussion, sans avoir l’intention d'occuper longtemps son attention, parce que cela ne rentre pas dans ses convenances ce moment. »
Libéral mais plutôt progressiste, à rencontre d'Eudore Pirmez, son collègue rue de la Loi et rue du Bois Sauvage, brillant juriste mais doctrinaire et imperméable à l'évolution sociale ; à rencontre aussi d'Eugène Anspach, frère du bourgmestre de Bruxelles, un de ses futurs successeurs la Banque Nationale, philosophe, fondateur d'une nouvelle Eglise protestante, et qui vit à l'écart dans sa thébaïde familiale. Il se rapproche, sur le plan politique, beaucoup plus de Bischoffsheim, grand financier. et De Pouhon, commerçant avisé. Défenseur de la liberté économique mais réclamant les interventions de l'Etat là où celle « des particuliers fait défaut, lorsque l'initiative des pouvoirs publics est utile. » Courageux dans la défense de des opinions jusqu'à l'opiniâtreté mais circonspect en affaires quand sa connaissance n'en est pas suffisamment ferme. Préoccupé du sort de la classe ouvrière au point de s'opposer à l'interdiction du droit de coalition, mais prudent et fidèle à Malthus dans sa crainte de la concentration des masses dans les centres urbains.
Avec cela averti des affaires administratives, des choses de l'industrie, du commerce, des transports et du crédit. Tel était, quelques années avant de devenir gouverneur de la Banque, cet homme dont la carrière brillante se poursuivit jusqu'au moment où, devenu vieux, des circonstances auxquelles il était étranger le plongèrent dans une tristesse profonde.
Un blason évocateur
« De gueules au chevron d'or chargé de trois merlettes de sable et accolées de trois forces d'argent. »
Ainsi parle le blason séculaire de sa famille, combien représentatif de ses propres destinées ! Les merlettes de sable figurent les oiseaux noirs de la Révolution de 1830 qui le jetteront dans la mêlée. Les « forces » d'argent, ciseaux des tondeurs de moutons en usage dans tant d'armoiries hesbignonnes et liégeoises, figurent les usines textiles où il amassera une fortune considérable, Le chevron d'or enfin, le couronnement, figure ses fonctions de gouverneur de la banque centrale, défenseur de la monnaie.
Il naquit, le 16 octobre 1805, dans un milieu de bourgeois d'Ancien Régime, ressassant leurs souvenirs ancestraux dans le calme des soirées d'hiver, apparentés à la petite noblesse provinciale, occupant des fonctions honorées dans les carrières universitaires, libérales ou administratives, gardant leur rang grâce des fortunes terriennes accumulées le long des ans, écornées et reconstituées au hasard des héritages, parfois arrondies par des alliances avec des gens de la finance et de l'industrie.
Son arrière-grand-père, Ignace, Joseph Prévinaire, était un des médecins les plus réputés de Louvain, « expertissimus dominus » disent les (page 5) archives. Il fut longtemps médecin consultant de Charles de Lorraine et de la famille d'Arenberg.
Son grand-père, Pierre-Joseph, médecin également, s'établit à Bruxelles, d'abord dans une maison dite Bij de Kraen sur le Canal, ensuite dans un hôtel sis rue des Augustins, face à l'église du même nom qui se dressait à l'emplacement de l'actuelle place de Brouckere. Il se fit remarquer en publiant des mémoires sur les abus de l'empirisme et sur « les moyens que la médecine et la police pourraient employer pour prévenir les erreurs dangereuses des enterrements précipités. » S'étant lancé dans la politique et chargé de missions par le gouvernement, il émigra pendant la Révolution et devint médecin des princes français exilés Londres où il mourut en 1798.
Son père, Eugène-Joseph, né en 1781, fit ses études de droit à Louvain et choisit des fonctions administratives fort bousculées par les régimes politiques successifs que connurent nos provinces. Après avoir été secrétaire de la municipalité d'Herent, ensuite de la sous-préfecture du même nom et du conseil d'administration des Hospices et Secours, il devint sous-préfet à la fin du régime napoléonien. Il poursuivit sa carrière, sous le régime hollandais à La Haye et, après 1830, à Bruxelles, où il avait une réputation d'homme du monde distingué, membre de la Société de l’Union et du Concert noble.
Le futur gouverneur de la Banque, après avoir fait ses études au lycée de Bruxelles puis à l'université de Louvain, suivit les traces de son père et entra comme surnuméraire au ministère de l'Intérieur en 1826, à l'âge de vingt et un ans.
A cette époque n'était pas surnuméraire qui voulait. Il y fallait de la fortune plus encore que de connaissances, et de solides protections. Prévinaire avait les trois, de par père, sa famille, ses amis. Aussi son avancement dans l'administration du roi Guillaume Ier promettait-il d'être rapide quand 1830 le mit devant un terrible cas de conscience.
Un fonctionnaire d'autrefois dans la tempête
En sa qualité de fonctionnaire il était destiné, au début des troubles, à rester acteur plutôt que spectateur et à être fidèle au parti de l'ordre tout comme son père ; d'autant plus que, libéral et conservateur par tradition, ses opinions politiques le disposaient à l'orangisme anticlérical. De plus son oncle Théodore Prévinaire, dont il épousera plus tard la fille aînée, avait des intérêts si importants en Hollande qu'il devait, comme tant d'autres industriels belges, être orangiste au début d'une révolte qui ne signifiait aucunement la scission. Au vrai cet homme, auquel son neveu devait beaucoup, fut parmi ceux qui conseillèrent au prince Frédéric l'attaque de Bruxelles, croyant que cela suffirait à amener à raison les émeutiers.
Mais ses convictions religieuses attirèrent Eugène Prévinaire vers le Sud, en dépit des destructions infligées aux propriétés de son futur beau-père par les insurgés. Lorsqu'après les journées de septembre, le roi Guillaume, par un arrêté du 8 novembre 1830, mit en disponibilité avec traitement d'attente tous les fonctionnaires appartenant aux bureaux s'occupant des provinces méridionales, (page 6) le père et le fils Prévinaire rejoignirent Bruxelles, ce qui finit par équivaloir à une démission en vertu d'une décision administrative ultérieure.
Le futur gouverneur de la Banque se laissa entraîner par le tourbillon révolutionnaire et s'engagea dans la célèbre compagnie des chasseurs-Chasteler composée surtout de nobles et de bourgeois. Elle devait s'illustrer par son succès à la bataille de Waelhem. Lorsque le marquis de Chasteler rejoignit l'armée régulière avec le titre de général de brigade chargé de l'organisation de la cavalerie, un grand nombre de chasseurs, qui ne se sentaient pas de vocation pour la carrière des armes, sollicitèrent et obtinrent la faveur d'être affectés un corps spécial, celui des de la garde civique de Bruxelles, dits Chasteler. Prévinaire était du nombre avec Eugène Dansaert, futur député, François van Campenhout, l'auteur de la Brabançonne, Galesloot, l'historien, Edouard Ducpétiaux, Célestin Gendebien, frère d'Alexandre Gendebien, membre du Congrès.
L'ordre rétabli, la plupart d'entre eux démissionnèrent. Prévinaire entra au gouvernement provincial du Brabant au printemps 1832, en qualité de chef de division et de secrétaire de la commission provinciale d'agriculture. L'Almanach de poche de Bruxelles pour l'année bissextile 1836 décrit comme suit ses attributions : « Organisation militaire ; casernement des troupes ; chauffage et éclairage des troupes ; hôpitaux militaires ; police militaire ; mouvement des troupes ; nourriture des troupes ; matériel de l'armée ; places de guerre ; milice nationale ; armée de réserve ; garde civique ; gendarmerie ; gardes champêtres ; chasse ; police générale ; passeports ; police sanitaire ; police municipale ; prisons de passage. » Sans doute son expérience militaire lui avait-elle valu cette désignation à un moment où l'administration se constituait sur de nouvelles bases et où les compétences étaient rares.
Au bout de peu d'années Prévinaire changea fusil d'épaule. Vers la fin de 1837, il troqua le célibat contre le mariage et la vie administrative contre celle des affaires. L'horizon relativement borné dans lequel il s'était enfermé jusqu'alors s'élargit brusquement sur de vastes perspectives.
Prévinaire aide à l'expansion de l'industrie textile belge
Son mariage avec sa cousine le décide à entrer dans l'industrie textile après avoir voyagé longtemps à l'étranger, étudié sur place les débouchés et s'être fait la main dans les entreprises hollandaises de son beau-père, un des hommes les plus progressifs d'une époque qui en connut beaucoup.
Dans sa jeunesse déjà, celui-ci avait mis à profit l'union entre Ie Nord et le Sud pour étendre largement ses affaires.
Né en 1783 à Opprebais, il avait fait sa philosophie à Louvain sous la surveillance d'un autre Prévinaire, chirurgien, et consacré une partie de temps à l'étude de la physique et de la chimie, avec tant de bonheur qu'il parvint à la pointe du progrès dans l'industrie textile (page 7) et chimique. Lié au pharmacien de Hemptinne, dont il épousa la fille et dont la famille avait des tissages et des filatures à Gand, aidé par Walckiers, probablement un descendant du célèbre banquier qui avait contribué à financer la révolution brabançonne et qui avait joué un rôle non négligeable dans la révolution française, il débuta en fondant à Molenbeek une fabrique de produits chimiques. Ce fut une heureuse et prospère. En 1816, avec Walckiers, il introduisit la fabrication du noir animal en Belgique. Trois ans après il installa dans l'ancienne ferme de Ransfort, à Molenbeek également, une fabrique de sel ammoniaque. Avec Hemptinne il établit, en 1823, près de la Petite Allée-Verte, une fabrique d'acides nitreux et sulfuriques.
Ce n'était là, pour cet esprit inventif, qu'un complément ses succès dans l'industrie textile. Il s'était associé avec Sény pour créer, toujours à des ateliers qui, d'après A. Wauters, prirent un développement extraordinaire. Dès 1820 leur maison avait obtenu à l'Exposition de l'Industrie nationale, la médaille de bronze. Quelques années après elle décrocha la médaille d'or pour « la variété des étoffes, la bonne qualité des différents tissus, l'heureux mélange des matières premières et des couleurs, surtout pour ses cotons batistes, cotonnettes, javans doubles, taffechelas et étoffes en soie et en coton mêlés, ainsi que faux de Saxe. » Prévinaire-Sény contribuèrent largement au renouveau de l'industrie du coton belge après 1823.
Leur production de tissus à bon marché était destinée non seulement au marché intérieur, mais surtout aux Indes Néerlandaises, ouvertes à nos provinces depuis la création du Royaume des Pays-Bas. C'est dans cc secteur que Théodore Prévinaire donna toute sa mesure, grâce à des procédés d'impression indiennes et de teinture au rouge d'Andrinople qu'il mit au point lui-même et qui lui permirent de concurrencer les meilleurs produits nationaux et étrangers. Il créa une autre fabrique à Cureghem. qui prospéra grâce aux exportations faites par le canal de la Nederlandsche Handelmaatschappij détentrice du monopole des ventes à Java.
La révolution de 1830 compromit gravement cette situation florissante. D'où la couleur politique de Th. Prévinaire. Pour les orangistes en effet, l'intérêt matériel était le point de départ de toute combinaison gouvernementale.
Lorsque le drame d'Anvers eût porté un coup fatal à l'orangisme, qui dès lors devint de la trahison, Théodore Prévinaire céda ses participations en Belgique à son associé Sény et transféra ses pénates en Hollande. Les importations belges étaient interdites à Java, mais la Hollande ne disposait pas d'une industrie cotonnière nationale ; aussi Prévinaire s'entendit-il avec la Nederlansche Handelmaatschappij pour doter le Nord de fabriques capables d'approvisionner les territoires d'outre-mer, précédé ou suivi par l'Anglais Ainsworth et ses compatriotes Poelman et De Heyder. Il créa à Haarlem une des trois grandes fabriques de l'époque - la seule qui dura - et d'autres usines dans le Brabant septentrional et dans la région d'Overijssel où, en 1838, il occupait deux mille ouvriers.
Après ravoir aidé dans ces diverses entreprises (page 8) lorsqu'il eût quitté l'administration, Eugène Prévinaire borna de plus en plus son activité aux intérêts belges de sa belle-famille auxquels il avait associé les siens. Il fonda, en 1839, avec son beau-père, une filature de coton à Huysinghen près de Hal, dans un vieux manoir acquis cet effet. En 1841 il se fixa définitivement en Belgique.
Depuis ce moment jusqu'à celui où il entra dans la politique, les documents ne livrent plus sa trace sauf pour dire qu'il consacra une partie de ses loisirs à des œuvres de bienfaisance. Il était membre du comité de charité de la paroisse du Finistère et visiteur des pauvres. Il créa et subsidia une école dans la même paroisse. Les études aussi prenaient une partie de ses loisirs. Il fut un membre actif de la Société d'économie politique. Il fut membre fondateur puis trésorier de la Société internationale pour le progrès des sciences sociales, aux séances de laquelle il fréquentait des artistes et des savants réputés : Henri Conscience, qui était professeur de flamand des enfants de Léopold Ier, le Hardy de Beaulieu, Laveleye, Wolowski, trois bons économistes de l'époque, Emile de Girardin et tant d'autres.
Un homme aussi fortuné et aussi répandu ne pouvait manquer d'être distingué par certains de ses amis du monde politique. En 1848, à un moment où la révolution en France et l'agitation en Europe amenaient les électeurs à donner leurs suffrages aux hommes compétents et énergiques, l'Association libérale de Bruxelles lui offrit une candidature à la Chambre des Représentants. Jusqu'alors il était resté étranger à la politique active. Mais l'Association avait besoin de lui : le libéralisme progressait et manquait d'industriels de sa trempe ; les grandes dames avaient fini de faire des neuvaines que le fléau du libéralisme épargnât le pays ; les hommes nouveaux, Frère- Orban en tête, étaient à la mode ; la crise puis la révolution de faisaient redouter « l'anarchie la plus effroyable. » Prévinaire avait démontré en 1830 qu'il était courageux. Il accepta et fut élu par près de 6.000 suffrages, ce qu'il pouvait considérer à juste titre comme une marque de confiance.
Prévinaire, député modéré
Prévinaire se sentait préparé pour cette tâche, au courant comme il l'était de la vie parlementaire, non seulement par nombre de ses amis parmi lesquels Jonathan-Raphaël Bischoffsheim, Eudore Pirmez, Alexandre Jamar. Eugène Anspach, François De Pouhon deviendront ses collègues à la Banque Nationale, mais encore par son beau-frère, le sénateur Fortamps, industriel, financier et bientôt gouverneur de la Banque de Belgique, cette « machine de guerre « construite pour tenir en échec la Société Générale.
De plus, il s'attachait volontiers aux causes qu'il trouvait justes au point de vue économique, financier et social. A cette époque fort difficile, il se sentait de taille à défendre les intérêts compromis de l'industrie et du commerce et à trouver un terrain d'entente avec le monde ouvrier dont il se vanta à la Chambre, de connaître tant les besoins que la mentalité, non sans raison d'ailleurs, mais bien entendu dans la mesure où un grand bourgeois d'alors pouvait comprendre les aspirations profondes de la classe ouvrière.
Sa carrière parlementaire ne fut guère bruyante, mais son rôle fut utile à raison de ses connaissances, de son expérience, de sa volonté, de sa modération. Aussi garda-t-il son mandat, en dépit des manœuvres qui tendirent à l'exclure (page 9) de l'Association libérale de Bruxelles en 1859, jusqu'au moment où, devenu vice-gouverneur la Banque, ses fonctions, devenues trop absorbantes, lui dictèrent de ne plus en redemander le renouvellement.
« Les grands principes sociaux, écrit E. Bochart, en 1858, liberté, indépendance, économie des deniers de l'Etat, équitable répartition des charges et des impôts, amélioration de la condition de la classe ouvrière : telle est la politique de progrès que M. Prévinaire n'a cessé d'appuyer. et qu'il a contribué à faire prévaloir dans toute sa carrière parlementaire. » Cette appréciation, de caractère un peu officiel, correspond cependant bien ce que les Annales parlementaires disent de ses interventions à la Chambre et ce que l'on sait de travail en commission où il excellait.
Ardent défenseur de la liberté commerciale et industrielle, ennemi acharné de la prohibition, il n'admet le protectionnisme que dans des cas indispensables ; ses appels en faveur du développement de nos exportations et de la représentation commerciale à l'étranger ont un caractère vraiment actuel ; il en est de même de ses opinions sur les droits et les prohibitions de sortie contre lesquels il avance, en termes presque identiques, des arguments semblables ceux qui ont été opposés de nos jours au système des retenues sur le produit des exportations
Si, en matière de législation ouvrière, il reste fidèle aux principes de Smith et de Malthus, il atténue cependant les conclusions excessives que la plupart des patrons en tirent alors, défend le droit des ouvriers à s'associer librement et intervient souvent pour améliorer les conditions de travail dans les usines. Ses remarques relatives à l'exploitation des chemins de fer par l'Etat et à l'absurdité d'un grand nombre de critiques qu'on continue à faire à celle-ci maintenant, sont frappées au coin d'une intelligence claire et d'une grande connaissance des affaires.
Il a un esprit constructif qui l'oblige à accompagner toutes ses critiques de propositions relatives aux remèdes susceptibles de les éliminer. Il dénonce l'état lamentable de nos musées mais s'empresse de montrer comment y remédier au plus grand profit du public et au moindre coût pour l'Etat. Pour ne citer qu'un autre exemple, lorsqu'en 1862 il interpelle le ministre des travaux publics sur les embarras de la circulation à Bruxelles, il réclame une station centrale et une jonction directe Nord-Midi ; bien plus, attaquant le passage à niveau de l'actuelle rue Belliard, il fournit une question un peu différente de celle qui vient d'être adoptée il y a peu de mois mais qui, à l’époque, était plus facile réaliser et à moindres frais.
En tant que député, il n'est pas homme de parti. « Je me considère ici comme le représentant des intérêts généraux du pays. dit-il un jour, et, à ce titre, je ne veux que d’un système juste et équitable pour tous. » Ce n'était pas dans sa bouche une déclaration du genre électoral. Il y avait encore, au milieu du siècle dernier, des parlementaires de l'espèce, tel De Pouhon, son collègue la Banque Nationale qui, rebelle à une discipline de parti à vues étroites, finit par se retirer de l'arène .
Prévinaire devient directeur de la Banque nationale
Peu après son entrée au Parlement, sa carrière prit une tournure nouvelle. Frère-Orban. qui le (page 10) connaissait et auquel il fut chaudement recommandé, surtout après ses interventions intelligentes à la Chambre au cours des discussions relatives à la Banque nationale, lui demanda de faire partie du premier conseil d'administration de celle-ci.
Le ministre des finances, craignant les débuts de la Banque, à juste titre comme la suite le démontrerait, ne désirait rien autant que d'accueillir, dans les conseils de celle-ci, des parlementaires désintéressés, dévoués à ses idées. Il y réussit parfaitement : Prévinaire, Bischoffsheim, De Pouhon, directeurs. Osy de Wychen. le baron Cogels, Grenier-Lefebvre. Censeurs, tous membres du Parlement, défendirent la jeune institution et répandirent constamment des conceptions saines en matière de monnaie et de crédit, alors que la majorité des parlementaires avait à cet égard des idées vagues sinon fausses et que d’autres s'érigeaient à tout propos en défenseurs des anciens privilèges de la Société Générale.
Ce n'est pas raison qu'en 1860 Prévinaire rappelait à la Chambre, parlant de Frère-Orban : « Aujourd'hui que dix années se sont écoulées depuis que la Banque a été instituée,. beaucoup de choses ont été oubliées. qu'il est bon de remettre en lumière... M. le ministre des finances nous a dit un jour qu'il avait dû forcer la combinaison de la Banque. Et en effet, la Banque a été fondée par la Société Générale et par la Banque de Belgique. Ces deux établissements ont respectivement renoncé à leur circulation de billets octroyée pour un grand nombre d'années ; ils ont renoncé à l'escompte, on a détaché de chacun d'eux le département de l'escompte et le département de l'émission pour les transférer à la Banque nationale, en vue surtout de réaliser l'unité de circulation... Eh bien, on a dû contraindre ces deux établissements à cette combinaison ; la position dans laquelle ils se trouvaient alors en raison du cours forcé donné à leurs billets leur a imposé l'obligation de l'accepter, et alors tout le monde déclarait que la Banque nationale n'était pas née viable et qu'elle ne couvrirait pas ses frais... »
Si l'institut d'émission couvrit ses frais, c'est en partie grâce à Prévinaire qui fut directeur-secrétaire d'abord, vice-gouverneur depuis 1864, gouverneur depuis 1870. En tant que directeur-secrétaire, il participa à l'organisation des services et à la création des comptoirs. Avec ses collègues qui avaient, comme lui, des connaissances multiples, une compétence étendue, des relations nationales et internationales. qui tous étaient fortunés et animés d'aspirations politiques et économiques semblables, il fut une bénédiction pour la jeune banque centrale.
Il vécut la vie de l'institution sans se distinguer autrement parmi ses collègues, jusqu'au moment où il assuma les fonctions du premier gouverneur défunt.
Un banquet lui fut offert à cette occasion par ses anciens collègues et un grand nombre de personnalités des conseil. Ces agapes ne mériteraient pas d'être signalées si elles n'avaient constitué en même temps l’occasion d'inaugurer le nouvel hôtel du gouverneur, rue du Bois Sauvage et si, peu après, les lampions ne s'étaient éteints sous le souffle de la guerre franco-allemande.
Prévinaire dans la tourmente de 70
Cette guerre, qui finit sans causer à la Belgique aucun des dommages redoutés pendant longtemps, occasionna à la Banque une des plus sérieuses alertes de son histoire et en tout cas celle qui lui valut, dans le public et à la Chambre, une notoriété très peu enviable. Elle a été racontée en détail ailleurs (Baron DE TRANNOY, Léopold II et Jules Malou. La crise financière de 1870, Revue Générale du 15 mai 1921). Mais il est indiqué d'y revenir ici parce que Prévinaire y joua un rôle fortement critiqué.
La dissolution des Chambres. réclamée par le cabinet d'Anethan et prononcée le 2 juillet, précéda de quelques jours l'ouverture des hostilités. Cependant que celle-ci répandit en Belgique l'inquiétude et la crainte, l’agitation électorale prit des proportions extraordinaires et la campagne une violence inouïe.
Les libéraux accusaient leur division interne, mais exploitaient à fond, pour opérer un redressement, le scandale Langrand-Dumonceau dans lequel le clergé et des sommités du parti catholique étaient compromis. Les catholiques désemparés eurent, de leur côté, la chance de découvrir un « scandale Banque Nationale » dont ils firent leur profit.
Ce scandale aurait pu être évité si, dans le feu des passions politiques déchainées, Tack, ministre des finances catholique, qui n'avait accepté sa charge qu'à la condition d'en être débarrassé aussitôt après les élections, avait pu s'entendre avec la direction de la Banque. habituée à traiter avec un homme à poigne (page 11) comme Frère-Orban et composée presque uniquement d'amis de celui-ci. D'où des mécompréhensions de part et d'autre et des énervements allant jusqu'au ridicule.
La bombe éclata à l'occasion de l'exécution du programme de mise en sécurité de l'encaisse métallique, élaboré naguère par Frère-Orban, repris par Tack et approuvé par Léopold II. A la suite de malentendus et d'instructions intempestives, le transfert de l'or à la citadelle d'Anvers se fit dans des circonstances invraisemblables qui, ajoutées aux sévères restrictions de crédit prises par le conseil d'administration, provoquèrent une véritable panique. A ce propos, Frère-Orban dira plus tard : « En 1870, j'ai vu bien des personnes trembler, j'ai vu bien des gens qui pouvaient se croire à la veille de leur ruine. »
Les libéraux s'en prirent à Tack, les catholiques à Prévinaire. La tension devint si forte entre eux que le gouvernement fut contraint de constituer, sous l'apparence d'une simple commission consultative, un vrai comité de salut public présidé par Malou, « ce vieux gentleman retiré de la politique » et chargé d'élaborer une politique monétaire et du crédit adaptée aux circonstances. Ce fut un camouflet le ministre comme pour le gouverneur.
Les affaires finirent par s'arranger. Mais la fin de la crise ne fut pas la fin de l'affaire de la Banque Nationale : elle fut évoquée à la Chambre qui exigea une information et publia toute la correspondance échangée entre Tack et Prévinaire ainsi que les procès-verbaux de la commission Malou, fait unique dans l'histoire de l'institut d'émission.
Jamais la question des responsabilités ne fut tranchée officiellement. Toutefois, lors de la discussion relative au premier renouvellement du privilège de la Banque en 1872, la plupart des députés qui en parlèrent estimèrent que le conseil d'administration n'avait pas été à la hauteur de sa tâche. La politique de crédit patronnée par Prévinaire s'inspirait en tout cas d'un pessimisme excessif. Elle causa l'affolement par sa brutalité. Les plaintes pleuvaient sur le bureau du gouverneur, du genre de celle-ci, venue du comptoir d'escompte de Neufchâteau : « Nous n'hésitons pas à déclarer que l'exécution stricte et rigoureuse de vos circulaires amènera fatalement la ruine complète du commerce et de l'industrie dans notre ressort... » Plaintes fondées : le gouverneur avait, pendant quelque temps, oublié combien, dans une période difficile, il faut de prudence. combien il faut avoir d'égards pour l'opinion publique.
Le gouverneur Prévinaire se ressaisit
Le calme se rétablit, les critiques s'évaporent dans l'atmosphère d'euphorie qui suit la fin de la guerre franco-allemande. La Banque connaît alors quelques-unes de ses années les plus prospères et la Belgique un essor économique sans précédent. Les opérations s'accroissent au point que les nouveaux bâtiments de la Banque, à peine achevés, doivent être agrandis et étendus du côté de la rue de Berlaimont.
Pendant que les travaux sont entamés, Prévinaire a la grande joie de présider au premier renouvellement du privilège de la Banque, sous l'égide de Malou avec lequel il avait eu (page 12) de sérieux démêlés au comité de salut public en 1870.
Il fait de grands efforts pour développer la monnaie scripturale. Il incite Malou à faire triompher en 1873 la loi sur le chèque, dont la Banque attendait des progrès considérables alors que la plupart des chambres de commerce, qui auraient dû être les premières intéressées, considéraient encore l'usage du chèque comme une utopie. Il fait des efforts heureux pour favoriser les paiements par accréditif, la perception de sommes par la poste, la diffusion de la monnaie scripturale en général.
Ce furent, pour la Banque comme pour lui-même, des années réconfortantes.
Une telle prospérité n'allait cependant sans exciter des jalousies. La Banque devenait peu à peu, pour le parti socialiste, le symbole des abus du capitalisme. Dans sa gestion, le député Defuisseaux trouve de quoi nourrir sa hargne. Nul n'ignore, écrit-il, qu'elle est « une institution spécialement exploitée par les libéraux qui y placent les invalides de la politique doctrinale… » S'attaquant à la rémunération des membres de la direction, il dira : « ces splendides émoluments, qui rappellent ceux que Langrand offrait à ses collaborateurs, eussent écrasé sous leur poids toute autre affaire que la Banque nationale. Mais celle-ci, loin d'être surchargée par un tel luxe d’appointements, a constamment payé à ses actionnaires un dividende de 16 p. c.
Prévinaire ne se préoccupait pas outre mesure de ces critiques. Il était alors au faîte de sa carrière. A la Banque, sa situation était forte, beaucoup de ses anciens collègues étaient partis, mais ceux qui les avaient remplacés et qui n'avaient pas moins de talent, de connaissances, de relations dans le monde des affaires et de la politique, le soutenaient et le respectaient.
Sa situation de fortune et celle de son épouse, ses affaires industrielles et celles de son beau-père étaient brillantes, presque tout lui avait souri dans l'existence. C'est dans sa progéniture seulement qu'il avait été déçu : il avait perdu ses trois enfants en bas âge. Aussi avoir reporté toute son affection sur ses neveux et ses nièces et resserré ses liens familiaux avec Fortamps, son beau-frère, gouverneur de la Banque de Belgique.
Fortamps était un homme nouveau, se plaisant à dire qu'il s'était élevé lui-même à la fortune. Les conservateurs le citaient, d'après Defuisseaux, comme le type de tous ceux qui, par leur intelligence, leur travail et leur mérite, arrivaient aux plus hautes positions sociales Et de fait, en 1862 déjà, la baronne Willmar le considérait comme « un de nos industriels les plus distingués, négociant notable, homme supérieur sous tous les rapports... un homme part, jeune encore, d'un mérite réel. » Il s'était lancé, comme Prévinaire, et sans doute aussi sous l'influence de son beau-père, dans l’industrie cotonnière ; après avoir fondé une usine à Leeuw-Saint-Pierre, il étendit le cercle de ses activités, entra à la Banque de Belgique et au Comité d'escompte de la Banque nationale à Bruxelles, devint administrateur de sociétés textiles et de sociétés d’assurance et fut élu sénateur. Son ascension dans le monde tout court ne fut pas moins grande que ses succès dans le monde des affaires : ses enfants s'allièrent à de grandes familles belges, les Willems, les Goethals, les Pirmez, les comtes de Bueren ; une de ses filles épousa Lord Dormer.
L'affaire 't Kint, Lolo et Fortamps
Réussir à ce point, c'est souvent tenter le sort. Le malheur était tapi dans les caves des cépôts à découvert de la Banque de Belgique, sous les traits d'un chef de bureau appartenant à une famille honorable, 't Kint de Roodebeke. Il amena la perte de Fortamps et causa à Prévinaire des ennuis et des désillusions qui assombrirent la fin de son existence.
't Kint s'était mis jouer en bourse. à une époque - celle qui suivit la guerre de 1870 - où l'agiotage allait un train d'enfer. Il avait quelque fortune personnelle et réalisa des bénéfices ; aussitôt le scenario classique se déroula. 't Kint prit une maîtresse qui fit sensation dans les milieux où l'on s'amuse et devint un des piliers de ce monde doré. La Bourse savait que les spéculations de 't Kint étaient souvent malheureuses. Mais elle croyait 't Kint fortuné, elle savait qu'il avait l'estime et la protection des dirigeants de la Banque. Lolo recevait de façon aristocratique dans un petit hôtel regorgeant d'objets d'art, rue de la Loi. Il fallut des années, avant que le train de vie de 't Kint n'éveillât des soupçons quant à son honnêteté.
En 1875 des bruits suspects commencèrent à courir. En israélite prudent, Bischoffsheim, naguère directeur à la Banque nationale et client de la Banque de Belgique s'inquiéta, (page 13) vérifia et constata des irrégularités dans la gestion de son compte de dépôts. Il en avertit Prévinaire qui avertit Fortamps, à ce moment en voyage en Angleterre Mais 't Kint sut si bien jouer le jeu, ou Fortamps se laissa berner si facilement, qu'il se passa encore des mois avant les commissaires ne procèdent à une vérification approfondie. Ce qui fit dire peu après, même par L. Hymans, député libéral, homme probe et sincère : « Il est de notoriété publique que des membres de l'administration (de la Banque de Belgique) avaient été avertis d'irrégularités graves qui se commettaient au préjudice de l'établissement. » Pour l'honneur de la Banque « on haussa les épaules. Vous savez à quel point l'honneur fut sauvegardé. »
La vérification établit en effet que 't Kint avait dérobé des valeurs pour environ 23 millions de francs-or. La « méthode de travail » de ce chef des est héroï«comique. Il l'appela lui-même « le truc du cortège de la Juive. » Allégeant tour à tour d'une partie de leur contenu les dossiers de valeurs des coffres, il en gardait toujours un paquet par devers lui en vue des inspections. « Précédant les inspecteurs dans les souterrains, l'adroit coquin, a dit Gérard Harry, introduisait ce paquet dans chaque coffre-fort successivement, pour y combler le vide pratiqué par ses soustractions. C'était toujours le même lot de titres que vérifiaient les inspecteurs et dont ils trouvaient tour à tour le compte juste dans chaque coffre-fort, grâce à ce tour de passe-passe. » (G. HARRY, Mes mémoires, Bruxelles, 1928-1929, t. II, p. 24).
Se voyant découvert il prit la fuite avec Lolo et neuf malles contenant entre autres des tableaux et de grosses sommes d'argent, restes de ses rapines.
Un grand tumulte s'empara de Bruxelles. La Banque de Belgique se trouva en mauvaise posture. Un consortium fut constitué pour lui venir en aide, mais elle ne se releva jamais complètement de ce coup. Prévinaire dut limiter l’aide de la Banque, en vertu des statuts, à accepter en dépôt, sans droit de garde. les valeurs données en nantissement au consortium par la banque sinistrée 't Kint fut arrêté au moment où il venait d'embarquer à destination de l'Amérique. Fortamps fut obligé de démissionner ; il fut inculpé pour avoir contrevenu à la loi de 1873 qui défend aux sociétés de trafiquer de leurs propres titres ; or il avait lui-même participé activement l'élaboration de cette loi quelques années auparavant.
Tristesse des dernières années
La famille Prévinaire était consternée. C'est dans une atmosphère très pénible que le gouverneur termina ses jours, d'autant plus que, depuis des années, la situation économique et financière subissait le contre-coup du boom qui avait suivi la guerre franco-allemande. Le déroulement des crises inquiétait alors les autorités responsables de la politique économique et financière par leur « côté mystérieux ». Partout le scandale résonnait, de façon particulièrement désagréable aux oreilles du gouverneur. Après l'affaire Langrand était venue l'affaire Philippart, après l'affaire Philippart. l'affaire 't Kint. D'autres désagréments s'y ajoutèrent, de bien moindre importance, mais qui affectèrent les nerfs du successeur de Haussy : un détournement à l'agence de Huy. après une grosse affaire de faux billets et un vol à la succursale d'Anvers, enfin des retards à la construction des nouveaux bâtiments de la Banque.
Prévinaire s'éteignit le 2 juin 1877, avant la fin de l'instruction ouverte contre son beau-frère.
L'enterrement fut une sorte d’apothéose. La décoration de la chapelle ardente fut confiée à Beyaert, qui venait de mettre la dernière main à l'hôtel de la Banque et à celui de la succursale d'Anvers. Après un seul discours d'adieu, prononcé par le vice-gouverneur Pirson, le clergé procéda à la levée du corps et à son transfert Sainte-Gudule. Les coins du drap mortuaire étaient tenus par des représentants de l'institut d'émission et d'autres grands établissements financiers, le cercueil était porté à bras par des employés de la Banque. Les honneurs militaires furent rendus par un bataillon de grenadiers, avec la musique de ce régiment, un peloton de guides et un peloton d'artillerie. Deux feux de bataillon saluèrent la dépouille mortelle du gouverneur à la sortie de l'hôtel et à l’entrée de Sainte-Gudule. D'après les témoignages de l'époque, plus de deux mille personnes firent cortège parmi lesquels le personnel de la Banque en habit noir et cravate blanche. Le deuil fut conduit par Malou, le viril adversaire de Frère-Orban, Van Praet, ministre de la maison du roi, Bischoffsheim, lui-même bien près de la mort, le baron Liedts, gouverneur de la Société Généraie, Charles Rogier. le vieux leader libéral, Victor Tesch. Jules Anspach, bourgmestre de Bruxelles.
(page 14) Parmi les membres de la famille figurait, au premier rang, le sénateur Fortamps qui, un an et demi plus tard, après une instruction qui dura deux ans, comparut devant la cour d'assises du Brabant réunie en session extraordinaire. Il fut condamné à un an de prison ferme et dix mille francs d’amende, jugement qui, par son extraordinaire sévérité, frappa ceux-là même qui, par rancune politique. désiraient un châtiment.