Leclercq Mathieu (1796-1889)
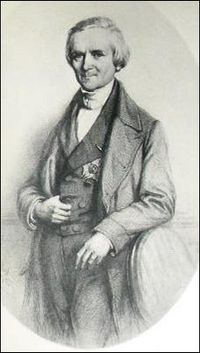
Leclercq Mathieu indéterminée
né en 1796 à Herve décédé en 1889 à Sainte-Josse-ten-Noode
Ministre (justice) entre 1840 et 1841 Représentant 1831-1832 (Liège) et 1840-1841 (Bruxelles) Congressiste élu par l'arrondissement de LiègeBiographie
(Extrait de : E. DAUBRESSE, dans Biographie nationale de Belgique, t. XXX , 1958-1959, col. 502-507)
LECLERCQ (Mathieu), jurisconsulte et magistrat éminent comme son père Olivier (1760-1842), naquit à Herve le 30 janvier 1796 et mourut à Bruxelles le 15 mars 1889.
Après avoir fait ses premières études à Herve, il entra au lycée de Liège, nouvellement organisé, où il poursuivit ses humanités avec le plus brillant succès. En 1814, il alla suivre les cours de l'École de droit installée à Bruxelles et en sortit comme avocat en 1817, à l'époque où allaient être créées les universités de Liège, Louvain et Gand. Inscrit au barreau de Liège, il se fit rapidement une réputation telle que, dès le 17 mai 1825, il fut nommé conseiller à la Cour d'appel de Liège. Il figurait parmi les membres de la Cour de cassation lorsque celle-ci fut, en vertu de la loi ou 4 août 1832, constituée le 4 octobre de la même année. Lors de la mort de M. Plaisant, il fut préféré pour remplacer celui-ci au premier avocat général Defacqz et devint, le 16 juin 1836, procureur général à la Cour de cassation. Il devait occuper ce siège pendant trente-cinq ans ; sa démission fut acceptée par arrêté royal du 27 février 1871.
Mathieu Leclercq remplit ces hautes fonctions avec éclat ; comme le dit M. Mesdach de ter Kiele, « de tous ses réquisitoires, il n'en est pas un seul qui ne soit un modèle de méditation profonde et de puissante dialectique, en même temps que de rigoureuse exactitude ».
C'est qu'il avait adopté la méthode préconisée par son père, méthode qu'il résumait dans une lettre adressée à celui-ci le 10 juillet 1817 : « Je suivrai à la lettre les conseils que vous me donnez ; je me livrerai particulièrement à l'étude du texte de la loi ; je donnerai fort peu de temps à celle des commentateurs ; je crois que c'est le meilleur moyen de se former l'esprit et de se faire un bon fond de science indestructible et ferme ; ceux qui mettent l'étude des auteurs avant celle de la loi n'ont pour ainsi dire qu'une science d'emprunt ; ils sont totalement désorientés lorsqu'ils rencontrent un cas extraordinaire et qu'ils doivent agir par eux-mêmes ».
Qu'il ait constamment appliqué cette méthode, M. Charles Faider en témoigne dans la notice rédigée pour l'Académie : « Il recueillait moins les doctrines que les principes, moins les autorités que les textes, moins les applications que l'essence ».
Il fut appelé à prononcer les premiers discours de rentrée, en vertu de la loi du 18 juin 1869. Ses fonctions lui imposaient aussi de répondre à ce qu'on appelle au parquet les « référés », c'est-à-dire aux questions posées par le Ministre de la justice ; dans les premiers temps, ces consultations étaient nombreuses et portaient sur des objets aussi divers que délicats. Notamment, il rédigea un avis sur le meilleur système pour régler les effets des secondes cassations prononcées par les chambres réunies ; le texte qu'il proposa est devenu la loi du 7 juillet 1865, qui a remplacé les articles 23 à 25 de la loi du 4 août 1832, judiciaire.
On croirait qu'une aussi brillante carrière de magistrat, exercée avec tant de zèle, suffit à remplir une vie humaine ; tel ne fut pas le cas pour Mathieu Leclercq. Il était membre du conseil de régence de la ville de Liège lorsque survint la révolution ; il se rallia au Gouvernement provisoire et fut, le 5 novembre 1830, élu membre du Congrès National, où il fit partie de la section centrale chargée de rédiger un projet de constitution ; il ne se sépara de la majorité. qu'en s'opposant à la création du Sénat. Le 31 mars 1831, il donna sa démission pour le motif qu'à son avis, le mandat de l'assemblée se limitait à la publication de la loi constitutionnelle et de la loi électorale, ainsi qu'à l'élection du Régent. De nouveau élu le 30 août 1831, cette fois comme membre de la Chambre des représentants, il n'y resta que pendant la première session, par suite de son entrée à la Cour de cassation et de l'incompatibilité établie par l'article 6 de la loi du 4 août 1832.
Lorsque, le 18 avril 1840, se forma un ministère libéral homogène, il détenait le portefeuille de la justice ; ce ministère tomba le 13 avril 1841, à la suite d'une adresse au Roi votée par le Sénat qui entendait obtenir le rétablissement d'un ministère d'union. M. Rogier, après avoir constitué un autre cabinet libéral, le 12 août 1841, proposa Mathieu Leclercq en qualité de ministre plénipotentiaire à Rome auprès du Vatican ; cette proposition ne fut pas agréée par le saint-Père.
Ce grave incident provoqua une émotion considérable ; bien que le Saint-Siège fût ultérieurement revenu sur la position d'abord prise à l'égard de Mathieu Leclercq, celui-ci refusa d'accepter le poste diplomatique qui lui était offert et maintint ce refus malgré de vives instances. Dans la suite, quoique sollicité à diverses reprises, même par le roi Léopold 1er, qui eut souvent recours à ses conseils, il n'accepta plus de portefeuille ministériel.
Entré à l'Académie en 1847, Mathieu Leclercq présenta, les 11 octobre 1852 et 9 février 1857, à la Classe lettres une étude en deux parties sur le pouvoir judiciaire, intitulée : « Un chapitre du droit constitutionnel des Belges» ; cette étude a été rémprimée en 1889 dans la Belgique Judiciaire. Ce commentaire, émanant d'un des auteurs les plus éclairés de notre pacte fondamental, constitue une source précieuse pour la compréhension et l'interprétation de celui-ci.
A diverses reprises, Mathieu Leclercq présida la Classe des lettres et l’Académie elle-même. Il dirigea aussi de 1849 à 1880 les travaux du Conseil de perfectionnement de l'enseignement supérieur, de 1854 à 1880 ceux de la Commission des examens diplomatiques et, de 1846 à 1881, ceux de la Commission pour la publication des anciennes lois et ordonnances. Il fut placé en 1853 à la tête d'une commission chargée de préparer un projet de sur l'organisation judiciaire et, en 1855, d'une commission qui devait s’occuper de réviser le Code de commerce.
Toutes ces présidences lui ont permis de déployer les qualités de précision, de fermeté et de méthode qui, jointes une étude approfondie des questions discutées, en ont fait un président modèle.
Une affection de la vue, qui aboutit en 1882 à une cécité complète, l'obligea à partir de la fin de l'année 1879 à renoncer successivement à toutes ces activités. Ainsi prirent fin des services rendus au pays pendant près d'un demi-siècle, dans les plus hautes sphères de la magistrature et du gouvernement.
L'apothéose de cette carrière se situe à l'époque du cinquantième anniversaire de l'indépendance. A cette occasion, Mathieu Leclercq prononça deux discours mémorables : « La vie et l'œuvre du Congrès National », en séance publique tenue par l'Académie le 7 mai 1879, « L'allocution des survivants du Congrès aux Chambres », devant les Chambres législatives et leurs anciens membres réunis en assemblée générale le 16 août 1880 (…)