Kervyn de Lettenhove Joseph (1817-1891)
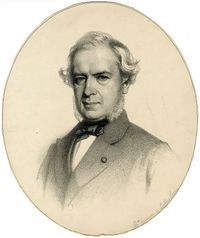
Kervyn de Lettenhove Joseph, Bruno, Marie catholique
né en 1817 à Saint-Michel (Bruges) décédé en 1891
Ministre (intérieur) entre 1870 et 1871 Représentant 1861-1891 , élu par l'arrondissement de EeclooBiographie
(THIRY Nelly, dans Biographie nationale de Belgique, Bruxelles, 1956, t. XXIX, col. 734-740)
KERVYN DE LETTENHOVE Joseph, Constantin, Marie, Bruno (baron), historien et homme politique, est né au château de Saint-Michel-lez-Bruges le 17 août 1817 et y est décédé le 2 avril 1891.
Son père, homme lettré, lui donne une instruction très soignée, à base profondément religieuse. En 1832, il va poursuivre ses études à Paris, passe avec succès son baccalauréat ès lettres et, en 1836, conquiert, avec grande distinction, le grade de licencié en Droit. Mais c'est l'histoire qui l'attire. A la Sorbonne et au Collège de France, il suit assidûment les cours donnés par Saint-Marc Girardin, Michelet, Guizot. Il se Iie d'amitié avec Villemain, Châteaubriand, Thiers et Augustin Thierry, dont il épouse les théories historiques romantiques.
Rentré en Belgique en 1839, il se consacre uniquement aux sciences historiques. Flamand, aimant sa patrie d'un amour exclusif, il s'efforce de lui élever un monument digne de son glorieux passé de liberté » : c'est l’Histoire de Flandre des origines (1700 avant Jésus-Christ) à 1792 de notre ère, en six volumes parus de 1847 à 1850, qui lui vaut l’attribution du premier Prix quinquennal d'Histoire nationale en 1851, mais qu'il se voit refuser par l'Académie française parce que imprégnée d'un esprit anti-français.
Cette œuvre est une révélation pour l'époque, étant entièrement élaborée d'après les sources ; il a vu, lu, compulsé tous les documents imprimés et manuscrits qu'il lui avait été humainement possible de consulter tant dans les dépôts publics que dans les dépôts privés. Il bâtit ainsi une œuvre originale, pleine d'aperçus nouveaux, témoignant d'une abondante érudition ; mais l'Histoire de Flandre est une illustration des théories romantiques du temps. Comme A. Thierry, Kervyn croit que l'Histoire n'est que la résultante d'un conflit de races, ici lutte de la race flamande éprise des libertés héritées des Kerels (population imaginaire venue de Scandinavie) contre la race française : aussi elle qu'un long récit de batailles : elle effleure à peine les institutions, la vie sociale, économique et culturelle. C'est de l'histoire narrative, une véritable épopée de la Flandre, écrite dans un style lyrique qui s'inspire de Châteaubriand et de Michelet, où 1'imagination supplée parfois à la rigueur des textes, Kervyn ne peut s'empêcher de les solliciter en faveur de la thèse qui lui est chère : la renaissance de la Flandre dans le cadre d'une Belgique indépendante. Il embotte ainsi le pas à Jan-Frans Willens, père du mouvement flamand.
Inlassablement, jusqu’à sa mort, Kervyn consolide le monument qu’il a élevé à la Flandre. Polyglotte et fouilleur d'archives. il tire de l'oubli une riche moisson de documents inédits d'une réelle valeur historique qui viennent éclairer et compléter de nombreux chapitres de l'Histoire de Flandre (dont il publie 5 éditions), documents qui, pour la plupart, font l'objet d'études particulières publiées dans les bulletins de l'Académie, les Comptes rendus de la Commission royale d'histoire et des revues historiques belges et étrangères. Parmi ces études signalons les plus importantes.
- Les Relations de l'Angleterre et de la Flandre durant la Guerre de Cent Ans, à l'époque des Artevelde.
- Un formulaire de l'Abbaye des Dunes, retrouvé à Bruges, permet à Kervyn de démêler, le premier, la part que l'Ordre de Cîteaux et Guy de Dampierre prirent la lutte de Boniface VIII contre Philippe-le-Be1 (Etudes sur l'Histoire du XIIIème siècle. Mémoires de l'Académie. 1854).
- Il consacre à Jacques Van Artevelde plusieurs études qui sont des apologies, ou mieux des réhabilitations du tribun gantois, si calomnié au XIXème siècle. A la suite de la découverte d'une lettre d'Édouard III à J. van Artevelde, datée du 19 juillet 1345. Il lave ce dernier de toute accusation d'inféodation à' l'Angleterre ; mais, dominé par son ardent patriotisme flamand, il lui attribue des vues politiques trop géniales qui en font un pur héros romantique. Henri Pirenne reconnait que c'est Kervyn qui a prouvé que Van Artevelde était un riche marchand de drap. et non un brasseur, et qu'il a été le premier à déterminer avec le plus d'exactitude la date de sa mort.
Kervyn prend une part active aux travaux de la Commission royale d'Histoire et de l'Académie royale. Sous l'égide de celle-ci et en sa qualité de secrétaire de la Commission chargée de la publication des œuvres des grands écrivains du pays, il édite, de 1863 à 1882, 42 volumes dont :
- Les Chroniques de Jean Froissart, 26 vol., d'après les variantes de 137 manuscrits, la plupart inédits, provenant de nombreux pays et du Vatican (Kervyn est un des rares étrangers admis à consulter ces archives encore secrètes à l'époque).
— Les Œuvres de Chasteltain, 8 vol.
— Les Lettres et Négociations de Philippe de Commines, 5 vol. Sur les 299 documents publiés, Kervyn peut s'attribuer la découverte de 234.
Sous le patronage de la Commission royale d'Histoire, dont il devient le président en 1871, il édite de 1870 à 1891 seize volumes dans la Collection des Chroniques belges inédites, dont :
— Les Chroniques relatives à l'histoire de la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne, 3 vol., la plupart inédites.
- Les Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre sous le règne de Philippe II, 10 volumes, qui contiennent plus de 4.000 pièces diplomatiques secrètes, entièrement inédites, provenant en grande partie des dossiers d'Élisabeth et de lord Burleigh.
Les grandes éditions de textes de Kervyn témoignent du labeur et du zèle inlassables de leur auteur. La quantité prodigieuse de documents qu'il a découverts ont permis d'ajouter, à toutes les époques de l'histoire, des chapitres nouveaux ou de réformer ceux qui, jusqu'à lui, étaient considérés comme l'expression de la vérité.
Les textes sont précédés d'introductions peut-être trop prolixes, mais qui sont des mines de renseignements précieux, surtout au sujet des chroniqueurs dont il est parvenu à écrire la biographie, notamment celle de Chastellain et celle de Froissart qui a eu l'honneur d'être couronnée par l'Académie française en 1857.
Malgré quelques erreurs paléographiques, les éditions de textes de Kervyn seront longtemps encore utilisées par les chercheurs auxquelles elles fournissent d’abondants matériaux. L’édition de Froissart est encore, de nos jours, la seule qui soit complète.
Comme il se plaisait à le répéter, c'est par l'histoire qu'il est venu à la politique. Élu en 1861 député de l'arrondissement d'Eeklo, dont il sera le mandataire sans interruption jusqu'à sa mort, il joue de prime abord un rôle de premier plan dans les rangs de la droite ; il en est le porte-parole dans les questions électorale, flamande, scolaire. C'est un combattif et un polémiste impénitent. Le 2 juillet 1870, il devient ministre de l'Intérieur dans le cabinet d'Anethan, mais sa carrière ministérielle est courte. La nomination au poste de gouverneur du Limbourg de Pierre De Decker, qui avait trempé dans l'affaire Langrand-Dumonceau, détermine l'agitation parlementaire et populaire de novembre 1871 qui sert de prétexte à la révocation du cabinet d'Anethan.
Kervyn, considéré comme le principal artisan de sa chute, ne s'en relève pas. Dès lors il ne joue à la Chambre qu'un rôle effacé et reprend avec une nouvelle ardeur ses études historiques.
Ses deux dernières productions importantes : Les Huguenots et les Gueux. Etude historique sur vingt-cinq années du XVIème siècle, 1560-1585, 6 volumes, et Marie Stuart L'Œuvre puritaine. Le Procès. Le Supplice, 1585-1587, 2 volumes, publiées de 1882 à 1889, n'ont plus la même valeur historique que ses œuvres précédentes ; elles sont imprégnées des rancœurs politiques du vétéran des luttes scolaires et de ses convictions religieuses.
Les Huguenots et les Gueux semblent écrits non par un historien jugeant avec une critique saine les faits et les hommes du passé, mais par un contemporain du XVIème siècle. C'est une œuvre passionnée, un plaidoyer
Partial, et c'est la raison pour laquelle elle fut écartée par le jury du Prix quinquennal d'Histoire de 1885 ; mais l'Institut de France lui décerna le prix Thérouenne parce qu'elle jette une vive lumière sur le caractère européen des relations entre les Réformés.
Quant à Marie Stuart, c'est le chant du cygne du romantique impénitent qu'est Kervyn. Son esprit chevaleresque devait l'amener à entreprendre la révision du procès de la reine d'Écosse et à innocenter la mémoire de celle qu'il vénère comme une sainte et une martyre du fanatisme puritain écossais. Aussi l'œuvre relève-t-elle de la littérature romanesque beaucoup plus que de l'histoire. Elle présente d'ailleurs de grandes analogies avec la tragédie de Schiller.
Au moment de sa mort, Kervyn préparait une étude sur don Carlos, fils de Philippe II ; il laissa inachevée une Histoire de Saint-Louis et, à l'état de projet, la publication de ses mémoires.