Hagemans Jean-Baptiste (1830-1908)
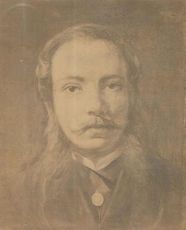
Hagemans Jean-Baptiste, Louis (Lodewijk) libéral
né en 1830 à Bruxelles décédé en 1908 à Waterloo
Représentant 1866-1878 , élu par l'arrondissement de ThuinBiographie
(Extrait du Soir, du 2 février 1908, signé CANDIDE)
Un oublié de demain
On sait - cela n'a pas la moindre importance d’ailleurs, - ce que je pense de la politique et des politiciens.
Un sens me manque pour concevoir de quelle utilité furent jamais les professionnels de la chose publique. Un scepticisme chronique m'a toujours fait tenir en extraordinaire méfiance le monsieur qui abandonne dé plein gré ses propres affaires pour s'occuper de celles des autres. Et il en sera ainsi, je le crains, tant que la politique, qui n'est encore qu'une carrière, ne sera pas considérée franchement comme un métier, et un métier réservé aux sans-travail.
Pourquoi pas en somme ? Si l'on s'est avisé de la payer, cette occupation d'amateur ou de dilettante, de virtuose ou de derviche tourneur, c'est qu'on la classe parmi les tâches qui doivent faire vivre leur homme. Or, qu’est-ce qui distingue entre elles, sinon une classification assez arbitraire, les besognes salariées ? La question ne demande - ne vaut pas, diront les intéressés, - de réponse. Que si, pourtant, Le mandat s'ennoblit ou se vulgarise en raison du mandataire. Pour l'honneur des nations, il y eut de tout temps et partout des figures qui se détachèrent, rebelles à la banalité, sur le fond uniformément pareil des plus dissemblables régimes. A deux siècles d'intervalle, ce furent des politiciens, mais de génie, que ces formidables meneurs de peuples : Richelieu, Bismarck.
Honnie ou exaltée; leur mémoire survit. Mais faut-il qu'une mémoire soit bénie ou maudite pour mériter de survivre ? Oh ! que non ! Les grands hommes, il y en a trop. Ce sont les hommes tout simplement qui manquent. Il est si malaisé d'être soi, sans rien de plus, d'être modeste et d'être fier, d'être sans bien et de demeurer tel.
Le cas est rare, certes, surtout dans le monde où s'édifient, par la grâce des sténographes, les renommées à l’emporte-pièce, c’est-à-dire à l’emporte-vote. La tribune, ce tremplin, prend à distance, et pour la masse, une silhouette de piédestal. Nombre de demi-dieux s’y hissèrent pour en descendre ; ou en être descendus malgré le geste qui s’efforce d’élargir la redingote jusqu’ l’ampleur du peplum.
Ils sont donc une élite, qu’ils aient ou non laissé un sillage dans l'argile parlementaire, ceux, combien peu connus, qui ne se canonisèrent pas eux-mêmes pour s'être assis quelque temps sur une chaise curule. Et quand un de ceux-là disparaît c'est bien le moins qu'on s'incline en passant devant sa dépouille.
Or, ces jours derniers s'éteignait dans sa petite maison de Waterloo – la maison du sage - un archéologue et un savant que son illusion de doux penseur fit, autrefois, entrer à la Chambre. IL y siégea au bureau, s'employant à mettre au service des humbles le droit d'initiative que lui conférait. son mandat électif.
S'il ne fallait pas un courage civique au dessus des vaillances humaines pour fouiller dans les tomes poudreux des « Annales parlementaires », on retrouverait trace, sans doute, de la proposition qu'il fit - c'était vers1872, je crois - en faveur de la création d'un musée industriel, à l'instar du premier établissement de ce genre formé en Belgique par les Joséphites de Melle.
Dans notre triste et cher pays, où l'on ne sépare pas l'idée confessionnelle de l'idée philosophique, ni la doctrine de l'esprit de parti, ce fut un étonnement, à gauche, lorsque ce député d'un libéralisme notoire osa vanter l’œuvre accomplie par une communauté religieuse. Une voix - une de ces voix anonymes qui se font entendre chaque fois qu'il y a une sottise à lancer - jeta même dans le débat cet argument puéril : « Mais ce sont des jésuites ! »
L'interruption n'eut d'autre effet que de provoquer une calme et loyale : « Qu'est-ce que cela fait ? Si l'exemple est bon il faut l'imiter, de quelque part qu'il vienne. »
Ces choses datent de loin ; et, depuis, l'hémicycle législatif a assisté à d'autres joutes qui ne se souciaient guère d'être oratoires.
Personne ne se souvient plus, sinon peut être quelques vieux gardes-convoi, du représentant belge qui obtint l'abolition du contrôle sur le marchepied des trains en marche... Cela paraît une vétille, cette réforme, aujourd’hui qu'elle est dans les mœurs. Aux ministres successifs dont dépendaient nos voies ferrées elle parut cependant et longtemps, à peine réalisable.
De quoi s'agissait-il après tout? D'exposer un peu moins la vie de très subalternes employés que l'Etat n'avait pas contraints à leur emploi, et qui avaient usé, souvent, de multiples influences pour y avoir accès.
Nulle part, ici-bas, on n'a coutume de tenir compte des douleurs prévenues et des larmes épargnées. La sensibilité qui prévoit est, semble-t-il, un bienfait négatif. On ne parvient que si le mal à garder la gratitude d'un acte de bonté positive. Alors !...
Il y a, au Musée du Cinquantenaire, toute une collection d'antiquités égyptiennes, amoureusement recueillies sur la terre même des Pharaons par le patient et lucide chercheur qui vient de disparaître.
Sans fortune, n'ayant pour patrimoine que ces reliques de la plus admirable des civilisations mortes, il s'était dessaisi, au profit dé tous, et par un don discret, des merveilles si lentement amassées.
Le gros public ignorerait - qu'est-ce qu'il n'ignore pas, le gros public ! – le sacrifice caché sous cette aliénation volontairement obscure. Qu'importe ! Tandis que ses seules richesses devenaient celles de son indifférente patrie, l'égyptologue travaillait à un dictionnaire des hiéroglyphes, ouvrage sur lequel il se compromit la vue et qu’il savait pourtant n’être destiné qu’à une minorité de gens d’étude… De tels hommes justifient le Créateur d’avoir conçu l’humanité.
Dois-je le confesser ? Cette sereine figure d’intellectuel aurait pu s’ensevelir dans le silence de la tombe et me rester, comme à tant d'autres, inconnue. C'est hasard d'une notice nécrologique, qui m’inspira la curiosité de savoir qui pouvait être cet érudit, mêlé, douze années durant, à la politique, et dont toute l'oraison funèbre se résumait si glorieusement en ces mots: « Il mourut pauvre. »
Mourir pauvre quand on fut si près du pouvoir, quand il ne manque pas d'entreprises financières pour accueillir avec déférence un titre d'ancien député, un ruban rouge, une cravate de commandeur !
La politique n'était donc plus uniquement un outil, un moyen ! Les politiciens n'étaient donc pas nécessairement à l'affût des sinécures décoratives et rémunérées !... Tant pis ! - s'il y a de l'impertinence dans cette stupeur.
On a beau ne pas avoir le temps d'apprendre qui vit ou qui meurt, notre égoïsme n’est pas à l’épreuve de toute spontanéité d'émotion. En sommes-nous là que nous puissions laisser la terre combler une fosse sans jamais nous demander qui git dans le cercueil ? Non. Quelquefois le plus fugitif caprice 'de lumière couronne d'un nimbe pâle une existence finie. Qui, dans les cimetières, ne s'est penché, malgré soi, sur une épitaphe et ne s'est attardé, méditatif, devant l'inconnu d'un passé !
C'est avec cette émotion, c'est devant cet inconnu que s'est arrêtée ma songerie. Elle n'a pas interrogé la mort, mais une vie. Et ce qu'elle y a trouvé fut très noble et très pur.
La race de ces doux qui savent disparaître comme ils vécurent – dédaigneux du faste et du bruit - tend à s'épuiser, faute de sang nouveau. Les jeunes générations sont plus de avides de célébrité, quelle qu'elle soit, que de sagesse. Faire tapage autour d'elles leur semble un hommage précoce rendu à leur ambitieuse valeur. La science, comme la politique, est pour elles un tréteau, d'où elles jugent avec une pitié, condescendante le tranquille idéal du vieillard qui se réfugie dans la retraite et I 'ombre. Libre à elles. Tout se métamorphose à mesure que les années s'écoulent. L’heure vient pour les plus insatiables ou les vanités satisfaites sont impuissantes à remplir le vide de l’âme. A force de se servir, comme d'échelons, de l'épaule ou l'échine des hommes on en arrive à mépriser ses semblables, qui vous le rendent bien. Il n’y a encore que les modestes et les simples pour se créer l'intime atmosphère de tranquille résignation qui enveloppe d'une paix si profonde l’approche du dernier sommeil.
Il mourut pauvre, - comme tous les désintéressés - le savant qu'une femme et une filles aimées pleurent avec le plus encore qu'avec les larmes ; il mourut pauvre !...
Dans Waterloo, qui n'est plus morne plaine; il est une tombe - humble comme lui.
Il fut représentant du peuple; il fut de I 'Académie de Belgique ; il fut chevalier des Ordres du Roi... Son nom? Ce disparu d'hier, Cet oublié de demain se nommait Gustave Hagemans
(Paul SAINTENOY, dans Bulletin de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique, Bruxelles, 1914, pp. 56 à 61)
Quelques-uns des membres de l' Académie - il avait voulu à ses funérailles, le plus de simplicité possible, le calme serein d'une intimité absolue - accompagnèrent la dépouille funèbre de notre ancien président Gustave Hagemans. décédé Ile 17 janvier 1908, au champ de repos.
Mais à !'annonce de sa disparition, l'Académie a voulu qu'une biographie consacrât dans ses publications le souvenir des services que nous a rendus cet homme de mérite, trois fois notre président en 1867, en 1871 et en 1876 et qui fut en sa qualité de primus inter pares président du premier congrès international d' Archéologie, ouvert, à Anvers, le 25 août 1867 .
Sa mémoire se conservait raréfiée parmi nous, car sa collaboration si active de 1864 à 1876, s'était faite plus rare jusqu'en 1878, pour disparaitre totalement en 1884.
Ses devoirs de la vie politique - il eut longtemps un mandat à la Chambre des représentants dont il fut secrétaire - l'avaient éloigné de nos études, un peu détaché de nous, bien que sa pensée, la tendance intime de son esprit en faisaient un adepte fervent de nos recherches.
Tout au contraire, il y trouva dans les traverses de l 'existence, qui vinrent assombrir ses jeunes et ses vieilles années, un réconfort et une consolation.
Son dilettantisme érudit le poussa vers les études historiques comme le navigateur va au jour de la tempête vers le port hospitalier.
Gustave Hagemans, né à Bruxelles, le 27 mai 1830, suivit tout jeune sa vocation et, dès 1854, nous trouvons trace, dans la bibliographie archéologique, de sa production historique.
Sa préparation scolaire, à l'athénée royal de Tournai , à la faculté de droit de l'université de Liége ensuite, avait été brillante, semée de succès éclatants. Il avait la préparation scientifique que l'on pouvait acquérir à cette époque et c'est ainsi armé qu'il entreprit à 20 ans de réunir une collection d'antiquités et d’objets d'art qui devait dans sa pensée embrasser l'universalité des temps et des peuples.
Chaque objet faisait l’objet d »une notice et toutes ces notices devaient former « Ie cabinet d'un amateur » dont le catalogue raisonné donna lieu à la publication commencée en 1 855 pour ne se terminer que huit ans plus tard. Gustave Hagemans avait entre-temps été frappé lui-même par les souffrances qui devaient faucher à la fleur de la vie, la compagne bien aimée qu'il s'était choisie !
Celle-ci était tombée gravement malade, avait été obligée de quitter nos brumes hivernales glacées et il était allé avec elle vers les cieux cléments du midi chercher un adoucissement à ses douleurs et peut être la guérison que l'on espère toujours mème contre l’impossibilité de tout espoir.
C'est ainsi qu'Hagemans passa cinq années d'une vie de crainte et de soucis constants, en Italie, à Venise, à Florence, à Rome, à Milan , sur les bords enchanteurs des lacs de Côme et de Garde.
Tous les moments de quiétude et d'apaisement qu’il l eut en ces tristes années, il les consacra à ses achats, à ses notices, enrichissant dans les bibliothèques de Rome et à l’Ambrosienne de Milan les notes si nombreuses qu'il réunissait chaque jour pour augmenter sa documentation archéologique.
Puis vint le dénouement de ce sombre drame de la vie de tous les jours. Il errait dans le Campo Santo de Pise, devant les œuvres de Busschetti et d'Orcagna, lorsque la pauvre campagne de sa triste vie tomba et lui fut ravie, laissant un profond et sinistre découragement, une lassitude de vivre ainsi des jours de tristesse et de douleur à son pauvre Gustave Hagemans.
L'âme meurtrie, il revint e n Belgique, ou l’étude lui rendit un peu de calme et un peu d'oubli après des jours si pénibles. Son œuvre était restée manuscrite, les feuillets en avaient jaunis et cependant il n'eut pas le courage de les reprendre.
Il alla esseulé et triste vers l 'Orient, éblouissant de clarté et de lumière, vers !'Egypte, vers la Grèce, vers la Palestine d'ou il devait rapporter de multiples sujets d'étude et de nombreuses richesses. Son Cabinet d'Amateur vit enfin le jour en avril 1863, chez l’ éditeur Gausé à Liége et à Leipzig. Ce recueil se composait de notices archéologiques et de descriptions raisonnées de quelques monuments de haute antiquité rassemblés par notre collègue et dans le but encyclopédique « de faire embrasser d'un coup d'œil les révolutions des peuples dans les arts pour mieux laisser suivre pas à pas la marche progressive des connaissances humaines et dans ce livre ouvert laisser lire l'histoire dans ce qu'elle a de plus intime et de moins aride. »
La phraséologie a un peu vieilli, la tentative était au-dessus des possibilités, un peu de !'esprit encyclopédique du XVIIIème siècle l’imprégnait et l’on peut sourire de cet esprit charmant qui à 25 ans voulait ainsi que dans une collection particulière, on trouve l'histoire universelle toute entière ! L'homme est intéressant, captivant lors qu'il vous dit : « Je devins un ami passionné de l'Archéologie et, comme un amant d'une femme adorée tout en étant jaloux d'elle j'aurais voulu la voir admirée de tous, que tous la disent digne d'amour. » Et les mots se suivent, les idées s'enchaînent : « J'étudiais avec passion… j'étais naïf, Je le sens maintenant… J'écrivis… je me fis imprimer… maintenant, Je n'ai plus la naïveté… la jeunesse, l'ardeur, j’ai le cœur en deuil… »
Il comprenait, on le voit, que l’œuvre entreprise était au-dessus des forces d'un homme et il vendit à l' Etat à un prix très réduit une partie de sa collection , puis il donna à notre musée National le restant, les plus belles pièces dans un moment de découragement et de tristesse. Le ministre d'alors, Charles Rogier, exigea que son nom restât, en reconnaissance, attaché à chacun de ces objets entrés ainsi dans le domaine de la nation et qui forma le premier fonds du Musée de la porte de Hal avec ce qui restait alors de nos antiquités nationales.
Evidemment un cabinet d'amateur composé en 1855 par un esprit enthousiaste, non suffisamment formé par des recherches patientes et une critique étendue est sujet à caution.
On a pu critiquer certaines parties de ce livre abondant et touffu qui embrasse le passé depuis les pyramides d'Egypte, mais on est forcé au respect devant une œuvre pareille élaborée par un jeune homme de vingt-cinq ans à une époque ou - il faut bien le dire - la haute antiquité était peu étudiée chez nous et ou notre moyen âge était encore presqu'inconnu.
Hagemans se fit, pour compléter son œuvre, dessinateur et graveur des 250 figures à l’eau-forte qui ornent son livre.
Trois ans plus tard, en 1866, paraissait son Histoire du pays de Chimay, chez Olivier, éditeur à Bruxelles. 598 pages in-1°. Il avait retrouvé sa voie et son esprit apaisé lui permettait de continuer la carrière de recherches érudites qui plaisait tant à sa vocation native.
Ce livre cependant se ressent de ses occupations politiques nouvelles . Peut-être bien qu'on peut lui reprocher de contenir quelque chose des polémiques journalières, mais le livre est resté très intéressant, très documenté, très bien écrit et une de nos bonnes monographies de communes.
Son temps maintenant était occupé largement par son mandat de député qui le forçait à quitter constamment Chimay ou il avait fixé sa résidence estivale. A la Chambre , il fut un orateur de beaucoup de fond, s'exprimant avec netteté et clarté ; très indépendant, il défendit contre ses amis politiques, le subside à accorder aux Bollandistes, comme il devait le rappeler plus tard.
Les questions touchant aux Beaux-Arts trouvèrent en lui un défenseur convaincu et son bon cœur, son esprit humanitaire lui firent prononcer un discours sensationnel sur l’abolition de la peine de mort. Il partageait les idées de Victor Hugo, instruisez-la, vous ne devrez pas la couper.
Mais cela m 'éloigne du but principal de cette notice où ne doit apparaître que la vision du bon archéologue que fut Hagemans.
On conserve encore à Anvers, le souvenir du Congrès international d'archéologie, qui se réunit dans cette ville, en 1867, sous les auspices de notre Compagnie dont le président Hagemans fut également celui du Congrès. L'auteur de ces lignes se souvient avoir entendu raconter par des amis, hélas ! disparus eux aussi, les splendeurs de la réception que fit Gustave Hagemans aux savants de toute l'Europe ; son' autorité, son tact parfait, une urbanité délicate et un esprit délicieux excusaient son jeune âge.
J'ai souvent entendu vanter le succès de cette réunion qui , après un lendemain à Bonn , en 1869, ne devait plus se renouveler. Le canon de 1870 l'a anéantie.
Puis vinrent des expériences agricoles coûteuses dans le pays de Chimay, des tentatives de défrichement qui devaient laisser Hagemans désabusé et dans une toute autre situation qu'à ses brillants débuts.
Encore une fois ce furent ses chères études historiques qui devinrent Ile refuge et la consolation de sa vie désemparée.
La vie domestique d'un seigneur châtelain du moyen âge parut en 1888, chez Gilon , à Verviers, et Le poignard de Silex en 1889, chez Vromant à Bruxelles. Ce curieux opuscule trop oublié a d'abord fait le sujet d 'une conférence faite à la Société royale d'Archéologie de Bruxelles, le 12 avril 1888. J'entends encore G. Hagemans évoquer à nos esprits, toute la période d'élaboration des études préhistoriques, tous ces ouvriers de la première heure qu'il avait connus, dont il avait partagé les travaux, les Schmerling, les d'Omalius d 'Halloy, les Boucher de Perthes et parmi les vivants d’alors, morts aussi depuis, les Edouard Dupont, les Selys-Longchamps. Il nous disait sa passion pour les études préhistoriques, nous parlait des Congrès de Bruxelles de 1872, de Stockholm de 1876, où il avait représenté notre gouvernement. La forme du roman historique destinée à faire comprendre mieux la formation des idées chez l'homme primitif est pleine d'embûches. On a reproché à Hagemans son poignard de Silex, mais la tentative est intéressante. Il a évoqué en nous la source des croyances, le grand ancêtre devenant le héros divin , l'habile ouvrier du poignard de Silex, le totem, promu au rang des immortels et dont la mémoire prodigieusement éloignée et fruste se perpétue jusque dans les légendes des temps archaïques, Enée, Hercule.
Puis le sexagénaire qu'était devenu Gustave Hagemans, se livra à l'élaboration d'un lexique français-hiéroglyphique qui vit le jour en 1896, à la librairie Falk & Cie, à Bruxelles.
Il s'agissait dans sa pensée de faciliter les recherches et de fournir la clef qui évitera de longs tâtonnements inévitables lorsqu'on n'a sous la main qu'un dictionnaire égyptien sans guide aucun pour le consulter.
Et avec une patience admirable, Gustave Hagemans se mit à autographier lui-même les mille pages de son lexique tiré à petit nombre d' exemplaires.
Cet homme presque septuagénaire, presque privé de la vue s 'astreignit à ce labeur énorme avec sérénité. Ce livre que son labeur journalier avançait avec lenteur, il eut un jour la terreur de devoir l'abandonner. Ses yeux , ses pauvres yeux usés et abimés refusaient leur service et dans sa grande douleur, dans l 'angoisse la plus grande qui puisse saisir un savant, il eut cependant la force de vaincre l'adversité et de finir « quand même » son œuvre. Il ne conservait plus qu'un œil, l'autre était fermé à la lumière.
Les pionniers de la science ont de ces héroïsmes et la foi en la beauté de leur œuvre, la conscience de la force altruiste, la pensée de l’humanité qui profitera de ce labeur suppléent aux forces défaillantes et leur permettent de vaincre l’obstacle.
Certes Ie livre contient des erreurs, certes cette énorme compilation qui devrait être révisée par un de nos jeunes égyptologues et republiée en typographie à de nombreux exemplaires, contient des lacunes, mais l'œuvre est considérable et capable de sauver la mémoire de Gustave Hagemans de l’oubli .
Il a pu se dire en mourant en sa modeste demeure de Waterloo: « Hems-na in Ptah », je me couche comme Ptah, après une belle carrière, dans une douce brume qui estompait doucement sa physionomie sympathique et aimable.
Son éclat avait disparu, sa carrière politique était finie (qui se souvient que c'est à, lui que nous devons la suppression du contrôle des trains le long des wagons en marche), sa personne était oubliée même dans les corporations savantes qui s'étaient honorées d'inscrire son nom parmi leurs membres, mais contrairement à l'expression d 'un de ses biographes, Candide, du Soir de Bruxelles , mélancolique et résigné, Hagemans ne doit pas être « l 'oublié de demain » , son souvenir est indissolublement lié à notre Musée National dont 1500 numéros portent à perpétuité son nom (1), que ses fils, dignes d'un tel père, font brillier dans les annales des Arts, de la Diplomatie et de l' Armée.
Pour un aperçu plus complet de sa carrière scientifique et politique, voir Joffrey LIENARD, Inventaire des archives du fond Gustabe Hagemans 1830-2004, Bruxelles, 2019, pp. 7-13