Goblet (d'Alviella) Albert (1790-1873)
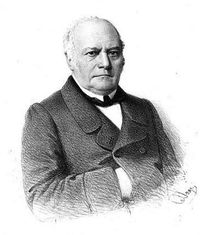
Goblet (d'Alviella) Albert, Joseph libéral
né en 1790 à Tournai décédé en 1873 à Bruxelles
Ministre (guerre et affaires étrangères) entre 1830 et 1845 Représentant 1831-1833 (Tournai) et 1833-1834 (Bruxelles) et 1836-1837 (Bruxelles) et 1843-1847 (Tournai) et 1854-1859 (Bruxelles)Biographie
(Extrait de : Th. JUSTE, dans Biographie nationale de Belgique, t. VII, 1880-1883, col. 822-828)
GOBLET (Albert-Joseph), comte d’Alviella, homme d’Etat, etc., vit le jour à Tournai, le 26 mai 1790. Il était fils d'un éminent magistrat qui, après avoir servi Joseph II, devint membre du Corps législatif du premier empire français. Albert Goblet atteignait sa douzième année lorsqu'il quitta la maison paternelle pour entrer au Prytanée de Saint-Cyr. Après de brillantes études, il obtint, en 1807, le prix impérial de mathématiques, au concours général des Prytanées, et fut couronné au sein de l'Institut de France, par le ministre de l'intérieur, au nom de l'empereur. En 1809, il était admis à l'Ecole polytechnique ; en 1811, il entrait à l'Ecole spéciale d'artillerie et du génie de Metz, et, le 21 août de l'année suivante, il était nommé lieutenant en second au 2e bataillon de sapeurs. Il prit part, le 21 juin 1813, à la bataille de Vittoria, puis reçut l'ordre d'aller coopérer à la défense de Saint-Sébastien, que les Anglais tenaient bloqué. Il parvint à passer au milieu de la flotte britannique et, pendant deux mois, ne cessa de donner des preuves éclatantes d'intelligence et de bravoure. En récompense de sa belle conduite, il fut nommé membre de la Légion d'honneur et, peu de temps après, capitaine du génie.
Après la chute de l'empire français, le capitaine Goblet fut admis dans la nouvelle armée des Pays-Bas, et en juin 1815, chargé du service du génie dans la division du général Perponcher. Il se trouva avec cette division aux Quatre-Bras et le surlendemain à Waterloo. Il y mérita et obtint la décoration de l'ordre militaire de Guillaume. Signalé au duc de Wellington, dont il avait été en 1813 le prisonnier. et recommandé au prince d'Orange comme un officier de grand mérite, le capitaine Goblet fut chargé de la reconstruction de la forteresse de Nieuport, vaste travail auquel il consacra sept années. Il était commandant du génie à Tournai lorsque, en 1824, il fut désigné pour accompagner le prince d'Orange en Allemagne et en Russie. A son retour, le prince aurait voulu l'attacher définitivement à sa personne, mais le roi Guillaume n'y consentit point et le chargea de la reconstruction de la place de Menin.
Ce fut à Menin que vinrent le surprendre les événements du mois de septembre 1830. Le 10 octobre, un exprès lui apporta l'invitation de se rendre à Anvers près du prince d'Orange, et, le même jour, il recevait, de la part du gouvernement provisoire de Belgique, une dépêche qui le pressait de se rendre à Bruxelles. Un ordre du prince Frédéric enjoignant au capitaine Goblet de se rendre à Flessingue avait été intercepté et remis au gouvernement provisoire, qui alors avait songé au commandant belge de Menin. Le capitaine Goblet pensa que son devoir l'appelait près du prince d'Orange. Il témoigna au prince qu'il lui serait bien pénible d'être séparé de sa personne pour se rendre à Flessingue, et le prince ne put le rassurer complètement sur le pouvoir dont il jouissait. Le capitaine Goblet suivit alors les conseils de son ancien condisciple, M. Lehon, qui se trouvait également à Anvers, et partit avec lui pour Bruxelles. Ils y arrivèrent dans la nuit du 11 au 12 octobre. Le 15, le gouvernement provisoire nomma le capitaine Goblet colonel et directeur de l'arme du génie ; quinze jours après, il l'appelait à la direction du département de la guerre. Nommé général de brigade le 31 janvier 1831, Goblet siégea comme ministre dans le premier cabinet du régent. Des travaux excessifs ayant altéré sa santé, il demanda sa démission et, le 24 mars, il reprenait les fonctions de directeur général du génie.
Pendant la campagne de dix jours, le général Goblet ne quitta point le roi Léopold, et, le 11 août, il fut chargé de remplir les fonctions de chef de l'état-major. Investi du commandement de l'armée lorsque le roi eut pris la résolution de se retirer sur Malines, le général Goblet conclut la suspension d'armes en vertu de laquelle les troupes belges purent évacuer Louvain sans pertes aucunes.
Le 31 août, les électeurs de Tournai appelaient le général Goblet à l'honneur de les représenter à la Chambre. De son côté, le roi Léopold lui confiait une mission hérissée de difficultés. Il s'agissait de déterminer, avec les plénipotentiaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, le nouveau système défensif de la Belgique.
Pendant l'accomplissement de cette mission, le général Goblet fut nommé en outre plénipotentiaire près la conférence de Londres ; il remplaçait, momentanément, M. Van de Weyer, qui se trouvait en désaccord avec le ministre des affaires étrangères, M. de Muelenaere. Le général Goblet ne réussit pas à rallier lord Palmerston au système dans lequel persistait le cabinet de Bruxelles.
Le gouvernement hollandais venait d'adresser des propositions à la conférence. D'accord avec le gouvernement français, lord Palmerston était d'avis que des négociations directes avec le cabinet de La Haye pourraient amener une conclusion conforme aux engagements pris par les puissances à l'égard de la Belgique. On résolut en conséquence d'éprouver la sincérité du cabinet de La Haye. M. de Muelenaere, ayant refusé d'entrer dans cette voie, résigna son portefeuille et fut, le 18 septembre 1832, remplacé par le général Goblet, qui obtint le concours de MM. Lebeau et Rogier.
« Après avoir fait constater le refus du gouvernement des Pays-Bas de négocier pour arriver à l'exécution du traité de 1831, le général Goblet, devenu ministre des affaires étrangères, réclama, dit M. Rogier, l'intervention des puissances garantes du traité, afin d'obtenir l'évacuation de la citadelle d'Anvers. Son thème, énergiquement formulé, était celui-ci : Evacuation de la citadelle par le concours des puissances garantes ; à leur défaut, la Belgique entreprendrait par ses propres forces et dans un délai déterminé l'évacuation qu'elle réclamait. Cette sommation, à laquelle le gouvernement du roi était très décidé à donner suite, fit cesser l'inaction des puissances. La France et l'Angleterre s'unirent pour forcer la main aux Pays-Bas. La citadelle d'Anvers, après avoir été bravement défendue, fut forcée de capituler. La ville d'Anvers rentra en possession d'elle-même et le pays respira plus librement. Le ministère, ne trouvant pas dans la Chambre des représentants l'appui qu'il devait attendre d'elle, eut recours à une dissolution. Le général Goblet, combattu à Tournai par les ultras de tous les partis, succomba ; mais cet échec fut immédiatement réparé par les électeurs de Bruxelles. Lorsque la Chambre nouvelle se réunit le 7 juin 1833, le ministre des affaires étrangères lui présenta la convention qui avait été signée à Londres, le 21 mai précédent.
« En vertu de ce traité, la Belgique, disait encore M. Rogier, demeurait, sous la garantie des puissances, en possession du territoire et des avantages dont elle jouissait depuis 1830, sans être assujettie à aucune des charges que lui imposait le traité de 1831. Et cette situation toute favorable se prolongea pendant une période de près de sept années, période durant laquelle il fut permis à la Belgique d'ouvrir avec sécurité les diverses sources de sa prospérité et d'en favoriser le développement. »
Le général Goblet crut alors accomplie la tâche pour laquelle il avait accepté le lourd fardeau des affaires extérieures. Le 27 décembre, il remettait au roi le poste où il avait su acquérir, par sa prévoyance et sa haute capacité, la réputation d'un véritable homme d'Etat. Depuis 1832 il était désigné pour remplir les fonctions de ministre de Belgique à Berlin. Mais une intrigue, dont la source était à La Haye, s'ourdit contre lui, et le général quitta la carrière diplomatique plutôt que de consentir à faire une démarche qu'il regardait comme humiliante pour le pays dont il était le représentant. Le 4 juillet 1835, il était élevé au rang de lieutenant général, « en récompense des éminents services qu'il avait rendus au pays ». Le 14 mai de l'année suivante, les électeurs de Bruxelles l'appelaient de nouveau à la Chambre des représentants.
En 1837, nommé envoyé extraordinaire en Portugal, le général Goblet, se conformant aux instructions du roi Léopold, devint le conseiller de la jeune reine dona Maria et du prince-époux Ferdinand de Saxe-Cobourg-Cohary. Pour récompenser les services exceptionnels que lui rendit le général Goblet, la reine dona Maria, par des lettres patentes du 21 juin 1808, confirmées ensuite par le roi des Belges, éleva l'éminent homme d'Etat à la grandesse sous le titre de comte d'Alviella, du nom de l'un des domaines de la maison de Bragance.
Après la conclusion du traité du 19 avri1 1839, le général Goblet remplit une nouvelle mission en Allemagne. Il était chargé de notifier l'avènement du roi Léopold aux cours de Saxe et de Hanovre, ainsi qu'à d'autres membres de la Confédération germanique, qui jusque-là n'avaient point reconnu la Belgique comme nation indépendante. Le 16 avril 1843, le général Goblet occupait pour la seconde fois le ministère des affaires étrangères. Parmi les nouveaux services qu'il rendit, il faut signaler le traité conclu, le 1er septembre 1844, entre la Belgique et les Etats composant le Zollverein. Il quitta le ministère le 30 juillet 1845.
Depuis 1843, il représentait à la Chambre l'arrondissement de Tournai. En 1847, comme on allait procéder aux élections pour le renouvellement partiel de la législature, le général accepta le nouveau mandat que les libéraux de sa ville natale lui offraient. Mais le cabinet, présidé par M. de Theux, exerça sur lui une véritable pression et l'obligea à se désister.
Depuis 1845, le général était aussi en désaccord avec le souverain, et ce dissentiment s'aggrava lorsqu'il s'agit d'arrêter les bases matérielles du système militaire le mieux adapté à la Belgique.
Le 24 février 1854, le général Goblet, inspecteur des fortifications et du corps du génie, était admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite et déchargé des fonctions d'aide de camp du roi. Au mois de juin suivant, les électeurs de Bruxelles lui rouvraient les portes du parlement ; il fut réélu en1857 et passa cinq années à la Chambre, toujours fidèle au libéralisme constitutionnel. Lorsqu'il se détacha enfin de la politique active, ce ne fut pas pour demeurer oisif. Il allait consacrer ses loisirs à raconter la part qu'il avait prise aux événements les plus mémorables de 1831 et de 1832. Il publia successivement deux ouvrages qui seront toujours consultés avec fruit : 1° « Des cinq grandes puissances de l'Europe, dans leurs rapports politiques et militaires avec la Belgique. Une mission à Londres eu 1831 » ; 2° « Dix-huit mois de politique se r'attachant à la première atteinte portée aux traités de 1815. »
Le général Goblet est mort à Bruxelles, en 1873, à l'âge de quatre-vingt-trois ans.
(Extrait de : E. BOCHART, Biographie des membres des deux chambres législatives, session 1857-1858, Bruxelles, M. Périchon, 1858, folio n°57)
COMTE GOBLET D'ALVIELLA, Albert-Joseph
Né à Tournai, le 17 mai 1790,
Représentant, élu par l’arrondissement de Bruxelles
La ville de Tournai peut revendiquer à bon droit le titre de pépinière d'officiers, notre annuaire militaire en fait foi.
Voici encore un enfant de Tournai qui s'est distingué parmi ses concitoyens.
Admis, en 1802, au prytanée militaire de Saint-Cyr, M. Goblet remporta, en 1807, le prix de mathématiques au concours général des prytanées, et se vit couronner, à l'Institut de France, par le ministre de l'intérieur.
En 1809, il entrait à l'école polytechnique. Le jeune mathématicien prenait l'état militaire au sérieux. Ce n'était pas seulement pour lui une carrière qui lui permettait d'exercer son courage et sa force, c'était encore une science exacte à acquérir, un art compliqué dont il voulait posséder jusqu'aux derniers secrets.
Sorti avec distinction de l'école polytechnique, M. Goblet fut nommé officier du génie, et passa une année à l'école d'application de Metz. Puis il servit en Espagne, à l'armée dite de Portugal, où il fit les campagnes de 1812, 1813 et 1814.
Dans le courant de l'année 1813, M. Goblet donna son actif concours aux armes françaises dont la fortune devenait désastreuse. Après la perte de la bataille de Vittoria, il fut spécialement désigné pour aller prendre part aux travaux de défense de St-Sébastien, que les Anglais bloquaient déjà par mer. Après des efforts inouïs, M. Goblet parvint à se jeter dans la place. Durant le sège de soixante jours qui suivit son arrivée, le jeune officier se couvrit de gloire. Il y gagna la croix de chevalier de la Légion d'honneur et le grade de capitaine du génie. Il reçut en cette qualité la mission de défendre Navarreins, cernée et assaillie par les Espagnols ; il résista à l'ennemi jusqu'à la chute de l'Empire.
Le 16 février 1815, le capitaine Goblet passa au service des Pays-Bas. Il se signala au combat des Quatre-Bras, et reçut la décoration de quatrième classe de l'ordre militaire de Guillaume.
Au rétablissement de la paix, le capitaine Goblet fut chargé de la construction de la forteresse de Nieuport ; ses travaux lui méritèrent la haute approbation de son souverain, qui le promut, en 1823, à la troisième classe de l'ordre militaire.
Ces travaux terminés, le capitaine Goblet alla commander le corps du génie à Tournai.
De 1824 à 1825, il fut appelé à accompagner le prince d'Orange dans un voyage en Prusse, en Allemagne, en Russie et en Pologne. A son retour, le Roi Guillaume le chargea d'achever les fortifications de Menin.
Les événements de 1830 placèrent les officiers belges dans une position délicate d'où le capitaine Goblet, sut, comme tant d'autres de ses frères d'armes, sortir avec honneur.
Mandé par le Gouvernement provisoire pour y être attaché dans la partie du comité de la guerre qui convenait à ses connaissances spéciales, il fut nommé colonel, directeur de l'arme du génie, et bientôt après, commissaire général de la guerre.
Dès lors il s'occupa sans relâche d'organiser l'administration militaire, et une force armée capable de soutenir l'indépendance nationale. Avec des cadres incomplets, il parvint à organiser trente-deux mille hommes de troupes régulières et six mille volontaires. Le Gouvernement provisoire récompensa cette activité par le grade de général de brigade.
Dans le premier ministère du Régent, il fut chargé du portefeuille de la guerre. Après la retraite rapide de ce cabinet, il reprit les fonctions de directeur général du génie.
Lorsque le prince Léopold de Saxe-Cobourg vint prendre possession du trône, le général fut désigné pour accompagner l'élu de la nation dans les visites des différentes forteresses du pays.
Pendant la courte campagne du mois d'août 1831, le général Goblet était commandant en chef du génie de l'armée. Le général d'Hane de Steenhuyse ayant été blessé au combat de Bautersem, il le remplaça comme chef d'état-major général. Ce fut en cette dernière qualité qu'après la retraite du roi vers Malines, il conclut avec le prince d'Orange une suspension d'armes.
La fin du mois d'août vit les premières élections pour la Chambre des représentants. Tournai offrit un siége au Parlement à son courageux et habile concitoyen. Le général Goblet fut élu député le 30 du même mois.
Cependant la Conférence de Londres va s'ouvrir ; l'honorable Général est délégué avec les pleins pouvoirs du roi pour s'entendre avec les plénipotentiaires des grandes puissances au sujet des forteresses de la Belgique. Peu de temps après, il est accrédité près la Conférence, pour les affaires générales du pays, et son énergie pesa d'un grand poids sur les délibérations et les décisions des gouvernements étrangers.
Le 17 septembre 1832, le général Goblet prit la direction des affaires étrangères, et accepta seul, jusqu'au 20 octobre, toute la responsabilité des événements, qu'il dirigeait en secret, pour arriver à faire refuser par la Hollande de négocier sur les conditions de lord Palmerston.
C'est sous ce ministère, qui fut complété par MM. Rogier, Lebeau, Duvivier et Evain, que fut demandée l'intervention des grandes puissances stipulée dans le traité du 15 novembre 1831, et que l'armée française vint assiéger la citadelle d'Anvers.
Malgré les succès diplomatiques qu'avait obtenus le ministère, il n'était pas convenablement soutenu par la majorité de la législature, et, le 28 avril 1833, il dut avoir recours à la dissolution de la Chambre des représentants.
Le général Goblet se présenta devant les électeurs de Tournai desquels il tenait son premier mandat. Les ennemis des voies diplomatiques firent échouer son élection. Mais Bruxelles prit fait et cause pour l'honorable Général, et lui donna le mandat que Tournai venait de lui retirer.
Bientôt le général Goblet fut chargé d'une mission auprès du roi de Prusse, et dut renoncer à son titre de représentant. A son retour, les électeurs de l'arrondissement de Bruxelles saisirent la première occasion pour lui rendre son siége au Parlement, et, le 14 mai 1836, il reçut d'eux une nouvelle consécration parlementaire.
En 1837, le général Goblet fut envoyé par le roi en mission extraordinaire et en qualité de ministre plénipotentiaire auprès de la reine Dona Maria, afin d'aider le Gouvernement portugais de son expérience d'homme de guerre et d'homme d'Etat. L'ambassadeur fut assez heureux pour contribuer puissamment à consolider la jeune dynastie. La reine reconnaissante éleva le général Goblet à la Grandesse du Royaume, sous le titre de comte d'Alviella. Notre Roi lui confirma ce titre, et l'assura à ses descendants mâles.
En 1843, M. Goblet reparut au Parlement; il venait d'être nommé représentant par l'arrondissement de Tournai, et choisi par le roi comme ministre des affaires étrangères. Le cabinet dont il fit partie demeura au pouvoir jusqu'au 31 juillet 1845.
Après la retraite du ministère, le général Goblet dessina sa situation politique dans les rangs de l'opposition libérale, et l'on ne dut pas s'étonner de le voir rester fidèle aux opinions qui l'avaient fait appeler au pouvoir en 1843.
Au mois de juin 1847, il abandonna la scène politique, pour se livrer exclusivement et utilement aux travaux de sa carrière spéciale.
A cette époque, bien des questions d'intérêt général étaient résolues en Belgique ; mais il en existait une, qui n'avait pas encore reçu de solution complète, ni même été approfondie autant que son importance l'exigeait. Jusqu'alors, tout ce qui avait été fait pour la défense nationale, était bien plutôt le résultat de principes généraux que les conséquences de vues, soit politiques, soit stratégiques, particulièrement applicables à la Belgique. Le général Goblet, par ses connaissances spéciales, par sa participation à la convention du 14 décembre 1831, relative aux forteresses de la Belgique, conclue avec l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, était plus à même que tout autre d'éclairer les discussions qui devaient surgir de l'examen du système de défense du pays. Aussi fut-il chargé de présider le comité institué, au mois de janvier 1848, pour arrêter les bases matérielles de ce système. M. Goblet avait émis au sein de la représentation nationale les conditions politiques de l'indépendance de la Belgique; les conséquences militaires de ces conditions ont été également développées par lui à la même époque, au sein de la Chambre.
« Décider, disait-il, que la Belgique formerait un Etat perpétuellement neutre, et lui garantir cette neutralité perpétuelle, c’est lui assigner d’autres devoirs que ceux qui avaient été imposés au royaume des Pays-Bas. Dans toute guerre, la place de ce dernier était marquée parmi les belligérants, tandis que la Belgique, en vertu de sa neutralité, doit désormais se maintenir en dehors du conflit.
« Ce serait cependant aller beaucoup trop loin que de supposer qu'elle ne puisse être amenée, malgré elle, à y prendre part ; car ce serait poser en principe que ce pays est, à tout jamais, à l'abri d'une injuste agression.
« On entend souvent prononcer des jugements fort contradictoires sur les principes de la neutralité. Les uns y voient un élément de sécurité complète, qui dispense, pour ainsi dire, de toute précaution.
« D'autres, au contraire, tiennent la neutralité inscrite dans notre droit public pour une lettre morte, pour une stipulation sans portée, qui ne lie personne et ne sauve d'aucun danger.
« Ces opinions si opposées s'écartent également de la vérité. Il y a, des deux parts, une singulière exagération. De ce qu'une clause de traité peut être violée, en induire qu'elle est superflue, c'est méconnaitre l'utilité d'une loi, parce qu'elle peut être enfreinte ; c'est en quelque sorte subordonner la situation générale au cas particulier, la règle à l'exception ; c'est contester la valeur de tout arrangement international, car tous sont sujets à rupture. Il n'en existe pas en effet, quelque solennel qu'il soit, quelle que soit l'universalité de sa garantie, qui ne puisse être violé par l'une ou l'autre des parties contractantes.
« D'un autre côté, se reposer avec une confiance trop absolue sur le texte d'un traité, faire dépendre uniquement son existence nationale de la fidélité des tiers à leurs engagements, serait d'une politique bien peu prévoyante, puisqu'elle reposerait sur cette idée que, partout et toujours, les obligations sont scrupuleusement tenues, que jamais l'intérêt ou la passion ne les fait mettre en oubli. Pour rester dans le vrai, pour apprécier sainement les choses, il faut se placer à égale distance de ces deux opinions extrêmes. Un engagement contracté solennellement par cinq puissances, sans être nécessairement hors de toute atteinte, ne peut pas du moins ètre envisagé comme de nulle portée, alors surtout que, s'il arrivait que sa rupture convînt aux unes, elle serait, par cela même, réprouvée et réprimée par les autres. On ne peut donc nier qu'il soit de la plus haute importance pour un pays, entouré, comme le nôtre, de puissants voisins, d'avoir la certitude, s'il était attaqué par l'un d'eux, d'ètre à l'instant protégé et défendu par tous ceux qui, plus fidèles à leurs engagements et mus, d'ailleurs, par leurs propres intérêts, s'empresseraient de voler à son secours. C'est là surtout le sens que l'on doit attacher à la neutralité de la Belgique. Il y a donc là une garantie réelle; mais, pour être efficace, cette garantie ne doit pas demeurer isolée : elle doit se combiner avec d'autres, c'est-à-dire avec l'organisation des moyens défensifs.
« Si donc le royaume de 1815 était obligé, par des engagements envers ses hauts alliés, d’entretenir de grands moyens de défense, celui de 1830 ne peut, d’après la situation qui lui a été faite, se dispenser, dans une proportion convenable, de charges analogues, s’il veut assurer son indépendance et sa neutralité.
« La Belgique ne peut certes avoir la prétention de lutter seule contre l’un ou l’autre des grands Etats au milieu desquels elle se trouve placée. Mais n’est-elle pas en position de faire pencher la balance en faveur de celui qui la soutiendrait contre ses agresseurs, en lui prêtant l’appui de toutes ses forces actives et passives ?
« Le royaume des Pays-Bas, s'il prévoyait des dangers, pourrait, à l'instant même, avoir recours à ses protecteurs naturels, et réclamer d'eux les secours qu'ils s'étaient engagés à lui fournir.
« La Belgique est-elle dans la même situation ? Non, sans doute. Sans pouvoir manifester la défiance qu'elle pourrait avoir de la bonne foi de l'une des puissances qui lui ont garanti son existence, elle doit attendre que l'agression soit flagrante pour recourir à celles qui viendraient la défendre. Cette importante considération doit nécessairement exercer une grande influence sur la force de son état militaire.
« Si elle négligeait cet élément, ne risquerait-elle pas d'ètre instantanément envahie, chaque fois que l'un des puissants Etats qui l'avoisineut aurait un intérêt à violer ses engagements envers elle ? Ne serait-elle pas victime de tous les maux de la guerre, avant qu'on pùt arriver à son secours ? D'ailleurs, ne pourrait-elle pas être accusée d'avoir été sans utilité pour l'équilibre de l'Europe ? et dès lors elle n'aurait plus aucune garantie de son existence. »
Telles sont quelques-unes des considérations que le général Goblet faisait valoir pour convaincre les représentants de la nation de l'impérieuse nécessité où se trouvait la Belgique de ne rien négliger pour l'entretien et la garde d'établissements défensifs destinés à protéger les opérations des alliés que lui donnerait la violation de sa neutralité ; tels sont aussi les principes qu'il n'a cessé de préconiser dans toutes les circonstances où il fut appelé à se prononcer sur la nature des forces militaires que doit entretenir le pays.
Nous retrouvons le général Goblet, de 1848 à 1851, président des diverses commissions instituées pour arrêter les bases d'un système complet de défense du royaume.
Mis à la retraite, en mars 1854, il ne se trouvait plus sous l'application de la loi des incompatibilités ; les électeurs de la capitale le mirent bientôt à même de rendre de nombreux services au pays ; rentré à la Chambre des représentants, au mois de juin suivant, le général Goblet ajouta une page brillante au livre de sa vie déjà si bien remplie. Le rapport rédigé par lui, au nom de la commission chargée d'examiner le projet de défense nationale, présenté par le ministère qui avait succédé au cabinet du 30 mars 1855, rejeta nettement les conclusions du gouvernement. Le rapport de l'honorable général était un modèle du genre, et l'on peut dire que c'est grâce aux lumières répandues par lui dans ce débat, que la majorité de la Chambre s'est décidée à voter contre le projet de fortifications nouvelles d'Anvers.
L'honorable comte Goblet aura encore, nous l'espérons, bien des années de sa verte vieillesse à consacrer au bien-être et à la défense de la Belgique.