Fallon Isidore (1780-1861)
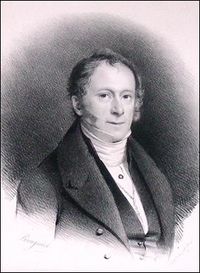
Fallon Isidore, Jean-Baptiste catholique
né en 1780 à Namur décédé en 1861 à Namur
Ministre (intérieur) en 1831. Représentant 1831-1848 , élu par l'arrondissement de Namur Congressiste élu par l'arrondissement de NamurBiographie
(Extrait de : A. WAUTERS, dans Biographie nationale de Belgique, t. VI, 1876, col. 869-871)
FALLON, Jean-Baptiste-Isidore-Ghislain, jurisconsulte et administrateur, né le 28 mars 1780, mort le 22 janvier 1861.
Ainsi que deux autres hommes qui ont parcouru une brillante carrière : le général et géographe Fallon, dont feu le général Guillaume a écrit la biographie, et Théophile Fallon, l'ancien président de la cour des comptes, Isidore Fallon naquit à Namur de Louis-Augustin, avocat-pensionnaire des Etats de Namur, et de Marie-Françoise Sternon. Il fit des bonnes études et embrassa la profession d'avocat, dans laquelle il se fit remarquer par les qualités essentielles du jurisconsulte : un jugement sûr, une vaste érudition, une grande application au travail.
Non-seulement il devint l'un des membres les plus distingués du barreau de sa ville natale, mais il y rendit de grands services en acceptant des fonctions, pénibles et presque toujours ou gratuites ou peu lucratives, mais dans lesquelles (manque deux mots) à la science de l’administration sont la rectitude et se préparer à occuper avec honneur des positions plus importantes. Il avait à peine atteint sa majorité et terminé son stage quand le gouvernement français utilisa ses capacités. Un arrêté du préfet du département de Sambre-et-Meuse, du 14 thermidor an XII (2 août 1804), le désigna pour faire partie de la commission administrative des hospices de Namur et, le 24 avril 1811, un décret de Napoléon 1er le nomma premier substitut du procureur impérial près le tribunal de la même ville. La chute de l'empire n'eut pas pour résultat de l'éloigner des positions officielles ; au contraire, il prit alors aux travaux administratifs une part plus active. Tandis qu'un arrêté royal du 18 décembre 1815 le nommait membre de la régence namuroise et qu'il entrait, le 1er juin 1818, par la force de l’élection, au conseil provincial, il ne renonçait pas à ses anciennes occupations judiciaires. Il devint, le 16 décembre 1815, juge suppléant près du tribunal de première instance de Namur ; le 8 février 1817, l'avocat des domaines dans la province de ce nom, et, le 28 août suivant, l'avocat, près des tribunaux de Namur et de Dinant, des administrations des impositions indirectes et des convois et licences.
La révolution de 1830 le trouva jouissant d'une grande réputation, et l'on ne doit pas s'étonner si ses concitoyens le choisirent, le 4 novembre, comme député suppléant au Congrès national, où il entra définitivement le 24 février 1831, comme remplaçant le baron de Stassart, démissionnaire.
Son mandat législatif lui fut continué par ses concitoyens jusqu'en 1848 que, mis en demeure d'opter, en vertu de la loi sur les incompatibilités, il donna la préférence à sa position de président du conseil des mines. A la chambre des représentants, Fallon joua un rôle actif, mais plus réel que brillant. Il ne prit jamais place parmi les orateurs qui attirent et commandent l'attention ; mais il se fit distinguer par des qualités sérieuses. On le vit, en plusieurs circonstances, exprimer son opinion avec une grande franchise : c'est ainsi qu'en 1831-1832 il critiqua l'état de siège imposé à la ville de Gand ; en 1832-1833, il accusa le gouvernement d'avoir manqué de déférence envers la chambre et, à la session suivante, il proposa un amendement qui impliquait un blâme de la conduite du ministère. Nourri des grandes idées de liberté qui avaient inspiré les rédacteurs de la Constitution et qui dominaient encore la plupart des membres des deux chambres, il aurait voulu asseoir notre régime municipal sur des bases plus larges que celles qui sont inscrites dans la loi communale. Il refusait une voix délibérative au bourgmestre qui serait choisi hors du sein du conseil de la commune et prétendait que les échevins devaient être élus par leurs concitoyens, comme cela s'était pratiqué en 1830, et non désignés par le roi parmi les conseillers ; ces deux points furent adoptés par la chambre les 7 et 8 mai 1835, contrairement à ce que le sénat avait décidé ; mais, au deuxième vote de la loi, un système contraire prévalut, malgré l'opposition de Fallon. Il y eut alors de nouveaux débats, auxquels il participa moins qu'aux premiers, mais il s'occupa beaucoup de la loi sur les naturalisations, du projet de loi sur les mines, du traité des vingt-quatre articles. Son influence était devenue si grande qu'il fut élu vice-président en 1832 et qu'il ne quitta ce poste (sauf de 1833 à 1835) que pour revenir président, le 18 novembre 1839 ; en 1842 (dans la séance du 8 novembre), il allégua des motifs de santé pour décliner cet honneur ; en réalité. il n'était plus en complète harmonie d'idées avec ses collègues de la droite qui constituaient alors la majorité.
Un homme tel que Fallon ne pouvait passer inaperçu dans un gouvernement constitutionnel, où le talent a mille occasions de se produire et se met franchement et naturellement en relief. Le roi Léopold 1er l'appela, le 12 novembre 1831, à occuper le poste de ministre de l'intérieur, ce poste si important auquel on n'avait pas alors enlevé la direction des travaux publics et celle de l'instruction publique ; une trop grande défiance de ses forces engagea Fallon à décliner cette position éminente et difficile, pour laquelle d'ailleurs il n'avait peut-être pas l'aptitude nécessaire ; son esprit studieux et tranquille se pliait mieux aux paisibles travaux de cabinet qu'aux occupations délicates et multiples d'un homme politique. Cependant, en 1832, lorsque les ministres, peu de temps avant le siège de la citadelle d'Anvers, présentèrent au roi leur démission collective, il fut chargé de former une nouvelle administration, mais cette honorable mission resta sans objet, les ministres ayant consenti à reprendre leurs portefeuilles..
Originaire d'une province où les mines entrent pour une large part dans la richesse publique, Fallon n'avait eu garde de négliger les lois qui se rattachent à leur exploitation, et chaque fois qu'il en était question à la tribune nationale, il avait pris une part importante à la discussion. Lorsque le Conseil des mines fut organisé, il en devint le président et le resta depuis le 27 mai 1837 jusqu'au 20 mai 1858, qu'il fut admis à prendre sa retraite. La législation relative aux mines avait été négligée du temps de l'administration hollandaise et un grand nombre de sites houillers et métallifères n'étaient ni explorés, ni utilisés. Sous l'influence du mouvement extraordinaire que la révolution de 1830 imprima aux esprits, les demandes de concessions affluaient de plus en plus ; les examiner et y répondre réclamait un travail ardu et considérable. Le nouveau président du conseil y prit la plus large part, feuilletant les dossiers, discutant les questions de droit les plus épineuses avec une attention minutieuse, et l’on peut dire que si les richesses du sol belge sont mises à profit dans des proportions infiniment plus fortes qu'elles ne l'étaient autrefois, on le doit surtout à l'activité qu'il imprima au service dont la direction lui était confiée.
Fallon fut encore chargé, en 1838, de concert avec Dujardin, depuis honoré, comme lui, du titre de baron, de réclamer de la conférence de Londres des modifications au partage de la dette de l’ancien royaume des Pays-Bas, et, en 1839, après la conclusion de la paix, de régler, à Utrecht, avec des délégués de l'administration hollandaise, des intérêts nombreux et compliqués. Chaque fois il s'acquitta avec conscience de la tâche qu'on lui avait imposée. Lors de la discussion qui s'engagea à la chambre, en séance secrète, du 28 au 31 janvier et le 1er février 1843, au sujet de l'exécution du traité conclu avec la Hollande le 3 novembre précédent, Fallon rendit compte de la part qu'il y avait prise ; ses explications parurent si satisfaisantes, que la chambre, ordonna l'impression de son discours.
Le gouvernement ne lui marchanda pas les récompenses : nommé d'emblée officier de l'ordre de Léopold le 12 août 1839, il devint grand-officier le 1er juin 1845 ; il fut, à la fois, décoré de la croix de fer et nommé commandeur du Lion Néerlandais. Enfin, le 15 juin 1858, le roi lui accorda une distinction qu'il convoitait ardemment, plus pour les siens que pour lui-même : il fut créé baron, et ce titre fut déclaré transmissible à ses petits-fils puinés, Anatole-Jules-Louis et Félicien-Frédéric-Marie, pour être laissé par eux à leurs descendants par ordre de primogéniture.
Fallon ne survécut pas longtemps à sa retraite des affaires publiques. Il mourut à Namur, où il avait conservé sa résidence habituelle, à l'âge de quatre-vingt-un ans. Après avoir reposé dans l'ancien cimetière de cette ville, qui est devenu un magasin de bois, ses restes ont été transférés, en 1866, au nouveau lieu d'inhumation, à la Plante, où sa tombe attend encore une inscription. Il a laissé les plus honorables souvenirs dans l'administration qu'il a si longtemps dirigée, et où l'on se rappelle encore la bienveillance de son caractère, l'étendue de ses connaissances, son activité et son intégrité.